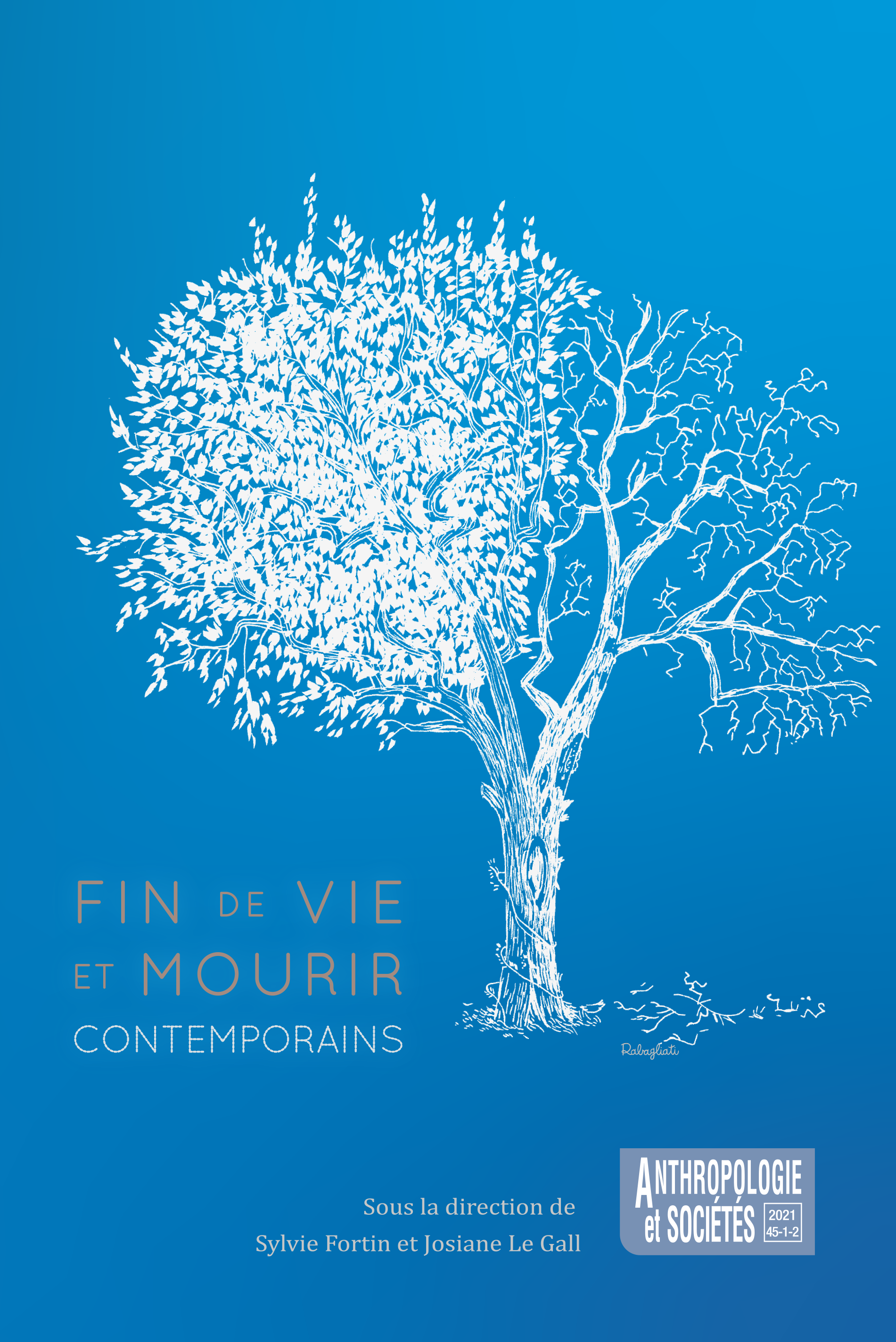En ce qui concerne ma trajectoire et les principales étapes de ma carrière, je suis née en 1944 dans une famille d’immigrants tchèques et j’ai grandi à Brooklyn. J’ai étudié dans un lycée catholique. Là-bas, une des religieuses m’a demandé ce que je voulais faire de ma vie. Je lui ai dit que je me voyais quelque part en Amérique latine, en train de discuter et de passer du temps avec les gens. Elle m’a répondu : « Merveilleux ! Tu vas devenir une missionnaire ! », mais je savais déjà que ce n’était pas ce que je souhaitais faire. Je voulais comprendre ce qui préoccupe les gens au quotidien et ce qui leur tient à coeur, et j’ai découvert que l’anthropologie me permettrait de faire cela. Une première étape importante dans ma carrière fut de travailler avec Hortense Powdermaker, que j’ai rencontrée au Queens College et que j’ai ensuite suivie comme assistante de recherche à l’Université Berkeley en 1969. Hortense était, à bien des égards, une « anthropologue publique », à une époque où cette approche était peu commune. Elle a écrit dans des journaux comme le New York Times à différentes occasions. Je pense que cela a influencé mon propre rapport à l’anthropologie, en m’invitant notamment à interpeller des publics au-delà du monde universitaire avec mes travaux. Il vaut aussi la peine de mentionner que j’ai été très impliquée politiquement dans les années 1960, notamment avec les Peace Corps au Brésil entre 1964 et 1966, puis avec le mouvement pour les droits civiques dans la ville de Selma, en Alabama, entre 1967 et 1968. Une autre étape importante a été mon travail de terrain en Irlande, qui a mené à la publication de Saints, Scholars, and Schizophrenics: Mental Illness in Rural Ireland (1979). Je travaillais dans une toute petite communauté isolée à l’ouest de l’Irlande, qui soutenait fortement l’IRA [Irish Republican Army ; Armée républicaine irlandaise]. Je me suis intéressée au fait que de nombreuses personnes qui vivaient là-bas n’allaient pas à l’hôpital, même lorsqu’elles étaient malades, et qu’elles souhaitaient mourir à la maison. Mon travail de terrain m’a finalement poussée à examiner les liens entre la pression sociale exercée sur les membres de cette communauté, notamment en ce qui concerne l’accès à la terre, et la forte prévalence des troubles de santé mentale parmi ceux-ci. Le livre qui en a découlé a provoqué une controverse importante, et j’ai dû entreprendre plusieurs démarches pour tenter de me réconcilier avec les participants qui ont été blessés par la manière dont j’ai dépeint leur vie (id. 2000). Un changement majeur dans ma pratique a eu lieu durant mes quatre séjours sur le terrain dans le nord-est du Brésil entre 1982 et 1989, pour un total de quatorze mois de travail ethnographique qui ont mené à la publication de Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil (1992). Je n’étais pas impliquée politiquement lors de mon terrain en Irlande ; je n’ai pas proposé aux participants de les aider à résoudre certains problèmes ou de soutenir des causes qui leur tenaient à coeur. Au Brésil, beaucoup de participants me connaissaient déjà en raison de mon implication dans les Peace Corps et, au début de ma recherche sur la santé reproductive, on m’a rapidement dit : « Si tu restes ici, tu dois travailler avec nous et nous aider à régler nos problèmes avec l’eau, les épidémies, l’électricité, etc. » J’étais réticente au début puisque je me percevais comme une anthropologue traditionnelle, qui n’est pas autorisée à prendre position politiquement, mais j’ai finalement accepté de les soutenir plus …
Appendices
Références
- Auyero J., P. Bourgois et N. Scheper-Hughes (dir.), 2015, Violence at the Urban Margins. New York, Oxford University Press.
- Beck S. et C. A. Maida (dir.), 2015, Public Anthropology in a Borderless World. New York, Berghahn Books.
- Bourgois P., 2002, « Anthropology and Epidemiology on Drugs: The Challenges of Cross-Methodological and Theoretical Dialogue », International Journal of Drug Policy, 13, 4 : 259-269.
- Brice A., 2017, « Celebrating ‘Barefoot Anthropology’ — A Q&A With Nancy Scheper-Hugues », Berkeley News, 28 avril 2017, consulté sur Internet (https://news.berkeley.edu/2017/04/28/celebrating-barefoot-anthropology-nancy-scheper-hughes/), le 28 juillet 2021.
- Burawoy M., 2005, « For Public Sociology », American Sociological Review, 70, 1 : 4-28.
- Dubal S., 2018, Against Humanity: Lessons From the Lord’s Resistance Army. Oakland, University of California Press.
- Farmer P., 1992, AIDS and Accusation: Haiti and the Geography of Blame. Berkeley, University of California Press.
- FarmerP., 2004, « An Anthropology of Structural Violence », Current Anthropology, 45, 3 : 305-325.
- Fassin D., 2008, « Introduction. L’inquiétude ethnographique » : 7-15, in D. Fassin et A. Bensa (dir.), Les politiques de l’enquête. Épreuves ethnographiques. Paris, La Découverte.
- Kleinman A., V. Das et M. M. Lock (dir.), 1997, Social Suffering. Berkeley, University of California Press.
- Lear J., 2008, Radical Hope: Ethics in the Face of Cultural Devastation. Cambridge, Harvard University Press.
- Ortner S. B., 2016, « Dark Anthropology and Its Others: Theory Since the Eighties », HAU: Journal of Ethnographic Theory, 6, 1 : 47-73.
- Robbins J., 2013, « Beyond the Suffering Subject: Toward an Anthropology of the Good », Journal of the Royal Anthropological Institute, 19, 3 : 447-462.
- Scheper-Hughes N., 1979, Saints, Scholars, and Schizophrenics: Mental Illness in Rural Ireland. Berkeley, University of California Press.
- Scheper-Hughes N., 1983, « A Proposal for the Aftercare of Chronic Psychiatric Patients », Medical Anthropology Quarterly, 14, 2 : 3-15.
- Scheper-Hughes N., 1990, « Three Propositions for a Critically Applied Medical Anthropology », Social Science & Medicine, 30, 2 : 189-197.
- Scheper-Hughes N., 1992, Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil. Berkeley, University of California Press.
- Scheper-Hughes N., 1995, « The Primacy of the Ethical: Propositions for a Militant Anthropology », Current Anthropology, 36, 3 : 409-440.
- Scheper-Hughes N., 1996, « Small Wars and Invisible Genocides », Social Science & Medicine, 43, 5 : 889-900.
- Scheper-Hughes N., 1997, « Demography Without Numbers » : 201-222, in D. I. Kertzer et T. Fricke (dir.), Anthropological Demography: Towards a New Synthesis. Chicago, University of Chicago Press.
- Scheper-Hughes N., 2000, « Ire in Ireland », Ethnography, 1, 1 : 117-140.
- Scheper-Hughes N., 2004a, « Dangerous and Endangered Youth: Social Structures and Determinants of Violence », Annals of the New York Academy of Sciences, 1036, 1 : 13-46.
- Scheper-Hughes N., 2004b, « Parts Unknown: Undercover Ethnography of the Organs-Trafficking Underworld », Ethnography, 5, 1 : 29-73.
- Scheper-Hughes N., 2008, « A Talent for Life: Reflections on Human Vulnerability and Resilience », Ethnos, 73, 1 : 25-56.
- Scheper-Hughes N., 2016, « Anthropologist as Court Jester: Civil Disobedience and the People’s Café », BOOM: The Journal of California, 6, 4 : 78-89.
- Scheper-Hughes N., 2017, « Can Anthropology Save the World? » : 463-468, in N. Brown, T. McIlwraith et L. T. de González (dir.), Perspectives: An Open Invitation to Cultural Anthropology. Arlington, American Anthropological Association.
- Scheper-Hughes N., 2020, « The Organs Watch Files: A Brief History », Public Anthropologist, 2, 1 : 1-36.
- Scheper-Hughes N. et P. Bourgois, 2004, « Introduction: Making Sense of Violence » : 1-31, in N. Scheper-Hughes et P. Bourgois (dir.), Violence in War and Peace: An Anthology. Hoboken, Blackwell Publishing.
- Scheper‐Hughes N. et M. M. Lock, 1987, « The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology », Medical Anthropology Quarterly, 1, 1 : 6-41.
- Scheper‐Hughes N. et A. M. Lovell, 1986, « Breaking the Circuit of Social Control: Lessons in Public Psychiatry From Italy and Franco Basaglia », Social Science & Medicine, 23, 2 : 159-178.
- Scheper‐Hughes N. et D. Stewart, 1983, « Curanderismo in Taos County, New Mexico: A Possible Case of Anthropological Romanticism? », Western Journal of Medicine, 139, 6 : 875-884.
- Wallace A., 1970, The Death and Rebirth of the Seneca. New York, Knopf.