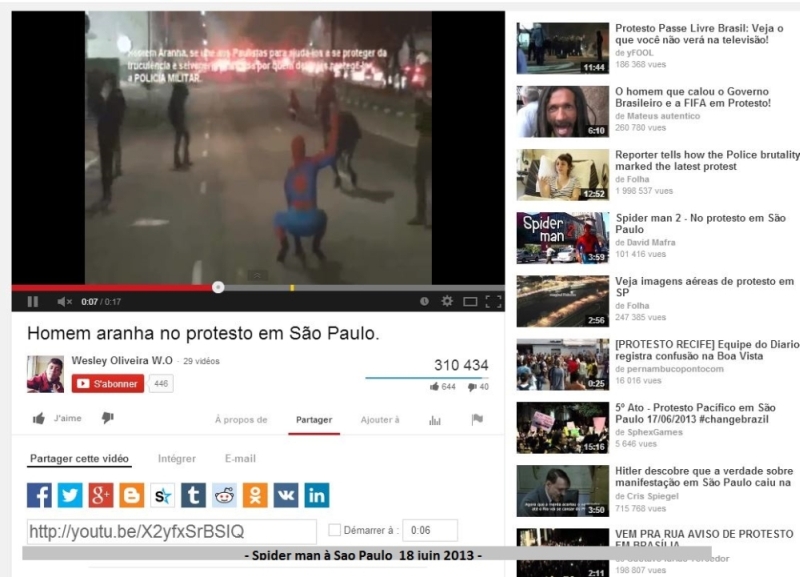Abstracts
Résumé
La production et le partage en ligne d’images et de vidéos fait aujourd’hui partie du répertoire des mobilisations partout dans le monde. Cette pratique individuelle alimente un nouveau discours collectif visuel. L’analyse de ces images comme langage vernaculaire des mobilisations nous documente de façon originale sur la subjectivité collective qui les constitue. Celles des mobilisations brésilienne, turque et ukrainienne de 2013-2014 dessinent des « autoportraits des peuples » complexes et contrastés. La crise de la représentation politique signe-t-elle l’avènement du spectacle comme nouvel espace de confrontation ?
Mots-clés :
- Bertho,
- mobilisation,
- vidéo,
- représentation
Abstract
Production and online sharing of images and videos is now part of the repertoire of the mobilizations around the world. This individual practice feeds a new visual collective discourse. Analysis of these images as vernacular documents of mobilizations is an original way on collective subjectivity that constitutes them. Those of Brazil, Turkey and Ukraine mobilizations 2013-2014 draw « self-portraits of people » complex and mixed, sign-will that the political crisis of representation opens with the advent of the show a new area of confrontation.
Keywords:
- Bertho,
- Mobilization,
- Video,
- Representation
Resumen
Producir y compartir imágenes y videos en línea forma parte del repertorio de las movilizaciones en todo el mundo. Esta acción individual alimenta un nuevo discurso visual colectivo. El análisis de esas imágenes como la lengua vernácula de las movilizaciones nos informa de manera original sobre la subjetividad colectiva que las constituye. Las movilizaciones brasileñas, turca y ucraniana de 2013-2014 delinean « autorretratos de los pueblos » complejos y contrastantes. ¿ La crisis de la representación política marca el advenimiento del espectáculo en tanto que nuevo espacio de confrontación ?
Palabras clave:
- Bertho,
- movilización,
- video,
- representación
Article body
L’usage de l’image et de la vidéo mise en ligne dans les mobilisations contemporaines est un élément nouveau et marquant du nouveau répertoire de l’action collective (Bertho 2013). C’est en tant que telles, et pas seulement comme source d’information ou témoignage individuel, que ces images doivent aujourd’hui être analysées. L’hypothèse qui est ici mise à l’épreuve est que ces images, dont la captation et/ou la mise en ligne sur YouTube, Tumblr, Twitter ou toute autre plateforme ouverte au public relève de l’initiative individuelle, produisent un discours pictural qui fait collectivement sens par sa diffusion et son partage. Cette hypothèse s’appuie sur un travail de longue haleine sur les mobilisations dans le monde et la place des images. Elle anime le travail d’un réseau de chercheurs soutenu par la Maison des sciences de l’homme de Paris Nord. Et a déjà donné lieu à des publications et à des communications présentées sur le site du réseau[1]. Nous en exposerons donc les grandes lignes à titre de préalable et de présentation du travail d’analyse sur les vidéos mises en ligne à l’occasion de trois mobilisations au Brésil, en Turquie et en Ukraine en 2013-2014.
Cet usage de l’image et de la vidéo mise en ligne dans les mobilisations contemporaines ne joue pas le même rôle dans la performativité des collectifs et des groupes que dans la séquence historique qui s’est achevée à la fin du XXe siècle. L’image n’est plus le prolongement d’énoncés sociaux et politiques élaborés en amont. Elle devient un moment de la production d’énoncés et de la production du collectif. Cette transformation s’appuie à la fois sur la révolution technique des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et sur les ruptures subjectives de notre époque. Les « singularités quelconques » annoncées par Giorgio Agamben en 1990 produisent aujourd’hui, dans les mobilisations, des communautés subjectives singulières, inattendues et souvent provisoires. C’est dans l’évènement qu’elles émergent et se reconnaissent. La figure de la « flash mob » – ou de l’émeute – devient constituante et le « film » de l’évènement (au sens technique du terme), ou plutôt la multiplicité des films individuels écrivent en temps réel les premiers énoncés du collectif et son auto-reconnaissance qu’Internet se chargera de diffuser. Cette nouvelle logique, parfois stratégique, de reconnaissance renverse la posture d’analyse : il ne s’agit plus de lire le sens des images à partir des collectifs qui les produisent mais de lire les collectifs qui se constituent à travers les images qui contribuent à leur émergence.
Émeutes et mouvements : une crise de la représentation ?
L’affaiblissement des dispositifs de représentation et des médiations politiques est notable. Le monde est entré depuis le début du siècle dans une séquence où la figure de l’émeute prend le pas sur les formes modernes de mobilisation sociale. L’hypothèse posée en 2009 (Bertho 2009) s’est confirmée depuis (Bertho 2010, 2011). L’année 2011 (voir Bertho et Luret 2010), celle du printemps arabe, d’Occupy Wall Street et des Indignés espagnols marque un tournant, même si elle n’a pas ralenti l’extension des émeutes. Mais elle a donné un visage, des mots, une puissance collective inédite à une révolte jusque-là cantonnée au silence, à l’isolement et à la répression. Ces soulèvements n’ont pas été des révolutions : la puissance populaire qui s’y est exprimée n’avait pas de stratégie de pouvoir – au sens de finalité de s’instituer comme gouvernement ou de porter des candidats au gouvernement (Bertho 2012). 2011 ouvre le temps des mouvements, en 2012, 2013, 2014.
Ces mouvements temporaires, même s’ils sont plus stratégiques que les émeutes, mobilisent toujours un collectif face à un État auquel il s’agit de faire entendre des préoccupations populaires qu’aucune médiation politique ne représente. Se sont ainsi développés le mouvement des étudiants chiliens, le « Printemps érable » des étudiants québécois, la révolte de Wukan en Chine du sud, le mouvement « Y’en a marre » au Sénégal, la révolte de la région du Aysen au Chili, le mouvement contre l’augmentation des transports à Rio de Janeiro et Sao Paulo, la mobilisation turque contre le réaménagement urbain d’Istanbul (place Taksim), et l’insurrection ukrainienne.
Ils donnent à voir dans la singularité des situations nationales le nouveau dispositif peuple/pouvoirs qui émerge dans des situations où des dispositifs modernes de représentation donnent des signes d’usure politique (montée de l’abstentionnisme, perte de confiance dans le personnel politique élu). Dans ce nouveau face à face (dont n’émerge pas un dispositif de représentation alternatif), l’enjeu est toujours l’émergence d’un « nous », de l’énoncé clair de cette puissance subjective collective qui fait bien souvent plier des États. Le « Peuple » fait ainsi de nouveau surface et émerge de la multitude dans la mobilisation et l’affrontement. Ce renouveau est paradoxal : le peuple au sens moderne est apparu comme source indispensable de la souveraineté étatique. L’État constitue le peuple dans la mission qu’il lui donne et se fait en retour légitimer par lui. Aujourd’hui, face à des États qualifiés d’illégitimes par des mobilisations, c’est bien souvent une nouvelle figure nationale qui émerge, qu’on aura parfois tendance à qualifier de « populiste », faute de références anciennes permettant de la qualifier.
« Merci Facebook, merci le peuple » : cette phrase tracée sur les murs de Tunis fin janvier 2011 énonce toute la complexité contemporaine de cette énonciation collective. Il est clair que les mobilisations dont nous parlons vivent au rythme des souvent nommés « réseaux sociaux », Facebook, Twitter, YouTube, Viméo… Mais si les usages de ces nouveaux outils numériques se sont autant développés, au-delà de ce qu’en imaginaient les inventeurs, c’est parce qu’ils offrent des alternatives aux modes d’organisation qui avaient marqué le XXe siècle et qui connaissent une obsolescence rapide. Ces modes d’organisation fonctionnaient subjectivement sur l’existence préalable d’une communauté subjective qu’il s’agissait de « politiser », c’est-à-dire de représenter au pouvoir, au terme d’une démarche stratégique de longue haleine. Or, il nous manque aujourd’hui tous les ingrédients de cette alchimie subjective et organisationnelle : les identités collectives des « Singularités quelconques » sont fluides, la représentation n’est plus opératoire, l’État l’apparaît plus comme un outil de puissance à conquérir, et la mobilisation se constitue dans le temps court.
Que produisent ces substituts numériques en ligne de l’organisation ? Ils produisent l’évènement de la performance collective visible, temporaire et anonyme, sans porte-parole, sans organisation, sans identité. Ils ne donnent pas à voir des formes nouvelles d’adhésion mais plutôt des formes de partage massivement picturaux (Gunthert 2009). L’image devient une nouvelle écriture individuelle au sein d’un collectif indéfini. On n’imagine plus de mobilisations sans smartphones (téléphones intelligents) levés, de Rio à Manama, d’Istanbul à Burgos (Riboni 2012a). La production et le partage d’images devient un élément central du répertoire contemporain de la contestation et de la production de collectif au même titre que le tract, la banderole, le slogan ou l’assemblée générale dans le répertoire moderne.
Nous sortons de deux siècles de représentation à la fois symbolique et picturale. Cette représentation alliait l’inscription des actes dans un récit historique, et un monopole institutionnel de sa diffusion qui l’a transformé en spectacle. Quand les nouveaux outils numériques, leur interactivité et leur diffusion populaire mettent en cause ce monopole, ils changent le paradigme. Nous sommes passés de la communication de masse à l’auto-communication de masse (Castells 2013) et, dans le même temps, de la représentation à la présentation. Le commun se constitue dans le partage d’une expérience, par la présence physique (occupation d’une place) ou le partage de l’image qui en atteste : « je suis là aussi, donc nous sommes ».
Vidéo, reconnaissance et stratégie
Aujourd’hui, la production d’images vidéo et son partage en ligne sont susceptibles d’être présents dans tous les types de mobilisation, de toute ampleur. Les exemples sont innombrables. On peut voir une scène de rue prise d’un téléphone intelligent lors d’une émeute du logement au Cap en octobre 2013[2], visionnée 30 000 fois sur une chaîne YouTube de syndication[3], ou une scène d’affrontement lors d’une émeute à Zamdela (township de Sasolburg) le 22 janvier 2013[4], visionnée 4 700 fois sur une chaîne plus professionnelle, qui a mis en ligne d’autres vidéos d’affrontement dans les townships. On peut regarder, voire partager, une scène de l’attaque d’un local des Frères musulmans dans la banlieue du Caire le 22 mars 2013[5], reprise du site du Guardian et visionnée 650 fois sur le site GroundZeroMosque[6], ou les scènes de pillage de supermarchés à San Juan en Argentine, reprises des caméras de vidéosurveillance le 6 décembre 2013[7] et visionnées 30 000 fois sur la chaîne YouTube du journal Diario De Cuyo (DDC)[8]. La popularité d’une vidéo, son origine, son support en ligne sont trois éléments de contexte dont l’agencement semble assez aléatoire : alors que le site moins professionnel diffuse les images les moins claires mais très regardées, les images professionnelles (celles du Guardian) ne font pas le buzz qu’atteignent des images captées avec un téléphone intelligent au Cap.
Toute enquête sur la production et le partage de vidéos lors d’évènements collectifs se heurte à trois obstacles : l’origine de la vidéo est incertaine, le lieu de la première mise en ligne est difficile à établir, et sa viralité ‒ le caractère même du « buzz » mesuré au nombre de visionnages sur une ou plusieurs chaînes ‒ est assez obscure. Que nous reste-t-il à analyser ? L’image elle-même doit être vue comme une écriture individuelle sur un évènement dont le vidéaste est le témoin ou l’acteur. Le choix du cadrage n’est pas anodin et porte un énoncé visuel sur l’évènement. La reprise des images journalistiques n’est pas anodine non plus. Deux langages visuels se croisent : le langage vernaculaire du bras levé et du téléphone intelligent, le langage normalisé du journaliste manié comme une citation dans l’enchevêtrement des partages. Au total, un propos collectif en images se construit en ligne, sans locuteur simple et localisé, mais avec une force de reconnaissance.
L’auto-communication de masse (Castells 2013) génère l’ethnoscape (Appadurai 2001) de la mobilisation. Celui-ci entretient avec le spectacle médiatique un rapport complexe qui n’est y pas seulement celui de l’opposition ou de la concurrence (Riboni 2012b). De ce point de vue, on n’est pas exactement dans le registre de la « contre information » qui fut le souci de collectifs militants marqués par la concurrence des discours et de la publicité des faits. Pour Dominique Cardon et Fabien Granjon, on passerait ainsi de l’idée de « médias alternatifs » à la pratique de « médias participatifs » (Cardon et Granjon 2013). Mais l’image n’est pas seulement un vecteur d’information, c’est un élément du répertoire contemporain de la mobilisation déjà analysé par Ulrike Riboni (2013a, 2013b) pour l’Égypte et la Tunisie, et Cécile Boëx (2012, 2013) pour la Syrie. Cette prégnance de la dimension visuelle du répertoire a ainsi des conséquences sur le choix et l’organisation des évènements performatifs de la mobilisation, sur leur « mise en scène » au sens propre du terme. L’image n’est pas un produit dérivé de l’acte, elle peut devenir une partie de sa finalité opératoire.
Par ailleurs, le propos visuel diffère suivant les situations et nous parle de la subjectivité des mobilisations. On peut ainsi observer que lorsque l’émeute exprime une colère collective sans perspective de victoire, seuls les actes émeutiers sont filmés. Quand l’affrontement devient stratégique, i.e. avec une perspective de victoire ou de négociation, les images de la répression deviennent d’autant plus importantes. On voit ainsi apparaître le souci d’authentification qui leur permettra d’être relayées par les médias, souci tout à fait secondaire pour l’émeutier ordinaire. Le nouveau langage vernaculaire de l’image vidéo permet donc de penser une stratégie de l’image qui se met parfois en place. Cette stratégie, quand elle existe, travaille le langage vernaculaire, y intègre le langage normalisé, scénarise, agrège des productions diverses sur une même plateforme en ligne et, à l’instar des mobilisations qui la portent, n’a jamais d’état-major unique.
Les mobilisations de 2013 : la reconnaissance du peuple
Concentrons l’analyse sur l’année 2013 et le début de l’année 2014. Deux ans après l’année 2011 pour laquelle le Time Magazine avait consacré « The Protester » comme la personnalité de l’année (Bertho 2012), l’instauration des mobilisations et des affrontements se confirme dans le monde. Le nombre de situations d’affrontements civils constatées est en légère augmentation sur l’année 2012 (environ 1 800) et quelques mobilisations à caractère national scandent l’agenda. Nous retiendrons la mobilisation contre les prix des transports à Sao Paulo et Rio de Janeiro, qui devient une protestation contre le Mondial de football et son coût ; la révolte des Stambouliotes contre la spéculation foncière ; et la défense du Parc Gezi, le mouvement Euromaïdan à Kiev.
Comme dans d’autres mobilisations, notamment celles de l’année 2011 (printemps arabe, Indignados ou Occupy), la question transversale est celle de la visibilité du peuple et de sa prise en compte par le pouvoir dans trois contextes institutionnels évidemment très différents : celui d’une jeune démocratie pilotée depuis trois mandats présidentiels par le Parti des travailleurs ; celui d’une démocratie musclée et laïque pilotée par un gouvernement islamique affairiste ; celui d’un État post-communiste où s’affrontent des clans d’oligarques corrompus. Néanmoins, comme nous allons le voir, la mise en oeuvre d’un outil analytique transversal (l’autoportrait du « peuple » mobilisé à travers les vidéos en ligne) est non seulement opératoire dans les trois situations mais encore nous apporte des éléments supplémentaires de différenciation subjective de ces mobilisations.
Au Brésil, la politique de pacification et de réduction des favelas et celle des grands travaux se sont faites sans que le minimum de services urbains ne soient développés, notamment les transports pour des millions de citadins de plus en plus éloignés des centres des mégalopoles. La dureté de la vie quotidienne qui en résulte ne trouve aucun écho dans un système politique consensuel sur ce point : à Rio, la municipalité de centre droit, l’État gouverné par le Parti des Travailleurs et l’État fédéral s’accordent pour expulser les favelados et pour investir dans la perspective des grands évènements sportifs. Comme me l’ont dit des favelados d’un comité de défense de Rio en septembre 2012, cette « politique verticale » où tout le monde est d’accord laisse peu de place à la voix populaire. En Turquie, le gouvernement Erdogan allie conservatisme moral grandissant et immoralité financière transformant l’espace urbain en espace spéculatif. En Ukraine, les partis qui alternent au pouvoir semblent vendre le pays au plus offrant et surtout n’être guidés que par leurs intérêts privés. Élu sur un programme et des promesses europhiles, Yanoukovitch décide le 21 novembre d’accepter les offres russes.
Les trois étincelles – hausse des prix des transports au Brésil, plan urbain à Istanbul, volte-face politique en Ukraine – mobilisent donc un contentieux plus large et plus ancien où la question de la reconnaissance du peuple et de sa voix dans les décisions d’État est centrale, où la revendication d’un État porteur de l’intérêt public libéré de la corruption est majeure.
Après un sit-in initié le 28 mai, l’émeute contre le projet de rénovation de la place Taksim éclate à Istanbul le 31 mai 2013. En trois jours, la mobilisation gagne 81 des 90 villes turques, dans presque toutes les provinces. L’occupation de la place Taksim réunit des Turcs de sensibilités très diverses, des Kurdes aux kémalistes, des écologistes aux partisans des deux grandes équipes de football. La place, évacuée le 11 juin, est le théâtre d’affrontements jusqu’en juillet.
C’est alors que la place Taksim est encore occupée que débute la mobilisation sur le prix des transports au Brésil. Si des mobilisations locales commencent en mars, elles ne prennent de l’ampleur qu’à la fin mai, et c’est le 6 juin que la grande manifestation de Sao Paulo tourne à l’affrontement[9]. Le mouvement prend alors une dimension nationale et gagne les grandes villes du pays. Après la manifestation du 15 juin à Brasilia et les rassemblements du 17 dans de nombreuses villes, la revendication sur le prix des transports s’est élargie à la contestation du coût budgétaire de l’organisation de la Coupe du Monde de football.
Le mouvement Euromaïdan commence le 21 novembre avec l’annonce officielle de l’abandon du projet d’association de l’Ukraine avec l’Union européenne. Il emprunte une partie de son répertoire aux mobilisations contemporaines, notamment l’occupation durable de la place de l’indépendance à Kiev (place Maïdan). Mais il est un peu plus long (trois mois) et surtout réalise ses objectifs de départ : la destitution du président Viktor Ianoukovitch au prix d’un affrontement que, malgré les morts, n’ont connu ni le Brésil, ni la Turquie.
Ces trois mobilisations très singulières sont inscrites dans des contextes nationaux très différents. Elles présentent néanmoins quelques caractéristiques communes déjà notées dans des mobilisations précédentes. Dans les trois cas, nul ne peut nier le caractère totalement inattendu du déclenchement de la révolte. Dans les trois cas, observateurs et acteurs politiques institutionnels sont pris au dépourvu par l’ampleur rapide de la mobilisation et par sa détermination. Dans les trois cas, les mobilisations et les débats qu’elles ouvrent sur l’avenir même du pays prennent une ampleur nationale.
À Taksim comme au Brésil, les symboles de la séquence ouverte en 2011 sont présents : le masque des Anonymous arboré lors des manifestations, ou la « marque « Occupy » reprise par des sites ou des pages Facebook[10]. Au Brésil, comme à Kiev ou à Istanbul, c’est dans la rue, dans l’occupation de l’espace public et l’affrontement avec le pouvoir que se constituent des collectifs nouveaux, irréductibles aux identités collectives préalables, souvent qualifiés « d’hétéroclites » par ceux qui tentent de les lire au travers des grilles d’analyse éprouvées (Uysal 2013b). La répression ne fait souvent que renforcer la mobilisation. Ces mouvements font preuve d’une détermination collective inattendue et d’une sorte de « mise entre parenthèse » de la peur (Uysal 2013a). C’est là où la répression est la plus forte que la mobilisation va finalement au bout de ses revendications.
Dans les trois cas on observe une séquentialité courte, à la fois de la mobilisation et de la subjectivité collective qui s’y constitue. Et dans les trois cas, la production et la diffusion de l’image jouent un rôle fondamental dans la constitution de cette subjectivité, dans sa visibilité (Cocco 2013).
Images des peuples mobilisés
Ces mobilisations vont produire leurs images, même si la nécessité d’une visibilité du mouvement et du « nous » populaire qui s’y exprime est diversement prise en compte par des outils collaboratifs en ligne. Si Occupy Sao Paulo a sa page Facebook[11], le processus de mise en ligne des vidéos semble rester dispersé, alors que naissent en Turquie des pages Facebook dédiées[12] et des plateformes Tumblr qui agrègent des contenus d’origines diverses[13]. L’activité de la plateforme #occupygezi consiste surtout à publier les liens de vidéos mises en ligne sur d’autres plateformes, de formats d’ailleurs variables. Par exemple, elle publie le 2 juin trois vidéos particulièrement populaires, scénarisées (et sonorisées), reprises de plateformes individuelles et/ou anonymes : « Everyday I’m Capuling »[14], vue 400 000 fois, publiée sur la chaîne YouTube Alihan OLCAR[15] ; « Anonymous – #OccupyGezi Revolution Song »[16], visionnée 180 000 fois, publiée sur la chaîne YouTube Gezi Parki Icin[17] ; « Yorumsuz – Bestekar Sokak – Ankara »[18], visionnée 145 000 fois, publiée sur la chaîne YouTube Can Akyürek[19]. #Occupygezi a aussi sa version « Pics », qui fonctionne selon le même principe et met en page des images anonymes.
Ces initiatives semblent bien fragiles au regard du dispositif mis en place en Ukraine au cours des trois mois de mobilisation. Les plateformes dédiées sont nombreuses et d’importance inégale, le plus souvent ouvertement militantes. Citons par exemple : VelychkovskyS[20], 118 vidéos et 9 189 abonnés ; Микола Овчаров[21], 287 vidéos et 217 abonnés mais renvoyant à d’autres chaînes YouTube du même nom, dont l’une[22] compte 255 vidéos et 1 930 abonnés ; Руслан Горовий[23], 59 vidéos, 20 abonnés ; Ukraine Online[24], 35 vidéos ; Slava T[25], 32 vidéos.
Dans la mobilisation ukrainienne, il y a de l’organisation, notamment celle du parti nationaliste Svoboda qui possède un site de communication Radio Svoboda[26] et une plateforme vidéo[27] riche de ses 27 000 abonnés, plus de 12 000 000 de visionnages et 1 971 vidéos en ligne. Mais rien n’égale l’efficacité de la mise en ligne en direct 24h/24 opérée par Espreso Tv[28] qui dispose de sa propre plateforme YouTube avec un historique de 1 293 vidéos, 132 117 abonnés et 6 241 294 vues.
Ces trois dispositifs différents diffusent des images différentes et organisent de façon différente leur rapport à l’image journalistique produite et diffusée par les grands médias. L’une des façons de s’en distinguer de manière explicite est de montrer l’image de la répression. C’est l’un des thèmes forts de la mobilisation turque, choquée mais non arrêtée par la violence de la police face à une revendication ressentie comme pacifique et légitime. La plateforme Occupygezipics (figure 1)[29] consacrée aux photos du mouvement les met d’emblée en exergue : image de visages tuméfiés, de policiers en action, de pierres tombales.
Face à cette répression, le mouvement brésilien contre les hausses de transport peut proposer la dérision, comme la vidéo Spiderman « Homem aranha no protesto em São Paulo »[30] du 18 juin 2013 à Sao Paulo (figure 2) mise en scène à distance raisonnable de la police et visionnée plus de 310 000 fois. La fragilité héroïque du peuple est souvent présente dans les vidéos turques avec un homme sans armes défiant seul les forces de l’ordre comme « Istanbul gas boms, Istanbul protest » (figure 3)[31], mise en ligne le 2 juin. On peut voir des scènes du même genre dans « water cannon knocks guy flat 1 :25 Turkish police BRUTALLY disperse Istanbul park demolition PROTEST » du 31 mai (figures 4a et 4b)[32], où des individus seuls se mettent devant les canons à eau. Cette héroïsation volontairement dérisoire n’exclut pas le spectacle de la colère des manifestants comme l’attaque de la mairie de Sao Paulo dans « Manifestantes Quebram Vidros & Picham Prefeitura – São Paulo »[33] mise en ligne le 18 juin ; ni le spectacle des échauffourées de Fortalezza le 19 juin[34] dans « Vandalos X Policia – Cavalaria, Bolas de borracha ! 19/06/2013 ».
Figure 1
Page d’accueil de #occupygezi
Figure 2
Spiderman à Sao Paulo, 18 juin 2013
Figure 3
« Istanbul gas boms, Istanbul protest », 2 juin 2013
À Taksim ou au Brésil, les images produites ou partagées nous parlent d’une mobilisation qui subit la répression, d’un peuple en colère mais dont la force pacifique défie les armes sans espérer les vaincre. La figure du peuple n’est pas équivalente à la figure du pouvoir. Ce peuple n’apparaît pas comme candidat au pouvoir.
Figure 4a et 4b
Images tirées de « Water cannon knocks guy flat… », YouTube, 31 mai 2013
Figure 5
« Clashes between riot police and protestors in Kiev… », 18 février 2013
Quiconque a suivi les évènements ukrainiens de novembre 2013 à février 2014 n’a pas perçu le même spectacle. L’héroïsation de la puissance prend ici la place de l’héroïsation de la fragilité. Les jours passant et l’affrontement avec le pouvoir se durcissant, c’est la mise en scène de la guerre qui domine les écrans dans des films où le regard de l’acteur et celui du vidéo reporter professionnel ne sont pas faciles à distinguer. Le soin tout militaire accordé à la préparation des barricades en prévision de l’attaque des Beirkout est filmé avec précision. Avant la tuerie du 20 février, ce n’est pas la victimisation qui est mise à l’honneur mais la force collective des groupes d’autodéfense capables de mettre en difficulté, sinon en déroute, les forces de répression comme dans « [EXCLUSIVE CAMERA AMATEUR VIDEO] Clashes between riot police and protestors in Kiev Ukraine » (figure 5)[35] du 18 février, « Ukraine : six morts à Kiev, la mairie incendiée »[36], du même jour, ou « Избиение полиции. Киев. Украина » du 21 janvier[37].
La suite logique de cette figure quasi militaire du peuple insurgé est l’image des patrouilles de miliciens dans Kiev désertée par ses forces de police dès le 22 février.
Ce contraste se retrouve de façon saisissante dans l’hommage fait aux victimes de la répression : hommage à la fragilité du courage ou hommage aux héros d’un peuple[38]. Entre l’herbe du parc (figure 6) ou la communion de la foule (figure 7), ce n’est certes pas le même récit collectif qui s’énonce et s’inscrit dans la mémoire.
Figure 6
Hommage aux victimes #occupygezi
Figure 7
L’hommage aux victimes de RadioSvoboda sur la chaîne YouTube
La mobilisation comme spectacle
Au Brésil, en Turquie, comme en Ukraine, l’auto-communication d’images des mobilisations nous ont dessiné la subjectivité populaire du « nous » qui s’est constitué dans la rue, les contours et la consistance du peuple comme puissance subjective confrontée au défaut des procédures de représentation dites « politiques ». Cette auto-communication nous propose autant d’autoportraits des peuples qui se constituent dans la mobilisation.
Ces autoportraits sont plus riches que les discours qui accompagnent les mobilisations en en réduisant souvent considérablement la subjectivité. Ces autoportraits sont foisonnants, parfois contradictoires, souvent fluides et temporaires. Mais ils méritent une observation fine, car ils sont les énoncés les plus authentiques de ce que Giorgio Agamben nomme « la communauté qui vient » (Agamben 1990).
La stratégie spectaculaire d’Euromaïdan nous en dit plus sur la figure du peuple et de l’État Ukrainien qu’il promeut que les discours néo-nazis des groupes d’autodéfense[39]. Car si ces groupes sont minoritaires, cette figure d’un peuple-État sans diversité est portée par l’ensemble des participants, femmes et hommes ordinaires, réunis à un moment ou un autre sur la place, par leur actes et leurs images, par leurs actes en images.
Le peuple qui constitue sa puissance subjective dans l’affrontement avec le pouvoir est une figure récurrente des mobilisations depuis 2011. Les « nous » qui ont parlé haut et fort et souvent ébranlé les États ont souvent été des « nous » nationaux comme en Tunisie, en Égypte, au Sénégal, au Québec où le drapeau national est resté le symbole indiscutable du rassemblement. Ils ont été parfois régionaux comme dans la région d’Aysen au Chili, ou en Bretagne en France. Dans la majorité des cas, la volonté de reconnaissance du peuple par l’État porte une nouvelle figure de la Nation dont le contour est ainsi posé en des termes contemporains. Cette figure de la Nation doit assumer la question de sa diversité interne comme celle de ses rapports au pouvoir. Ainsi, l’affirmation nationale égyptienne contre Moubarak n’a pas résisté à sa diversité religieuse et à l’exercice du pouvoir. Au bout du compte c’est l’armée, présente de bout en bout, qui reste le symbole de son unité.
Car la similitude des questions contemporaines, comme la similitude des répertoires structurés par l’occupation de l’espace urbain et la mobilisation visuelle, n’infère pas la similitude des figures populaires qui s’y constituent. Dans la majorité des situations, cette affirmation collective se donne comme disjointe de toute stratégie de pouvoir qui lui soit propre. C’était le cas en Tunisie ou au Sénégal, comme ce fut le cas en 2013 au Brésil et en Turquie. Cette distance à l’égard du pouvoir se donne à voir dans une production visuelle à distance du spectacle du pouvoir. Ses images sont celles de la fragilité, de la diversité de « singularités quelconques » rassemblées mais non embrigadées. C’est le défi sans arme, la mobilité, la diversité qui sont mis en scène.
Le peuple de Maïdan n’exhibe ni fragilité, ni mobilité, ni diversité. Il n’est pas à distance de l’État mais à l’assaut de ce dernier, lui disputant militairement le contrôle de la rue dans un dispositif de barricades qui avait disparu du répertoire des mobilisations depuis le siècle dernier. Maïdan assume la mise en scène. C’est d’autant plus naturel que la mobilisation a été composée en spectacle professionnel.
Cette place, dès les premiers jours, a été disposée en espace de spectacle dans lequel la foule est alternativement actrice et spectatrice. La scène, la vraie, avec estrade, décors, sonorisation, caméra, prise de vue et prise de son est au centre du dispositif. Maidan n’est pas un forum horizontal comme l’ont été Tahrir, la Puerta del Sol ou Taksim. Elle n’est pas le lieu de performances collectives multiples. Elle est le lieu de construction d’un récit collectif structuré et diffusé : images d’orateurs et images de foule se succèdent dans la diffusion live d’Espreso.tv. Les télévisions étrangères et la foule des photos reporters y trouvent naturellement leur place et leur bon angle de vue. C’est devant cette même foule, sur cette même scène, que le nouveau gouvernement est adoubé en public le 26 février à 19 heures, nom par nom. C’est au même endroit que les membres de Berkut, la police anti-émeutes, viennent demander pardon à genou.
Dire que le soulèvement de Kiev a été orchestré comme un spectacle n’enlève rien au courage et à la détermination de ceux qui ont fait face aux forces de répression d’Ianoukovitch. Mais si les morts des derniers jours ont été bien réels, leur mise en scène le fut tout autant, en direct. Au matin du 19 février, le direct d’Espreso.tv retransmet les images d’une foule recueillie dans la prière et devant les popes chantant sur scène lorsqu’apparaissent les premiers brancards. Et la foule, face à la scène, continue de prier. Un autre acte commence à se jouer hors champ dont nous aurons très vite la séquence visuelle.
De la représentation au spectacle ?
On constate donc que les nouvelles technologies de communication, si elles font l’objet d’une appropriation générale, et si elles produisent un nouveau langage visuel vernaculaire, ne sont porteuses d’aucun déterminisme organisationnel ou subjectif. Mais elles sont investies dans le contexte d’une crise générale de la représentation et de l’espace public qui laisse sa place à l’avènement planétaire du spectacle auquel elles participent.
« Le spectacle ne peut être compris comme l’abus d’un monde de la vision, le produit des techniques de diffusion des images » avait prophétisé Guy Debord (1967 : 11). « Le spectacle n’est pas un ensemble d’images mais un rapport social entre des personnes médiatisé par des images » (ibid. : 10) et « une vision du monde qui s’est objectivée » (ibid. : 11). La proposition n’a rien perdu de sa force. C’est sans doute parce que le spectacle a achevé de prendre la place de la représentation politique et sociale qu’il devient un enjeu collectif majeur et un terrain d’affrontement.
La politique moderne née au XVIIIe siècle a en effet durant des décennies articulé la notion de représentation politique à celle d’espace public. Alors que les dispositifs de représentation connaissent dans le monde des signes d’essoufflement manifestes, nous pouvons mesurer les effets de l’installation du spectacle sur l’espace public comme « usage public de la raison » (Habermas 1988)[40]. Privés de représentation par des pouvoirs « spectaculaires », les peuples, devenus « multitudes » (Negri, dans Hardt et Negri 2004) ou « singularités quelconques » (Agamben 1990) se cherchent des voies d’affirmation collective substitutives aux figures modernes de la politique. La mobilisation visuelle en fait partie.
Appendices
Notes
-
[1]
Observatoire des mobilisations visuelles (http://mobvisu.hypotheses.org/), consulté le 7 janvier 2015.
-
[2]
Consulté sur Internet (http://www.youtube.com/watch?v=tYyUYWS2D9Y), le 1er novembre 2013, non disponible en date du 27 octobre 2014.
-
[3]
TheMulticrisis (http://www.youtube.com/user/TheMulticrisis?feature=watch), consulté le 2 novembre 2013.
-
[4]
Protests in Sasolburg.mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=4mbABEvWXNU), consulté le 1er janvier 2015.
-
[5]
« In Egypt Muslim Brotherhood… » (http://www.youtube.com/watch?v=jw_OKBXPZ4M), consulté le 24 mars 2013. Compte clôturé depuis par YouTube.
-
[6]
GroundZeroMosque (http://www.youtube.com/user/GroundZeroMosque?feature=watch), consulté le 24 mars 2013. Compte clôturé par YouTube.
-
[7]
« Saqueo a superme... » (http://www.youtube.com/watch?v=DizkjGTtJSs), consulté le 7 décembre 2013, non disponible en date du 1er janvier 2015.
-
[8]
Canal DDC (https://www.youtube.com/channel/UCG_imeJUxwQZaaM8cIcfEcw), consulté le 5 janvier 2015.
-
[9]
Voir la vidéo (http://berthoalain.com/2013/06/07/tarif-des-transports-emeute-a-sao-paulo-6-juin-2013-avec-videos/), disponible en date du 7 juin 2013.
-
[10]
Occupy Sao Paulo, organisme communautaire (https://www.facebook.com/occupysaopaulo), ou #occupygezi (http://occupygezipics.tumblr.com/), et OccupyGezi Communauté (https://www.facebook.com/OccupyGezi), consultés le 26 février 2014.
-
[11]
Occupy Sao Paulo, organisme communautaire (https://www.facebook.com/occupysaopaulo), consulté le 26 février 2014.
-
[12]
OccupyGezi Communauté (https://www.facebook.com/OccupyGezi), consulté le 26 février 2014.
-
[13]
occupygezi (http://occupygezipics.tumblr.com/) et OccupyGezi Videos (http://occupygezivideos.tumblr.com/), consultés le 26 février 2014.
-
[14]
« Everyday I’m Capuling » (http://www.youtube.com/watch?v=64q2GIqH7S8), consulté le 26 février 2014, non disponible en date du 27 octobre 2014.
-
[15]
Alihan Olcar (http://www.youtube.com/channel/UCXOTTJIL6xzvnat-Hs2mWvw?feature=watch), consulté le 26 février 2014
-
[16]
« Anonymous – #OccupyGezi Revolution Song » (http://www.youtube.com/watch?v=Ai84-vkD0No), consulté le 27 février 2014.
-
[17]
Gezi Parki Icin (http://www.youtube.com/channel/UC0EBvkOHuAz5UnnW9fc83oA?feature=watch), consulté le 27 février 2014.
-
[18]
« Yorumsuz – Bestekar Sokak – Ankara » (http://www.youtube.com/watch?v=-hND9jXY-NI), consulté le 27 février 2014.
-
[19]
Can akyürek (http://www.youtube.com/user/nonamedisco?feature=watch), consulté le 27 février 2014.
-
[20]
VelychkovskyS (https://www.youtube.com/user/VelychkovskyS?feature=watch), consulté le 27 février 2014.
-
[21]
(https://www.youtube.com/user/mykolaovcharov?feature=watch), consulté le 27 février 2014.
-
[22]
« Pray for Ukraine » (https://www.youtube.com/user/nikolayovcharov/featured), consulté le 27 février 2014.
-
[23]
(https://www.youtube.com/user/euro2012ua?feature=watch), consulté le 27 février 2014.
-
[24]
Top Documentaries on YouTube : Ukraine Online (http://www.youtube.com/watch?v=4Efe4nfhmfg&list=UUfK5S0MutF6JnKQUbmBaxKQ), consulté le 27 février 2014.
-
[25]
Slava T (https://www.youtube.com/channel/UC7jVWm0t-rV03q2TO5q8wVg), consulté 27 février 2014.
-
[26]
Radio Svoboda (http://www.radiosvoboda.org/), consulté le 27 février 2014.
-
[27]
Radio Svoboda – Videos (https://www.youtube.com/user/RadioSvobodaOrg?feature=watch), consulté le 27 février 2014.
-
[28]
Espreso Tv (http://espreso.tv/), consulté le 27 février 2014. La capture d’écran de sources où l’image n’est pas optimale offrant une résolution insuffisante, une des figures fournies n’a pu être retenue.
-
[29]
occupygezi (http://occupygezipics.tumblr.com/), consulté le 26 février 2014.
-
[30]
« Homem aranha no protesto em São Paulo » (http://www.youtube.com/watch?v=X2yfxSrBSIQ), consulté le 27 février 2014.
-
[31]
« Istanbul Gas Boms, Istanbul Protest » (https://www.youtube.com/watch?v=KXnagULGS4s), consulté le 27 février 2014.
-
[32]
« Water Cannon Knocks Guy Flat 1 :25 Turkish Police BRUTALLY disperse Istanbul park demolition PROTEST » (https://www.youtube.com/watch?v=UlsFY2PVeRg), consulté le 27 février 2014.
-
[33]
« Manifestantes Quebram Vidros & Picham Prefeitura – São Paulo » (http://www.youtube.com/watch?v=bRszbHDHITs), consulté le 27 février 2014.
-
[34]
« Vandalos X Policia – Cavalaria, Bolas de borracha ! 19/06/2013 em FORTALEZA » (http://www.youtube.com/watch?v=2LJ2HuQwcJE), consulté le 27 février 2014.
-
[35]
« [EXCLUSIVE CAMERA AMATEUR VIDEO] Clashes between Riot Police and Protestors in Kiev Ukraine » (http://www.youtube.com/watch?v=dveHCdsNc88), consulté le 26 février 2014.
-
[36]
« Ukraine : Six morts à Kiev, la mairie incendiée » (http://www.youtube.com/watch?v=oKyl_WRObys), consulté le 26 février 2014.
-
[37]
Figure 6 : « Избиение полиции. Киев. Украина » (http://www.youtube.com/watch?v=nhWj68Lawpc), consulté le 26 février 2014.
-
[38]
Figure 7 : « Майдан прощається з героями » (https://www.youtube.com/watch?v=pkS2mP6BYEo) consulté le 26 février 2014.
-
[39]
Notamment Praviy Sektor, particulièrement présent et militarisé (http://konigsberg.eklablog.com/praviy-sektor-secteur-droit-le-parti-ultra-nationaliste-de-l-ukraine-a106676814), consulté le 27 février 2014, non disponible le 27 octobre 2014, ou Spilna Sprava, à l’origine de l’occupation de ministères.
-
[40]
L’espace public moderne obéit à deux règles : celle du caractère universel de la raison mobilisée et celle de l’indifférence à la personnalité de celui qui l’énonce. Son régime de vérité est vérifiable par tous. L’espace spectaculaire contemporain en a renversé les termes car la notoriété du locuteur l’emporte sur la règle de raison et sur la recherche de la preuve. Pour le spectacle du pouvoir, le casting l’emporte sur la documentation du discours. Pour le spectacle populaire le témoin l’emporte sur l’expert. La vérité n’est plus raisonnablement vérifiable, elle se montre.
Références
- Agamben G., 1990, La communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque. Paris, Éditions du Seuil.
- Appadurai A., 2001, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation. Paris, Éditions Payot.
- Bertho A., 2009, Le temps des émeutes. Paris, Bayard Éditions.
- Bertho A., 2010, « Les émeutes dans le monde en 2009 : ethnographie de la colère », La revue internationale et stratégique, 79 : 75-86.
- Bertho A., 2011, « De la colère au soulèvement » : 83-93, in P. Boniface (dir.), L’année stratégique 2012. Paris, Armand Colin.
- Bertho A., 2012, « Le protestataire, personnalité de l’année 2011 » : 89-101, in P. Boniface (dir.), L’année stratégique 2013. Paris, Armand Colin.
- Bertho A., 2013, « Soulèvements contemporains et mobilisations visuelles », Socio, 2 : 217-228.
- Bertho A. et S. Luret, 2010, « Les raisons de la colère » [film]. Paris, ARTE/Morgane production, 52 minutes.
- Boëx C., 2012, « Les usages de la vidéo dans la révolution en Syrie. Montrer, dire et lutter par l’image », Vacarme, 61 : 118-131.
- Boëx C., 2013, « La grammaire iconographique de la révolte en Syrie : Usages, techniques et supports » Cultures & Conflits, 91-92 : 65-80.
- Cardon D. et F. Granjon, 2013, Médiactivistes. Paris, Presses de sciences-po.
- Castells M., 2013, Communication et pouvoir. Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
- Cocco G., 2013, « A mídia da multidão é uma multidão de mídias », Entretien, Canal Ibase, 2 août, consulté sur Internet (http://www.canalibase.org.br/a-midia-da-multidao-e-uma-multidao-de-midias/), le 5 janvier 2015.
- Debord G., 1967, La société du spectacle. Paris, Éditions Bucher-Chastel.
- Gunthert A., 2009, « L’image partagée », Études photographiques, 24 : 182-209.
- Habermas J., 1988 [1962], L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Paris, Éditions Payot.
- Hardt M. et A. Negri, 2004, Multitude. Guerre et démocratie à l’âge de l’Empire. Paris, Éditions La Découverte.
- Riboni U.L., 2012a, « À bras levé », Window, carnet de recherche visuel, 1er octobre, consulté sur Internet (http://culturevisuelle.org/window/archives/10), le 5 janvier 2015.
- Riboni U.L., 2012b, « La vidéo amateur au journal télévisé : récupération et domestication », Actes des travaux du Comité de recherche (CR33) « Sociologie de la Communication ». Communication au Congrès de l’AISLF 2012, Rabat, 6-12 juillet 2012, consulté sur Internet (http://w3.aislf.univ-tlse2.fr/gtsc/activites.html), le 5 janvier 2015.
- Riboni U.L., 2013a, « The Other Witnesses : Filming Citizens from the Arab Uprisings ». Communication à la conférence « Visible Evidence », Stockholm University, Stockholm, Suède, 15-18 août.
- Riboni U.L., 2013b, « Filmer et mettre en ligne la révolution : les usages de la vidéo dans les “printemps arabes” ». Communication aux Journées doctorales du RT37 de l’AFS « Médias, engagements, et mouvements sociaux », Sciences Po Bordeaux, Centre Émile Durkheim, Université Bordeaux 3, MICA Bordeaux, 28-29 mars.
- Uysal A., 2013a, « Protesto halkı isyana teşvik eder mi ? Protesto eylemlerinin kaynağı olarak polis şiddeti », Birikim, 153 : 291-292.
- Uysal A., 2013b, « Démocratie et dialogue sont en panne : la rue comme espace de la participation politique (Exemple des protestations de “GEZI”, Istanbul) », Colloque « Dialogue, Vérité et Démocratie », Centre international des sciences de l’homme, Byblos, 4-6 décembre.
- Alihan Olcar (http://www.youtube.com/channel/UCXOTTJIL6xzvnat-Hs2mWvw?feature=watch), disponible le 27 octobre 2014.
- « Anonymous – #OccupyGezi Revolution Song » (http://www.youtube.com/watch?v=Ai84-vkD0No), disponible le 27 octobre 2014.
- Can akyürek (http://www.youtube.com/user/nonamedisco?feature=watch), disponible le 27 octobre 2014.
- Canal DDC (https://www.youtube.com/channel/UCG_imeJUxwQZaaM8cIcfEcw), consulté le 5 janvier 2015.
- Espreso Tv (http://espreso.tv/), disponible le 27 octobre 2014.
- « Everyday I’m Capuling » (http://www.youtube.com/watch?v=64q2GIqH7S8), non disponible le 27 octobre 2014.
- « [EXCLUSIVE CAMERA AMATEUR VIDEO] Clashes between Riot Police and Protestors in Kiev Ukraine » (http://www.youtube.com/watch?v=dveHCdsNc88), disponible le 27 octobre 2014.
- Gezi Parki Icin (http://www.youtube.com/channel/UC0EBvkOHuAz5UnnW9fc83oA?feature=watch), disponible le 27 octobre 2014.
- GroundZeroMosque (http://www.youtube.com/user/GroundZeroMosque?feature=watch), non disponible le 27 octobre 2014.
- « Homem aranha no protesto em São Paulo » (http://www.youtube.com/watch?v=X2yfxSrBSIQ), disponible le 27 octobre 2014.
- Николай Овчаров, « Pray for Ukraine » (https://www.youtube.com/user/nikolayovcharov/featured), disponible le 27 octobre 2014.
- « In Egypt Muslim Brotherhood… » (http://www.youtube.com/watch?v=jw_OKBXPZ4M), non disponible le 27 octobre 2014.
- « Istanbul Gas Boms, Istanbul Protest » (https://www.youtube.com/watch?v=KXnagULGS4s), disponible le 27 octobre 2014.
- « Manifestantes Quebram Vidros & Picham Prefeitura – São Paulo » (http://www.youtube.com/watch?v=bRszbHDHITs), disponible le 27 octobre 2014.
- « Майдан прощається з героями » (https://www.youtube.com/watch?v=pkS2mP6BYEo), disponible le 27 octobre 2014.
- Микола Овчаров (https://www.youtube.com/user/mykolaovcharov?feature=watch), disponible le 27 octobre 2014.
- « Избиение полиции. Киев. Украина » (http://www.youtube.com/watch?v=nhWj68Lawpc), non disponible le 27 octobre 2014.
- Occupy Sao Paulo, organisme communautaire (https://www.facebook.com/occupysaopaulo), disponible le 27 octobre 2014.
- #occupygezi (http://occupygezipics.tumblr.com/), disponible le 5 janvier 2015.
- OccupyGezi Communauté (https://www.facebook.com/OccupyGezi), disponible le 27 octobre 2014.
- OccupyGezi Videos (http://occupygezivideos.tumblr.com/), disponible le 27 octobre 2014.
- Praviy Sektor (http://konigsberg.eklablog.com/praviy-sektor-secteur-droit-le-parti-ultra-nationaliste-de-l-ukraine-a106676814), non disponible le 27 octobre 2014.
- Protests in Sasolburg.mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=4mbABEvWXNU), disponible le 27 octobre 2014.
- Руслан Горовий (https://www.youtube.com/user/euro2012ua?feature=watch), disponible le 27 octobre 2014.
- Radio Svoboda – Videos (https://www.youtube.com/user/RadioSvobodaOrg?feature=watch), disponible le 27 octobre 2014.
- Radio Svoboda (http://www.radiosvoboda.org/), disponible le 27 octobre 2014.
- « Saqueo a superme... » (http://www.youtube.com/watch?v=DizkjGTtJSs), non disponible le 1er janvier 2015.
- Slava T (https://www.youtube.com/channel/UC7jVWm0t-rV03q2TO5q8wVg), disponible le 27 octobre 2014.
- « Tarif des transports : émeute à Sao Paulo – 6 juin 2013 – avec vidéos » (http://berthoalain.com/2013/06/07/tarif-des-transports-emeute-a-sao-paulo-6-juin-2013-avec-videos/), disponible le 27 octobre 2014.
- TheMulticrisis (http://www.youtube.com/user/TheMulticrisis?feature=watch), disponible le 27 octobre 2014.
- Top Documentaries on YouTube : Ukraine Online (http://www.youtube.com/watch?v=4Efe4nfhmfg&list=UUfK5S0MutF6JnKQUbmBaxKQ), disponible le 27 octobre 2014.
- « Ukraine : Six morts à Kiev, la mairie incendiée » (http://www.youtube.com/watch?v=oKyl_WRObys), non disponible le 27 octobre 2014.
- « Vandalos X Policia – Cavalaria, Bolas de borracha ! 19/06/2013 em FORTALEZA » (http://www.youtube.com/watch?v=2LJ2HuQwcJE), disponible le 27 octobre 2014.
- VelychkovskyS (https://www.youtube.com/user/VelychkovskyS?feature=watch), disponible le 27 octobre 2014.
- « Water Cannon Knocks Guy Flat 1 :25 Turkish Police BRUTALLY disperse Istanbul park demolition PROTEST » (https://www.youtube.com/watch?v=UlsFY2PVeRg), disponible le 27 octobre 2014.
- « Yorumsuz – Bestekar Sokak – Ankara » (http://www.youtube.com/watch?v=-hND9jXY-NI), disponible le 27 octobre 2014.
Sources électroniques
List of figures
Figure 1
Page d’accueil de #occupygezi
Figure 2
Spiderman à Sao Paulo, 18 juin 2013
Figure 3
« Istanbul gas boms, Istanbul protest », 2 juin 2013
Figure 4a et 4b
Images tirées de « Water cannon knocks guy flat… », YouTube, 31 mai 2013
Figure 5
« Clashes between riot police and protestors in Kiev… », 18 février 2013
Figure 6
Hommage aux victimes #occupygezi
Figure 7
L’hommage aux victimes de RadioSvoboda sur la chaîne YouTube