Abstracts
Résumé
Tristesse, un zine lancé en 2017, permet de porter un autre regard sur les modes d’engagement et de mobilisation des revues, comme il réussit à donner à « l’extrême-intime » un poids politique. Tristesse ne s’oppose pas à un groupe ou à une idéologie, ne formule aucune revendication, ne cherche pas quelque avancement. Bien au contraire, Tristesse est une revendication qui refuse d’en être une et se fait ainsi le revers d’une tradition intellectuelle qui n’en a pas pour autant moins de portée; il semble se vouloir, par ses voix essayistiques qui sont « en tristesse » (comme on dit en amour ou en colère), une avenue pour penser et (accepter d’)exister autrement. Cet article présente la synthèse des intentions des fondatrices, expliquées davantage lors d’un entretien. Il analyse brièvement l’esthétique de la revue et tente d’indiquer sa portée rhétorique.
Abstract
The zine Tristesse (2017) offers a different perspective on the modes of engagement and mobilization usually associated with literary journals as it shows the political potential of “the extreme intimate”. Tristesse does not oppose a group or an ideology, does not make any demands, nor seeks some sort of social progress. On the contrary, Tristesse is a claim that refuses to be presented as such and thus can be viewed as opposing the intellectual tradition shaped by so many literary journals. Tristesse publishes essayistic voices that are “in sadness” (as we say in love) which mark out an avenue for thinking and existing differently. This article presents the synthesis of the founders’ intentions, analyzes briefly the aesthetics of the journal, and attempts to show its argumentative potential.
Article body
Une confession avant toute chose : je me suis récemment découverte plus que nostalgique, en manque presque, de la large diffusion de périodiques qu’on aime attraper au hasard dans ces kiosques de revues, ces Maison de la presse et autres stands de librairies, disparus progressivement alors qu’on se disait que ce n’était pas si grave, qu’il y avait toujours les abonnements, qu’on trouverait d’autres moyens de découvrir ce qu’on ne connaît pas. Longtemps les bibliothèques universitaires ont pu répondre à mes envies. Depuis quelques années, les maigres étalages de trucs en papier glacé près des caisses des magasins à grande surface semblent me narguer et tester ma patience. Une autre confession, plus délicate cette fois, car elle relève non pas d’un rapport au passé mais en quelque sorte d’un rapport à l’avenir, et tient à un constat d’impuissance : même si la contre-culture[1] a continué de faire l’objet de publications et de discussions dans les milieux universitaires et culturels, je m’interroge quant à sa capacité à atteindre son but, qui est d’influencer la réflexion sociale et le débat public (Pagé, 2014). Comment aujourd’hui la Coopérative Coup D’Griffe[2] par exemple et les différents zines[3] –faits artisanalement, « sans prétention », en décloisonnant les pratiques, en croisant les sciences politiques et sociologiques comme les études médiatiques et littéraires, mais en étant diffusés hors des circuits traditionnels– peuvent-ils conjuguer influence sociale et destination aux happy few? Miser sur la clandestinité, mais participer de temps à autre à Expozine[4], est-ce suffisant?
Malgré ces considérations quelque peu pessimistes, il reste que ces parutions détiennent un pouvoir certain : celui de la parole autre, celui de la déstabilisation. Je veux aborder ici une toute nouvelle revue, Tristesse, fondée en 2018. Ce zine, malgré les expositions, salons, tables rondes, listes de diffusion et médias sociaux, a été porté à mon attention par une amie et collègue, comme quoi le succès de ce type de parutions, ces « toujours-nouvelles-revues » qu’on espère voir s’inscrire dans la durée, s’appuie en bonne partie sur le bouche à oreille. À la suite de la lecture des trois premiers numéros parus à ce jour, je dois confesser, encore, ma fascination et ma perplexité. Fascination pour une mise en page léchée, pour des voix intimes et fortes. Mais perplexité surtout devant ce type de prise de parole malgré mon intérêt sincère. Oui, pour moi, l’idée de fonder une revue est nécessairement associée à un engagement – littéraire, artistique, politique au sens large –, au désir d’occuper une place dans le champ culturel, soit parce qu’elle a été laissée vacante, soit parce qu’on ressent le besoin de remodeler l’espace intellectuel, souvent à grands coups de coude[5]. Pour moi, une nouvelle revue s’inscrit dans une filiation, avec ou contre quelque chose. Je suis malheureusement assez binaire, mais j’essaie d’apprendre à penser autrement, comme le veut d’ailleurs l’invitation forte de ces publications. Je tenterai donc d’exposer ici comment Tristesse peut contribuer à la structuration générale de la vie intellectuelle québécoise, d’une part, par la présentation des intentions des fondatrices et, d’autre part, par une analyse de l’esthétique de la revue. Cet article offrira en conclusion des pistes de réflexion quant à la portée rhétorique de la pratique essayistique d’une revue qui dit ne pas rechercher d’oeuvres de fiction, mais plutôt des contributions « relevant du genre de l’essai (au sens le plus large du terme) ainsi que des arts visuels[6] ».
L’élan premier
Contrairement à la plupart des revues intellectuelles, nul texte d’intention ne présente clairement le projet ou la situation de Tristesse dans le champ littéraire, si ce n’est une transcription d’un dialogue amical qui loge à la fin du premier numéro, dans les pages roses. On y comprend que la revue ne soutient pas un projet particulier, comme l’annonçait le féminisme de Françoise Stéréo par exemple; elle ne s’oppose pas à un groupe ou à une idéologie, ne formule aucune revendication, ne cherche pas quelque avancement. Bien au contraire, Tristesse est une revendication qui refuse d’en être une; elle apparaît, avec son esthétique du zine, avec la place laissée aux émotions au détriment de « l’esprit », avec des voix qui font résonner les théories du care, comme un spin-off de revues littéraires devenues canoniques. Elle se fait ainsi le revers d’une tradition intellectuelle, mais n’en a pas pour autant moins de portée; elle semble se vouloir, par ses voix essayistiques qui sont « en tristesse », « comme nous pouvons être en amour, en colère ou en deuil » (Delporte, 2017-2018 : 40), une avenue pour penser et (accepter d’)exister autrement. En somme, elle n’énonce pas explicitement ces intentions, mais elle parle, elle existe. Et qui le veut finit bien par comprendre. Un peu.
Puisque j’aime les choses claires, je suis allée au-devant de l’équipe fondatrice pour cerner davantage les intentions de départ du projet. À la suite de cet entretien qui s’est tenu en différents lieux, il est possible de préciser ce que présentait la correspondance entre Daphné B. et Julie Delporte citée dans le paragraphe précédent. Lors d’une récente table ronde au CRILCQ[7], Marie Saur, l’une des fondatrices de Tristesse, a mentionné avec désinvolture un aspect de l’entreprise du périodique qui paraît assez fondamental : « Tout est fait à la maison, entre amies; si on n’était plus amies, on arrêterait, je pense. » C’est dire que cette communauté se tisse bien peu en fonction d’un dehors immédiat ou d’une pensée historique. Il semble plutôt que ce dehors, s’il motive cette prise de parole commune, opère par une intériorisation des contraintes qui ont percolé et se sont accumulées par atavisme. À l’origine, les fondatrices (Julie Delporte, Rosalie Lavoie, Catherine Ocelot, Marie Saur et David Turgeon), avaient surtout envie de « faire des trucs ensemble ». Occupées par le quotidien, par leurs pratiques artistiques, elles avaient conscience, en tant que femmes, de devoir protéger leur travail personnel et ne pas se trouver encore à s’en détourner au profit de quelque projet collectif. Et puis après le discours de Delporte lors de l’inauguration de la librairie féministe L’Euguélionne, avec David Turgeon qui cherchait un moyen de rendre lisible un tableau de féminisation « totale » du français établi par un grammairien du xixe siècle, et alors que le salon Expozine de l’année 2017 approchait, elles ont compris que c’était comme ça que pourrait se faire la revue, c’est-à-dire de la façon la plus libre possible, sans rubriques, sans dossier, dans un réseau indépendant et une fois par an seulement, une périodicité qui est rapidement devenue semestrielle.
Par rapport aux autres revues, Tristesse ne cherche pas à définir sa situation. Sa condition « économico-professionnelle » la place à l’écart : elle est une revue d’amatrices, dont les ventes ne servent qu’à payer l’impression et la location d’une table pour présenter la revue à Expozine. Il n’y a pas d’abonnements, pas de diffuseur, et le tirage est infinitésimal. Les fondatrices ont tout de même voulu faire quelque chose d’inédit et c’est ainsi que la revue est perçue. Elles estiment que le matériel publié ne pourrait pas paraître dans d’autres revues, ce qui a d’abord été « un état de fait » avant de devenir une ligne éditoriale : « […] pas de nouvelles, une seule poétesse par numéro, des essais qu’on pourrait difficilement comparer à des articles, des bandes dessinées étranges ». Malgré et par ce pas de côté, elles assument résolument l’appellation « revue ». Tristesse a rapidement été reconnue sur les réseaux sociaux par des revues comme Liberté, Lettres québécoises, Estuaire, Moebius, par intérêt sincère de leur part parce que Tristesse leur paraît libre et neuve. Aussi, face à ces dernières, Tristesse ne prétend pas empiéter sur le terrain des revues institutionnelles, ni même en faire la critique en prenant quelque contre-pied : « Nous aimons bien ne pas jouer au sport masculin de la concurrence. Il y a aussi peut-être et surtout une solidarité féminine au centre de tout. Nous avons d’ailleurs été associées plusieurs fois dans la presse, car dirigées par des femmes et ça nous va bien. » Il faut quand même remarquer que cette reconnaissance et cette affection pour Tristesse s’appuient sur des relations d’amitié et de collaborations professionnelles et artistiques avec des autrices des revues mentionnées plus haut, un réseau confirmé par le fait que celles-ci publient aussi dans Tristesse.
Catherine Ocelot, cofondatrice, estime qu’au-delà de la confidentialité du cercle des amis, le lectorat visé était certes, initialement, les visiteurs et visiteuses d’Expozine, mais aussi ceux et celles qui, simplement, achètent des livres et des revues. Après le lancement du premier numéro, les librairies Drawn and Quarterly, Le Port de tête et L’Euguélionne sont reparties avec les restes du tirage. Dès le départ, il y a eu un intérêt, ce qui était un peu attendu puisque les artistes et les intellectuelles publiées avaient déjà un lectorat et un public fidèles. La bonne réception s’expliquerait, selon Marie Saur, par le fait que la revue fait écho à des discours dans l’air du temps. Bien qu’au bout d’un moment, plus personne ne fait attention à ce que le titre d’une revue veut vraiment dire, il reste que le mot Tristesse a semblé représenter l’état d’esprit idéal, avec des sonorités parfaites pour un titre de revue, très « féminine ». Sans que ce soit un « thème imposé », une bonne part des collaborations illustrent ce que le premier texte des pages roses indiquait, c’est-à-dire l’art de « tomber en tristesse ».
Bref examen de l’esthétique de la revue
Cet art de « tomber en tristesse » m’est toutefois apparu, lors de ma première fréquentation de la revue, comme la mise en forme d’une impasse. Les couvertures des trois premiers numéros (figure 1), illustrées respectivement par Catherine Ocelot, Mirion Malle et Sara Hébert, par photo, dessin, collage, indiquent dans des décors plutôt urbains la fatigue, la peine et l’égarement de femmes qui deviennent véritablement des sujets par l’expression de ces émotions.
Figure 1
Une mise en page surprenante, efficace et, oui, satisfaisante à la fois par la disparition des poses et des postures trop souvent édifiées et valorisées par les publications. Tristesse, la revue comme l’émotion, annonce un fonds à explorer et surtout à accepter; il ne s’agit pas seulement de refuser l’impératif « souris, tu seras plus jolie », mais bien de révéler un mode cognitif par l’émotion, un rapport au monde qui n’a pas à se moduler et encore moins à s’excuser.
Il reste que, dans le dialogue entre Daphné B. et Julie, on explique : « La jeune fille triste n’est pas nostalgique – ou alors elle l’est d’un futur qui ne vient jamais » (Delporte, 2017-2018 : 40.). Cette phrase, comme bien d’autres explications de l’horizon de la revue, se laisse d’abord lire comme une abdication, un espoir non poursuivi, une impuissance acceptée. Si les fondatrices expliquent dans leur échange les dangers de l’impératif du bonheur et leur épuisement devant celui-ci, elles affirment qu’être triste est « un morceau de guérison », « une façon d’être vivante » (Ibid. : 38). Il s’agit certes là d’une façon de combattre le concept d’optimisme cruel[8], mais il reste qu’elles ne manquent pas d’illustrer à quel point le deuil – les deuils – constitue la figure de l’éternel retour, qui ramènerait immanquablement au désir, puis au désenchantement, puis au deuil encore. On peut de moins en moins imaginer Sisyphe heureux.
C’est en se glissant doucement et patiemment dans l’univers de Tristesse qu’on saisit la nuance révélatrice qui peut avoir ce commentaire comme emblème : « Et pleurer, ce serait voir l’ampleur du travail, plutôt que de baisser les bras. Cela ne veut pas dire que nous cessons d’être joyeux.ses. Mais nos joies cohabitent avec la tristesse, puisqu’en permanence nous savons » (Delporte, 2017-2018 : 40). La tristesse se fait donc le signe d’une connaissance et d’un mode de travail. C’est d’ailleurs ce qui ressort clairement des discussions qui exposent les vues de l’équipe :
Si l’on se place du point de vue de la prise de conscience féministe (qui serait une des sources, mais non la seule, à irriguer la revue), et ceci apparaissait quand nous en discutions avec Julie Delporte ou Catherine Ocelot (qui évoluent dans un domaine artistique plutôt hostile aux femmes et à la différence esthétique), la colère semblait beaucoup plus paralysante, au moins pour la personne qui l’éprouve, et menait vite à la confrontation dure, donc à l’épuisement de la femme en colère. La tristesse apparaissait comme une issue, pour ne pas perdre de vue l’état du monde, tout en continuant de créer. La tristesse est peut-être une voie parallèle, une voie qui peut paraître hors de la réalité et des productions constructives […][9].
Lors des premières discussions de l’équipe, les émotions et les pleurs ont été souvent (et passionnément) pensés comme une libération par rapport aux sentiments qu’inspire le monde, une « alternative presque heureuse, face à des situations qui ne changent pas, des personnes qui ne veulent pas entendre ce que d’autres ont à leur dire. Là où la colère épuise, où le sentiment d’impuissance et la fatigue font se taire, se retirer, la tristesse permet de continuer[10] ».
Choisir la tristesse serait donc une sorte d’engagement envers le monde dans la mesure où elle permet à la créatrice de se remettre au centre de sa création et de se projeter ensuite de la sorte : « Elle ne s’efface plus derrière son propos ni son combat, elle s’accepte comme triste. Si on schématise, pleurer lui fait du bien et alors ce sera son oeuvre[11] ». Ce serait ces progressions en mineur – c’est-à-dire ces avancées dans le monde, ces mises en discours de soi proposées dans des tonalités tristes et auxquelles, disons-le, les revues d’idées nous ont bien peu habitués – qui constitueraient, par leur possibilité même, la force et le pouvoir de Tristesse. Si une revue, par sa simple création, est nécessairement et implicitement une forme d’engagement, il reste que la voix de Tristesse est de fait la marque de son engagement.
Le désir initial était d’accorder une attention très importante aux participantes, de créer un espace accueillant, qui tient un peu du laboratoire et qui donne envie de s’exprimer, un espace de parole qui s’inspire des « méthodes féministes d’accueil et d’écoute de l’autre ». Le désir était aussi de « mélanger » des participantes issues de champs professionnels et artistiques différents (de la bande dessinée à la poésie, ou à la performance), touchant aussi à des degrés de légitimité divers (issues du fanzinat ou de l’université). L’engagement de Tristesse, s’il fallait le dire en un mot, est de l’ordre de la bienveillance.
Et cela se trouve dans la possibilité de dire. Car tout y est admissible; s’y trouve un lieu où l’écriture se fait pour soi, dans le plaisir immédiat, semble-t-il, et non pas reportée vers une finalité[12]. Cette écriture pour soi, dans le plaisir immédiat, se laissait deviner dès le premier numéro dans la division des pages. Pages blanches, pages roses : les premières accueillant plutôt les contributions visuelles, des textes proches de la lettre et de la réflexion intime; les secondes, des textes davantage essayistiques, de fiction-réflexion. Les deux numéros suivants brouillent cette esquisse : pages roses avec dessins et poèmes, pages blanches avec de longs commentaires littéraires. Il reste qu’en revenant sur les lectures (la critique cherche toujours son fil de trame) se trouve une cohérence, et se met à exister une telle chose qu’une revue d’idées qui passerait par la fiction, le jeu de la pensée qui peut exploiter (au sens noble) les émotions. Un texte signé « La Rédaction » (figure 2) recense quelques films de Rohmer pour présenter des « Scènes du consentement actif » ([La Rédaction], 2018 : 25).
Figure 2
Reproduction du texte « Scènes du consentement actif », tiré du zineTristesse, no 2 (2018), p. 25.
En saisissant des scènes de Conte de printemps, L’ami de mon amie et Le rayon vert, on montre des « Françaises ordinaires […] qui disent oui ou non aux hommes (lesquels font de même), peu importent les indécisions que font naître l’amour balbutiant, la fin d’une histoire. On peut hésiter, changer d’avis, ça n’empêche pas de savoir ce que l’on veut dans l’instant. Si le oui arraché ne mène à rien, c’est qu’il n’est en réalité pas très romantique, tandis qu’un oui spontané… » (Ibid.). L’ensemble est descriptif, photos en soutien. Comme si tout commentaire avait été superflu, l’analyse aussi bien que le commentaire politique appartient au lecteur.
Il en va de même de deux textes de Catherine Ocelot, « Savoir vivre » dans le numéro 2, et « Gentillesses » dans le numéro 3. Ces découpages du quotidien, ces instantanés de vie qu’on pourrait trouver sur Facebook, sont divertissants comme peut l’être un « fil d’actualités », mais l’accumulation en fait une critique assez tranchante du consumérisme :
Une amie est taguée sur une photo montrant une gigantesque quantité de homards disposés sur un plat de service somptueux. Deux heures plus tard, elle est retaguée, cette fois sur la photo d’une chambre d’hôtel luxueuse à Mont-Tremblant, avec la légende : ‘Repos pour le weekend’. // Lors d’un voyage en Suède, un chroniqueur se prend en photo en train de manger un sandwich au poisson. Il dit qu’il va le savourer parce que le sandwich lui a coûté 40 $. // Une ancienne collègue met sa maison en vente et partage le lien sur internet. Elle est située dans Rosemont et coûte 595 000 $. […] // Un bon ami à moi vit, depuis quelques mois, une période difficile. Rupture, parents malades, deuils, les coups durs s’enchaînent. Travailleur autonome, sans assurances […] son revenu annuel tourne autour de 15 000 $. Je l’ai toujours senti solide mais ces jours-ci il est déprimé, il commence à m’inquiéter. Je lui ai donné le numéro de ma psy, je suis certaine qu’elle pourrait l’aider. // Elle charge 115 $ de l’heure.
Ocelot , 2018 : 7
Sur le même ton, les « Gentillesses », parmi trente-cinq civilités, laissent tomber quelques bombes :
Ocelot, 2018-2019 : 17Parler à son animal de compagnie
Faire un café à son conjoint ou sa conjointe avant de faire le sien.
Prendre le temps de bien cuisiner, recevoir chaleureusement.
-Réparer les portes défoncées, les trous dans les murs, camoufler les bleus.Mettre des fleurs et des plantes sur le balcon.
Toujours dire bonjour aux sans-abris […]
-Ne pas porter plainte pour voies de fait.
La même douceur violente, qui travaille le pouvoir de la naïveté, se trouve dans les contributions visuelles. Le registre est large. Les dessins de Mirion Malle (2017-2018), « Je pleure tout le temps », illustrent les trop-pleins et la dépossession, les larmes qui débordent et le vide intérieur (figure 3).
Figure 3
Dessins « Je pleure tout le temps » de Mirion Malle (2017-2018), Tristesse, no 1, p. 34-35. À gauche : détail d’un dessin.
Leur présentation sans détour, sans atténuation, oblige le lecteur à leur reconnaissance, les fait exister dans le discours social et transforme ces émotions en réalités pensables.
À l’autre bout du registre, il y a les « Aventures de Jacques, la saucisse sensible » (Hébert, 2018-2019 : 41) (figure 4).
Figure 4
Collage « Les aventures de Jacques… » par Sara Hébert (2018-2019), Tristesse, no 3, p. 41-48.
Ces collages années’70 de Sara Hébert, qui semblent inaugurer dans le dernier numéro un collage-feuilleton avec le convenu « à suivre », travaillent l’humour et le malaise en présentant les espoirs amoureux qu’entretient Jacques à l’égard de Sandra. Il se demande si elle l’aime « pour vrai ». Son ami Paul au téléphone lui conseille de l’appeler et de lui demander. Sage conseil. Sandra accueille son appel sans sourire avec un : « Allo pitou. J’ai une infection à levures. […] Ça ou une ghono. » Jacques pose quelques questions pour mieux se faire répondre par Sandra : « Je sais pas. J’ai trop faim pour penser. D’ailleurs je me suis fait un GROS sandwich. » S’ensuit une page d’absurdités autour dudit sandwich, puis on voit Jacques, recroquevillé dans son lit, qui marine dans son monologue intérieur : « Pourquoi chu jamais capable d’y dire Je t’aime // Chu un gros cave // Est ben trop cool pour moi ». Il refuse de prendre l’appel de Paul parce qu’il « rushe trop » (Ibid. : 47-48). Il y aurait ici à explorer des parentés avec des revues féministes des années 1970, parentés esthétiques et discursives, humoristiques et rhétoriques, comme dans Les Têtes de pioche, une revue en marge des médias traditionnels qui a fait suite à Québécoises deboutte! Il reste que, dans Tristesse, en 2018-2019, montrer le renversement des castings de genre (la femme nonchalante, dégagée; l’homme troublé, empêtré dans ses sentiments, voire dépendant affectif) par un recours au kétaine, ajoute un niveau d’humour, comme si la dénonciation elle-même, rendue obsolète, surprenait maintenant et, de ce fait, provoquait le rire.
En guise de conclusion : quelle portée?
Tristesse est une jeune revue; il serait présomptueux de proposer déjà une évaluation de la portée rhétorique de ses contributions ou de sceller quelque verdict définitionnel de la globalité de l’entreprise. Si Delporte confiait : « Je crois que j’écris pour comprendre » (Delporte, 2017-2018 : 39), il convient de dire, tautologiquement, que Tristesse se fait au fil des numéros, mais ce serait une erreur, je crois, d’estimer qu’au fil des numéros se préciserait ou se raffinerait le projet. L’intention de Tristesse est claire : montrer que les émotions, comme la tristesse, la mélancolie, la nostalgie, etc., peuvent fournir un mode de cognition, peuvent être une façon d’aborder et de travailler le monde. En cela tient l’engagement de la revue à travers son refus même d’en formuler un. Car l’engagement est ce qui vise une transformation socioculturelle, c’est-à-dire ce qui permet à ce qui crée la surprise intellectuelle – que ce soit une revendication explicite ou, comme c’est le cas ici, l’exposition, l’utilité, l’efficacité d’un ton du discours – de devenir une part intégrante du discours social. Cette opération requiert pour une oeuvre – et c’est mon parti pris qui renvoie aussi au pessimisme exposé en introduction au sujet de la confidentialité de la contre-culture – d’être lue comme un facteur, un procédé, un modèle de transformation. Pour être lue comme telle, deux éléments sont nécessaires.
Le premier est le temps. Et j’avancerais que plus la surprise intellectuelle est grande, plus le temps requis pour opérer est long. Je crains, bien que j’espère que ce ne soit pas le cas, que Tristesse n’arrive à sa fin avant d’arriver à ses fins (reconfigurer la portée de la tristesse et en réviser la légitimité en serait-elle une?) pour la malheureuse raison que la critique est lente à comprendre, disais-je plus haut en note, que les oeuvres les plus durables sont celles qui savent jouer avec la faiblesse de cette dernière, c’est-à-dire le besoin de rendre les choses claires, les idéaux explicites, les transformations nécessaires visées directement. Pour dépasser cette crainte, disons simplement que le fait de la mentionner ici porte l’espoir que la chose sera entendue comme un défi et que, conséquemment, elle ne s’avérera pas.
L’autre élément, plus important celui-ci, est la qualité de la surprise intellectuelle, le contenu autre que propose une oeuvre. S’il fallait retenir quelque chose de cette étude, ce serait une invitation à lire Tristesse comme une revue d’idées. La revue, qui dès le départ ne cherchait pas à publier des oeuvres de fiction, mais plutôt des contributions « relevant du genre de l’essai (au sens le plus large du terme) ainsi que des arts visuels », est de toute évidence une revue de création. Même si elle refuse de formuler quelque revendication, la place qu’elle réserve aux émotions au détriment de l’esprit fait de celles-ci non seulement des objets de pensée, mais aussi une voie oblique vers la reconsidération des rapports sociaux et du politique. Il n’est pas question par cette lecture de tirer la démarche créative du côté de la critique ni de gommer à la base de l’entreprise l’amitié, le plaisir et les émotions partagées. Il s’agit plutôt de reconnaître dans la grande liberté que s’accordent (et qu’accordent) les fondatrices de Tristesse un espace de pensée trop peu exploré par la tradition critique. Ce revers est un autre mode de fonctionnement : penser par le corps, par les émotions. On le fréquente dans certaines oeuvres (Ernaux, Mavrikakis et, récemment, Dupuis-Morency) souvent comme un thème ou une explication. Ici, ce mode de pensée point par sa forme même. C’est une permission littéraire que le champ socioculturel au Québec mériterait d’explorer davantage, à la suite des revues féministes québécoises des années 1970 et 1980, comme voie d’accès renouvelée vers l’engagement.
Car l’art engagé, disons traditionnel si une telle appellation est permise, suppose une sortie hors du champ artistique si, dans le but de dénoncer, on exploite les dispositifs de la représentation (du réel) ou de l’intervention (dans le réel). La rhétorique discursive aussi bien qu’esthétique de Tristesse maintient la démonstration – l’argumentation – dans le champ artistique, dans sa logique propre. Car tel que le pose Aline Caillet,
Caillet, 2004[…] écrire n’est pas lutter, représenter n’est pas capturer, dénoncer n’est pas résister, apostropher n’est pas interagir.
Renouer avec un art « politique », faire un art en prise avec le monde social et politique, habiter un réel chaotique, contradictoire et tenter par son intervention-situation d’en modifier la trajectoire appellent donc une sortie, définitive, de sa représentation, et paradoxalement la fin d’un combat : cesser de l’affronter, pour, en son coeur, lui résister.
Être au coeur du politique, donc, y exister, voire le hanter d’une certaine manière, devient une façon de résister. Il s’agit d’exister artistiquement et non pas de s’imposer, avec tout ce que cela suppose de force et de fulgurance, en refusant de se mouler aux impératifs (du bonheur et de l’optimisme, entre autres) pour ainsi mieux coller au réel, l’informer « pour non pas le redoubler, mais le doubler » (Ibid.).
Cette revue qui permet d’être autrement a l’avantage, voire la force de ne rien demander. Elle est différente sans être en opposition. Exit les rapports de force, exit par extension les contingences de la réussite. Tristesse offre un modèle. Elle n’attend pas de réponse.
Appendices
Note biographique
Anne Caumartin est professeure agrégée au Département des humanités et des sciences sociales du Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle est membre régulière du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) et des comités de rédaction des revues Mens et Recherches sociographiques. Ses travaux portent sur l’essai et le roman québécois et abordent la conception de la culture québécoise, les modalités de filiation, la notion de responsabilité en littérature et les relations entre mémoire et perspectives d’avenir.
Notes
-
[1]
Pour mieux situer la pratique des zines dans l’univers contre-culturel, on pourra consulter Élise Lassonde, « La mémoire des zines : nouvelles déclinaisons de l’édition contre-culturelle », Liberté, 2013, p. 21.
-
[2]
Coup D’Griffe est une coopérative montréalaise fondée en 2012. Elle vise la collaboration d’artistes et de travailleurs autonomes des univers de la musique, de l’édition et de la création de matériel promotionnel en offrant autant un lieu à partager pour du travail indépendant que des ateliers d’initiation à la sérigraphie.
-
[3]
Les zines sont des publications autoéditées à petit tirage et faites de façon artisanale. Ils sont constitués de textes et d’images et travaillent l’esthétique du bricolage dans l’esprit de la contre-culture. Ludiques et/ou engagés, les zines misent sur un lien quasi familier entre les créateurs et les lecteurs.
-
[4]
Expozine est une foire annuelle tenue à Montréal depuis 2002, qui se présente comme l’un des plus importants salons de la presse en Amérique du Nord, avec près de 300 vendeurs et créateurs qui offrent leurs publications en français et en anglais à quelque 15 000 visiteurs.
-
[5]
La section « Zines, magazines et revues : esquisse des liens » du mémoire de maîtrise d’Izabeau Legendre consacré à la position du zine montréalais dans le champ culturel expose bien le difficile rôle endossé par ces productions. L’émergence d’une scène du zine au tournant des années 1990-2000 se fait dans une sorte de flottement, que ce soit dans la forme, adoptant les conventions tantôt du magazine, tantôt de la revue spécialisée, ou dans le contenu, par des discours ludiques volontairement hors champ ou par un dialogue soutenu avec l’époque (Legendre, 2020 : 25-27).
-
[6]
Le site de la revue indique cette précision dans l’appel à contributions : https ://tristesse.ca/apropos.
-
[7]
Colloque « Décentrements : les communautés de la littérature québécoise contemporaine », CRILCQ – Université de Montréal, le 9 mai 2019. (Les passages qui suivent, entre guillemets mais sans renvois de note, font référence à des conversations qui ont eu lieu lors de cette table ronde ou par courrier électronique.)
-
[8]
Lauren Berlant (2011) théorise l’affect en présentant le concept d’optimisme cruel qui explique que nous puissions désirer quelque chose qui freine notre épanouissement. Avec Tristesse, il s’agit en quelque sorte de voir les choses à l’inverse : en travaillant une émotion acceptée généralement comme négative, arriver à son épanouissement.
-
[9]
Courriel signé Marie Saur, le 13 mai 2019.
-
[10]
Ibid.
-
[11]
Ibid.
-
[12]
Cela est admirable, mais aussi impossible à décrire. Ouvrons ici une parenthèse : si j’avais une prophétie à faire, ce serait que Tristesse court le risque d’être victime de cette ouverture, de cet espace d’accueil et d’apaisement qu’elle offre : elle court le risque, bien que ce soit un beau risque, d’être un immense plaisir de lecture tout en n’offrant aucune prise à la critique institutionnelle qui aime les catégories, les buts avoués et explicites, les idéaux à poursuivre, le politique à changer. La critique est lente à comprendre; les oeuvres les plus durables sont souvent celles qui jouent avec cette faiblesse et qui, de fait, gardent la contre-culture toujours dans le revers de quelque chose de préhensible.
Bibliographie
- Delporte, Julie, et Daphné B. (2017-2018), « Les casseuses de party : conversation sur la tristesse entre Daphné B. et Julie Delporte », no 1, p. 37-40.
- Hébert, Sara (2018-2019). « Les aventures de Jacques… », no 3, p. 41-48.
- [La Rédaction] (2018). « Scènes du consentement actif », no 2, p. 25.
- Malle, Mirion (2017-2018). « Je pleure tout le temps », no 1, p. 34-35.
- Ocelot, Catherine (2018). « Savoir vivre », no 2, p. 7.
- Ocelot, Catherine (2018-2019). « Gentillesses », no 3, p. 17.
- Berlant, Lauren (2011). Cruel Optimism, Durham (Car. du N.), Duke University Press.
- Caillet, Aline (2004). « Figures de l’engagement, esthétiques de la résistance », Esse, no 51, [En ligne], [https://esse.ca/fr/dossier-figures-de-lengagement-esthetique-de-la-resistance] (7 octobre 2021).
- Lassonde, Élise (2013). « La mémoire des zines : nouvelles déclinaisons de l’édition contre-culturelle », Liberté, no 299 (printemps), p. 21.
- Legendre, Izabeau (2020). La scène du zine de Montréal : histoire, organisation et position dans le champ culturel, mémoire de maîtrise (histoire de l’art), Montréal, Université du Québec à Montréal.
- Pagé, Geneviève (2014). « L’art de conquérir le contrepublic : les zines féministes, une voie/x subalterne et politique? », Recherches féministes, vol. 27, no 2, p. 191-215.
Tristesse
Articles et ouvrages cités
List of figures
Figure 1
Figure 2
Figure 3
Figure 4

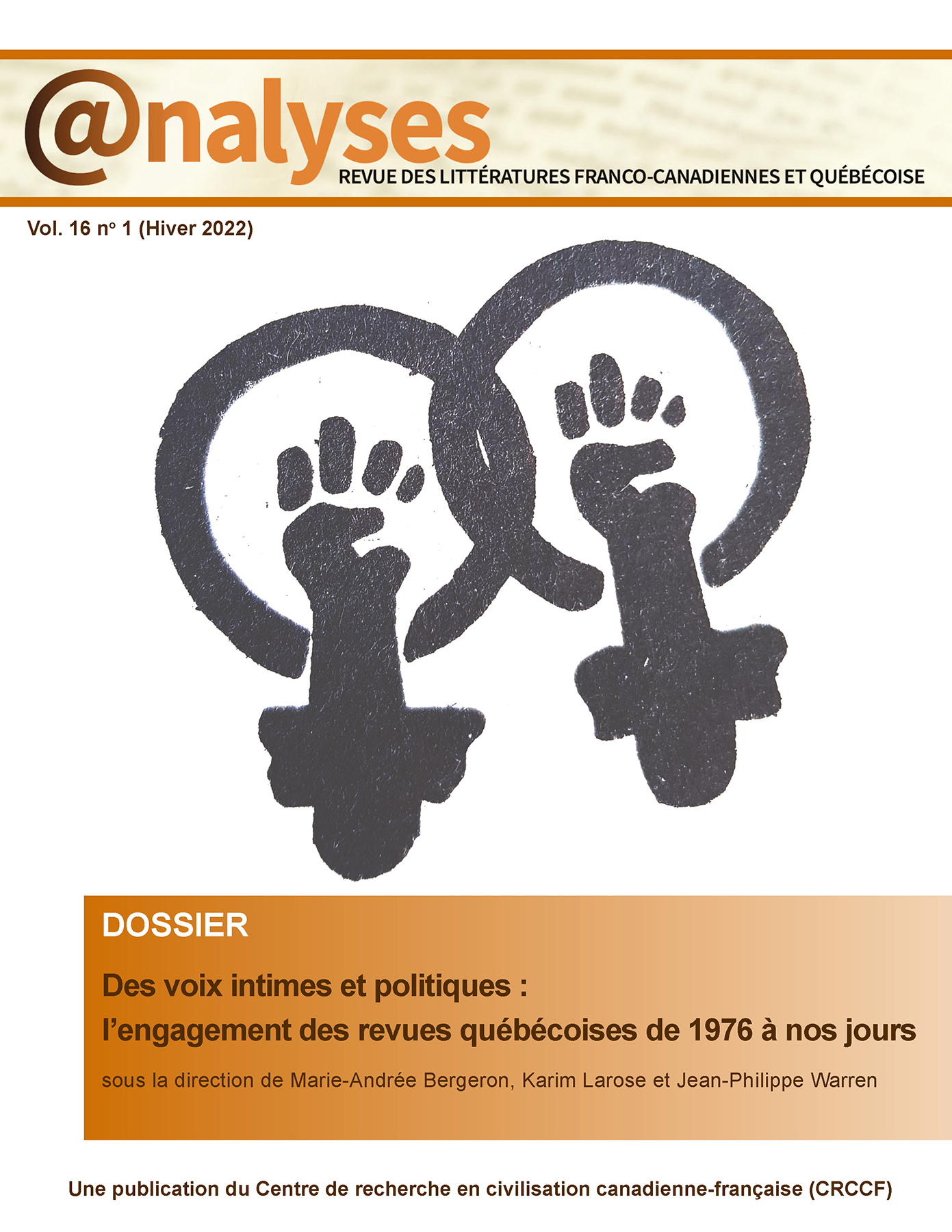





 10.7202/1027925ar
10.7202/1027925ar