Abstracts
Résumé
La recherche dont il est question dans cet article analyse les récits rétrospectifs de 13 jeunes adultes d’origine vietnamienne de deuxième génération, en lien avec leurs expériences vécues dans des institutions éducatives du Québec du primaire jusqu’à l’université. Nous cherchons à comprendre comment les personnes d’origine vietnamienne de deuxième génération font sens de leur rapport au groupe majoritaire et des relations de pouvoir inégales régissant leurs expériences socioscolaires, surtout en lumière de leur catégorisation comme « minorité modèle ». À l’aide d’une méthodologie qualitative constituée d’entretiens semi-dirigés et d’une analyse thématique prenant appui sur les concepts critiques de la blanchité et de la racisation, les résultats montrent que les rapports de racisation se concrétisent à travers la normalisation de la blanchité dans les relations qu’entretiennent les jeunes Vietnamiennes et Vietnamiens avec différents acteurs et actrices du groupe majoritaire : les pairs, le personnel enseignant, etc. De plus, les données révèlent leur travail de négociation du stéréotype de « minorité modèle » entretenu par le groupe majoritaire envers eux, les considérant comme un groupe social homogène. Par ces négociations, ces jeunes adultes démontrent une intériorisation de la norme de la blanchité et le développement d’une vision hiérarchisante des cultures, ce qui les amène vers un rapport ambivalent avec leur identification et leur culture.
Mots-clés :
- racisation,
- blanchité,
- rapports majoritaires-minoritaires,
- minorité modèle,
- expérience socioscolaire
Article body
Introduction
Contexte de l'étude
Étant donné le statut de « majorité fragile » du Québec (Mc Andrew, 2010), l’intégration des personnes issues de l’immigration y constitue un enjeu important depuis la seconde moitié du XXe siècle. Plus précisément, l’immigration a été considérée par certains Québécois et Québécoises comme un moyen de contrecarrer leur poids démographique et linguistique plus faible au sein de l’Amérique du Nord plus anglophone (Potvin, 2010). Cette vision de l’immigration a ainsi affecté diverses sphères de la société, dont celle de l’éducation. En effet, cela s’est, entre autres, manifesté à travers plusieurs politiques mises en place comme celle de la Charte de la langue française, mieux connue sous le nom de « Loi 101 » (Mc Andrew, 2010), dont un aspect visait à rediriger les personnes immigrantes vers des institutions éducatives francophones. Ainsi, les écoles francophones québécoises sont devenues « un milieu marqué par la diversité ethnoculturelle » (Magnan, Darchinian et Larouche, 2016, p. 101). Or la sphère éducative est un espace relationnel et politique des enjeux du vivre-ensemble où les rapports d’altérité entre les membres des groupes minoritaires et ceux du groupe majoritaire se construisent à l’image des rapports de pouvoir inégaux existants dans la société québécoise (Darchinian, 2018). Il semble qu’en contexte éducatif québécois, la rhétorique politique et médiatique de la diversité occulte de fait les rapports de pouvoir et l’infériorisation des groupes minoritaires (Darchinian et Kanouté, 2020; Labelle, 2010).
En ce qui concerne plus spécifiquement les jeunes catégorisés comme asiatiques au Québec, peu d’études ont exploré l’expérience socioscolaire de ces élèves. Parmi ces études, les dimensions intervenant dans leur intégration socioscolaire comme le statut générationnel, la langue d’usage, les frontières ethnoculturelles et les discriminations systémiques ont été mises en évidence (Bakhshaie, 2013; Doucet, 2021; Sun, 2013). En ce qui concerne plus spécifiquement les jeunes d’origine vietnamienne au Québec, plusieurs recherches ont conclu que la communauté vietnamienne s’est bien intégrée à la société québécoise (Dorais et Richard, 2007; Méthot, 1995; Tran, 2012). Cette idée rejoint la représentation courante considérant les personnes asiatiques comme minorités modèles. Dans le contexte nord-américain, elles sont perçues comme étant un modèle à suivre pour les autres groupes minoritaires dans la mesure où elles sont parvenues à réussir sur le plan académique, professionnel et financier, et cela, malgré leurs circonstances (Ho, 2014; Li, 2005). Ce succès est souvent attribué à des valeurs culturelles vues comme étant partagées par l'ensemble des Asiatiques, telles que la valorisation de l’éducation, une bonne éthique de travail et la solidarité familiale (Sabbagh, 2003). Quelques recherches ont également fait état de cette représentation particulière des jeunes d’origine vietnamienne au Québec, surtout dans le contexte de l’école (Méthot, 1995; Tran 2012). Malgré ce portrait positif, la pandémie de la COVID 19 a montré que la perception des personnes asiatiques était plus complexe. En effet, les personnes chinoises se sont retrouvées boucs émissaires de cette pandémie et cette accusation s’est élargie à d’autres personnes perçues comme étant chinoises, c’est-à-dire des personnes « asiatiquetées » (Chuang, 2022, p. 115). Cette conception des Asiatiques a amené ces derniers à être la cible de crimes violents et racistes pendant la pandémie (Guo et Guo, 2021; Statistique Canada, 2021).
La plupart des recherches effectuées sur les immigrantes et immigrants vietnamiens au Canada et au Québec ont porté sur leur processus d’intégration et d’adaptation, étant donné leur arrivée en grand nombre durant les années 1970 et 1980, à la suite de la fin de la guerre du Vietnam (Dorais, 2000). Il s’avère pertinent de s'intéresser à la deuxième génération, surtout à la lumière de leur poids démographique : selon le recensement canadien de 2016, cette génération représentait 37 % de la population vietnamienne au Canada (Statistique Canada, 2017, cité dans Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2019). Très peu d’études sur des jeunes d’origine vietnamienne au Québec ont évoqué l’existence de rapports de pouvoir inégaux dans leurs analyses (Méthot, 1995; Tran, 2012). Ainsi, l’analyse du travail de négociation de jeunes de minorité vietnamienne de deuxième génération sur les dimensions structurant leurs vécus relationnels en sphère éducative apportera un nouvel éclairage sur leur réalité, peu connue, et plus spécifiquement dans le contexte du Québec.
Dans cette étude, à partir d’entretiens semi-dirigés, nous portons notre attention sur l’expérience vécue à l’école de jeunes d’origine vietnamienne de deuxième génération, catégorisés comme minorités modèles. Pour ce faire, nous souhaitons mettre en exergue le rôle des processus de racisation et de la blanchité. Des questions spécifiques orientent notre étude. Comment cette catégorisation situe-t-elle ces jeunes au sein des rapports de pouvoir et des hiérarchies racisées dans la sphère éducative et comment, en retour, sont négociées ces logiques de racisation et de pouvoir? Nous explorons les manières dont la blanchité façonne leurs interactions avec les actrices et acteurs significatifs de la sphère éducative, puis nous abordons leur travail de négociation sur les différentes dimensions impliquées dans leur racisation au sein de la sphère éducative.
Les dimensions sous-jacentes aux processus d’altérisation dans la sphère éducative
Les recherches sur l’expérience des personnes asiatiques dans la sphère éducative sont plus nombreuses dans la littérature scientifique états-unienne et dans le reste du Canada. Leur expérience est souvent appréhendée à travers le mythe de la minorité modèle. Ici, cette idée est qualifiée de « mythe » puisque plusieurs chercheuses et chercheurs ont fait le preuve de son caractère erroné et de ses implications négatives (Cui, 2019; Shih, Chang et Chen, 2019; Vo, 2019). En effet, malgré le fait que les personnes asiatiques semblent vues de manière favorable par le groupe majoritaire, ce mythe les pose également comme étant des éternels étrangers et étrangères (perpetual foreigners), toujours de l’ordre de la différence (Lee, Park et Wong, 2017). Poon et al. (2016), qui s’inspirent de l’approche de la Critical Race Theory, soutiennent que le stéréotype de la minorité modèle est utilisé par le groupe majoritaire pour diviser les groupes minoritaires dans le but de préserver son propre statut de dominant. D’autres chercheurs et chercheuses (Dennis, 2018; Dhingra, 2021) ont également remis en question le postulat selon lequel les personnes asiatiques étaient des honorary whites, dans le sens où leur réussite perçue les rapproche du groupe majoritaire, et donc de la blanchité (Bonilla-Silva, 2004). Même si le concept de racisation est mobilisé dans l’étude de l’expérience socioscolaire des élèves issus de l’immigration au Québec, cette notion est peu utilisée dans les recherches sur les élèves asiatiques. Le concept de la blanchité semble généralement absent des travaux sur les personnes asiatiques au Québec, et plus généralement sur ceux concernant d’autres groupes issus de l’immigration. À partir de cet ancrage conceptuel, notre recherche s’opérationnalise autour de l’articulation des concepts sociologiques et critiques de la blanchité et de la racisation, deux dimensions sous-jacentes aux processus d’altérisation.
La blanchité
Comme Eid (2018), nous préférons traduire le terme de whiteness par « blanchité », plutôt que les termes « blancheur » ou « blanchitude », puisque ces termes peuvent, respectivement, avoir une connotation biologisante ou « [suggérer] un parallèle déplacé avec la "négritude" » (Eid, 2018, p. 127). « Blanchité » rappelle plutôt qu’il s’agit d’un construit, d’« une catégorie de pratique qui structure les rapports sociaux, et dont les effets de pouvoir et de classement sont, eux, bien réels » (Ahmed 2007, citée dans Eid, 2018, p. 136). Ainsi, il ne se rapporte pas à une origine spécifique ou à des traits phénotypiques, il relève d’une définition dynamique qui peut changer selon les contextes historiques, où la désignation ou l’identification à une identité blanche donne accès à des privilèges (Cervulle, 2012). Par exemple, le groupe majoritaire dont il est question dans cet article, celui des Québécoises et Québécois francophones blancs, a acquis ce statut seulement durant la seconde moitié du XXe siècle (Scott, 2016). Autrefois, ce groupe n’était pas considéré comme blanc dans le Canada anglais. Ce concept réfère aussi à « l’hégémonie sociale, culturelle et politique blanche à laquelle sont confrontées les minorités ethnoraciales, aussi bien qu’un mode de problématisation des rapports sociaux de race » (Garner, 2007, cité dans Cervulle, 2012, p. 39).
S’appuyant sur la théorisation de Hage (2000, cité dans Eid, 2018), Eid (2018) conçoit un lien important entre la blanchité et le concept de nation : il soutient que les individus cherchent à être reconnus comme sujets nationaux légitimes. Pour y arriver, ils doivent ainsi pouvoir « [posséder] ou [mobiliser des] caractéristiques culturelles et physiques (ex. : traits phénotypiques, langue, accent, religion, valeurs) socialement considérées comme des marqueurs d’appartenance nationale légitimes » (Eid, 2018, p. 141). Or ces marqueurs, qui interagissent souvent ensemble, sont axés sur l’idéal de la blanchité et sont déterminés par la majorité historique. Il est particulièrement important d’apporter cette nuance au concept de la blanchité étant donné le contexte québécois, c’est-à-dire que la transformation des Québécoises et Québécois, le « blanchiment » des Canadiens français et Canadiennes françaises, montre la fluidité de la blanchité et que cette dernière ne repose pas uniquement sur des caractéristiques phénotypiques. Dans cette recherche, le groupe majoritaire est alors défini comme étant composé de celles et ceux qui sont perçus comme étant d’ascendance canadienne-française.
L’articulation entre la blanchité et la racisation
Li (2003) définit la racisation comme un processus relationnel qui renforce le caractère biologisant de la notion de « race » dans l’imaginaire collectif en associant « une signification sociale à des groupes pour des motifs physiques superficiels » (p. 122). Bilge et Forcier (2016) soulignent également que la racisation opère à partir de traits culturels comme la langue et la religion, et non uniquement à partir de traits biologiques. Ces auteur·e·s soutiennent que ce processus s’inscrit dans des rapports de pouvoir, puisqu’il est producteur de « catégories qui altérisent et minorisent » (p. 13). De là, Lee et al. (2017) affirment que les processus de racisation ne sont pas des catégorisations neutres : ils visent à distinguer les personnes non blanches des personnes blanches. Son implication est hiérarchisante, c’est-à-dire qu’elle pose la race blanche et la civilisation européenne (perçue comme blanche) au sommet de cette hiérarchie.
Ainsi, l’articulation des concepts de blanchité et de racisation construit notre approche analytique, permettant l’analyse des processus d’altérisation dans le vécu des Vietnamiennes et Vietnamiens de deuxième génération dans le contexte de l’école québécoise. En effet, l’altérisation consiste en un processus de différenciation des groupes ou des personnes, de leur désignation comme étant « autres » et d’une démarcation entre le « eux » et le « nous » (Darchinian et Kanouté, 2020). Ce cadrage analytique nous a amenées vers le choix d’une méthodologie qualitative opérationnalisée par la méthode des entretiens semi-dirigés.
Méthodologie
La méthodologie qualitative situe l’expérience vécue telle qu’elle est racontée au centre de l’analyse des données. L’analyse des témoignages s’ouvre sur le lien entre les expériences et les événements sociaux. Dans le but d’obtenir une meilleure compréhension des négociations effectuées par des personnes de minorité vietnamienne de deuxième génération vis-à-vis du groupe majoritaire, et ce, au fil de leurs expériences éducatives du primaire à l’université, nous avons opté pour des entretiens semi-dirigés comme méthode de construction de données qualitatives. Cette méthode permet entre autres de « rendre explicite l’univers de l’autre » (Savoie-Zajc, 2016, p. 343) et de saisir des éléments pertinents qui sont difficilement observables, comme leurs sentiments, leurs pensées et leurs motifs (Denzin et Lincoln, 2005; Savoie-Zajc, 2016). L’entretien semi-dirigé a aussi l’avantage de pouvoir orienter la personne rencontrée en entrevue vers des thèmes spécifiques déterminés par la problématique, tout en maintenant une flexibilité qui permet d’explorer d’autres sujets qui émergent spontanément du récit de cette personne (Brinkmann, 2018). Le projet de recherche a été soumis à une évaluation par le comité d’éthique de la recherche – Société et culture de l’Université de Montréal (CER-SC) et la recherche auprès des participantes et participants a été approuvée.
Corpus
La méthode « boule de neige » a été utilisée pour le recrutement. Ainsi, mis à part la mobilisation de nos réseaux de contacts, une affiche de sollicitation a été publiée sur la plateforme du réseau social Facebook. Nous avons privilégié les pages et les groupes Facebook dont le public cible était des personnes asiatiques ou vietnamiennes au Québec. Puis les critères suivants ont été retenus dans la sélection des participantes et participants : être né·e au Québec de parents immigrants vietnamiens et fréquenter ou avoir fréquenté une institution postsecondaire. L’âge des participantes et participants se situait entre 22 et 44 ans et 11 sur 13 étaient des femmes. Toutes et tous suivaient des études universitaires ou les avaient terminées au moment de l’entretien. La majorité des personnes qui constituaient le corpus étaient issues de la région métropolitaine de Montréal et ont par conséquent effectué toute leur scolarité dans cette région. Seules deux participantes ont fréquenté des établissements scolaires ailleurs au Québec durant leur parcours.
Les entretiens ont été réalisés en octobre et novembre 2020, en utilisant la plateforme de visioconférence Zoom afin de respecter les mesures sanitaires dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Les entretiens ont duré en moyenne 1 heure et 30 minutes. Chaque entretien commençait par une mise en contexte qui rappelait certains éléments du formulaire d’information et de consentement comme le sujet de la recherche, les thèmes abordés, l’anonymisation des entretiens et leur enregistrement à des fins de retranscription. L’élaboration des questions d’entretien s’est appuyée sur des recherches avec des sujets connexes à la problématique (Darchinian, 2018; Larouche, 2016; Wong 2013). Les questions contenues dans le guide d’entretien tournaient ainsi autour des thèmes suivants : leur famille et leur parcours migratoire; leur expérience socioscolaire, avec un accent mis sur leurs relations avec d’autres acteurs et actrices de la sphère éducative; leur identification et enfin leur rapport à la culture vietnamienne, québécoise et canadienne.
Méthode et dimensions d’analyse
Ces entretiens ont été enregistrés puis retranscrits intégralement. Nous avons ensuite eu recours au logiciel de soutien à l’analyse qualitative Atlas.ti pour effectuer une analyse thématique. Cette méthode d’analyse a entre autres servi au repérage de thèmes pertinents à la problématique (Paillé et Mucchielli, 2016). Durant cet exercice, nous avions en tête le cadre conceptuel pour établir les thèmes présents dans les entretiens. Toutefois, puisque nous suivions une méthode semi-inductive, nous avons également porté attention à d’autres éléments qui pouvaient émerger. Les transcriptions des entretiens ont été relues plusieurs fois dans le but de bien saisir les thèmes communs aux différents récits, mais aussi afin de dégager les différences et les nuances des expériences des participantes et participants. L’analyse thématique des entretiens a permis d’identifier des situations où le concept de blanchité apparaissait dans les discours. De plus, des expériences d’altérisation ont été repérées : celles-ci mettaient en évidence des interactions racisantes entre les jeunes d’origine vietnamienne et des actrices et acteurs significatifs de la sphère éducative. En effet, elles révélaient les différentes facettes de la manière dont ces jeunes ont été racisés en tant que personnes asiatiques. Le logiciel de soutien à l’analyse qualitative était capable de compiler tous les extraits, regroupés sous les différents thèmes identifiés. Nous avons ensuite analysé chaque extrait sous son thème respectif afin de pouvoir articuler ensuite les extraits entre eux et de pouvoir élaborer une réponse à notre question de recherche.
Afin de respecter l'anonymat des participantes et participants, des pseudonymes leur ont été assignés.
Présentation et discussion des résultats
La démarche semi-inductive a mené à l’identification des dimensions d’analyse par le croisement entre d’une part les représentations des relations avec les pairs et avec le personnel enseignant et d’autre part les dimensions macrosociales issues de notre cadre conceptuel. Ainsi, les analyses ont permis de repérer, à travers la lentille de jeunes d’origine vietnamienne de deuxième génération, à la fois les dimensions contribuant à leur racisation dans leur parcours éducatif et les modalités de négociation de ces dimensions. Dans cet article, l’accent est mis sur les dimensions omniprésentes des processus de racisation ainsi que sur leurs mécanismes explicatifs.
Les résultats montrent que les rapports de racisation se concrétisent à travers : a) des processus de normalisation de la blanchité, b) des processus de hiérarchisation où la blanchité est considérée comme étant supérieure et c) des processus de réification de caractéristiques stéréotypées qui mènent à l’homogénéisation des personnes racisées.
La normalisation de la blanchité
Les témoignages de plusieurs participantes et participants mettent en lumière un processus implicite de normalisation de la blanchité dans la sphère éducative : à plusieurs reprises dans leurs interactions avec leurs pairs et avec le personnel enseignant, ils et elles se sont fait rappeler leur dérogation à la norme de la blanchité. Plus précisément, leur différence d’avec le groupe majoritaire touchait à la fois leur apparence physique et certains éléments culturels. En d’autres mots, puisque la blanchité est établie comme étant la norme, certains participants et participantes ont été implicitement désignés comme « autres » par leur différence.
C’est ainsi que Grégoire, qui a fréquenté une école primaire dans l’arrondissement de Saint-Laurent, a révélé durant son entretien qu’il avait subi des moqueries à ce moment-là au sujet d’une partie de son nom qui représentait son héritage culturel vietnamien.
Je me rappelle [...] les premières années du primaire, j'avais été [...] victime de... d'intimidation [...] à cause de mon nom en fait. Mon nom au complet, c'est Grégoire Do Anh Dao. Le « Anh Dao » à la fin, [...] c'était un nom « différent » [...]. Les jeunes enfants, [...] c'est des enfants qui sont malins [méchants]. [...] Ils savent pas… ce qui est correct, ce qui est pas correct. Ce qui fait que quand ils voient quelque chose de différent...
Sa différence était ainsi mise de l’avant puisque c’est la partie « étrangère » de son nom qui était ridiculisée par ses pairs et non son premier prénom, plus francophone.
À l’opposé, Minh a vécu une expérience altérisante de manière moins négative. Elle a fréquenté une école primaire avec peu de diversité ethnoculturelle et elle était parfois même la seule ou parmi les seules personnes asiatiques. Les questions qu’on lui posait sur sa différence physique ou culturelle perçue ont été plutôt attribuées à de la curiosité qu’à de la méchanceté.
Je te dirais, on dirait que ce que les gens avaient plus... en tout cas, les petites filles... c'était vraiment plus de la curiosité, comme « Oh, qu'est-ce que vous faites chez vous? Qu'est-ce que vous mangez? » et « À quoi ressemble ton nombril? » Ça, je l'ai déjà eu comme question [rires], j'étais comme « what the heck? » [...] J'avais des bonnes amies, mais... elles étaient vraiment surprises de ce que je mangeais, de qui j'étais, pourquoi mes cheveux sont si lisses… Ils savaient pas... Il y avait vraiment pas d'autres personnes comme moi, tu sais.
Puisque la blanchité était si normalisée dans leurs interactions à l’école, certains participants et participantes ont fini par associer la diversité ethnoculturelle à la marginalité, leur différence étant davantage mise de l’avant. Toutefois, dans les écoles où la présence d’élèves issus de la diversité était plus importante, cela a mené plutôt à une normalisation de leur différence. C'est ce qu’a vécu Noémie quand elle a changé d’écoles au primaire, allant de Longueuil à Montréal.
Mais je pense que c'était vraiment à partir du moment où j'étais à Montréal que je me suis développé un cercle d'ami·e·s. [...] mais disons que peut-être d'avoir [...] des gens de minorités visibles, ça aide un peu à être moins... plus normale?
Ainsi, pour plusieurs, la prise de conscience de la norme de la blanchité s’est effectuée à un jeune âge, plus spécifiquement au primaire. Cette norme s’est illustrée par la simple présence plus importante de leurs pairs du groupe majoritaire par rapport à aux personnes issues de l’immigration dans leurs écoles, mais aussi à travers des interactions qui renvoient explicitement à leur différence perçue, qu’elle soit de l’ordre de la culture ou du phénotype. Cela semble indiquer que ces jeunes se perçoivent déjà comme un Autre racisé (Darchinian, Magnan et de Oliveira Soares, 2021).
La hiérarchisation des cultures : intériorisation de la supériorité de la blanchité
En posant la blanchité comme étant la norme, tout élément considéré comme non blanc tombe ainsi dans l’altérité. La normalisation de la blanchité sous-entend ainsi un processus de hiérarchisation des cultures, où celle du groupe majoritaire est placée au-dessus, au détriment de celles des groupes minoritaires (Bilge et Forcier, 2016). Les témoignages de quelques participantes mettent au jour l’intériorisation de cette infériorisation des cultures des groupes minoritaires.
Bien qu’elle ait fréquenté une école secondaire avec beaucoup de diversité ethnoculturelle au sein de sa population étudiante, Myriam a raconté qu’elle avait tendance à former des amitiés avec des jeunes du groupe majoritaire. Elle a fini par considérer la culture de ses amies comme étant une norme à laquelle se plier, ce qui l’a aussi menée à dévaloriser son héritage culturel vietnamien.
Mais je dirais que mes trois meilleures amies du début du secondaire, elles étaient québécoises, ça me trigger [vexe] parce que j'étais vraiment, comme : « Okay, non, mais... je suis pas assez “cultivée”… je connais pas toutes vos références de “québécoises”, que ça soit l'histoire, que ça soit... » [...] Ça me gossait [m’énervait] vraiment beaucoup de pas savoir, et de ne pas avoir la même culture qu'eux. Mais je reconnaissais pas non plus que ce que moi j'avais comme bagage de mon côté, familial ou vietnamien... eux l'avaient pas, mais on dirait que ça... j'étais quasiment dans un... pas un déni, et j'étais pas gênée de ça, mais, mettons, je le valorisais pas vraiment.
Lana est allée à une école primaire où la majorité des élèves était du groupe majoritaire. Elle a ensuite continué ses études dans une école secondaire qui était fréquentée par plus de personnes asiatiques qu’à son école précédente. Cette jeune femme a raconté que durant son adolescence, elle avait intériorisé une définition d’être « cool » qui excluait systématiquement les personnes asiatiques et qui, en retour, devait nécessairement inclure la blanchité.
Dans ma tête, j'ai tout le temps pensé que c'était normal d'une personne de deuxième génération qui habite ici, et qui était à des écoles majoritairement blanches [de vouloir être une personne blanche] [...] Quand j'étais jeune, je cherchais quand même à être vraiment cool, et c'était jamais cool pour moi être asiatique. [...] J'aimais pas au secondaire, quand [...] je sortais avec des ami·e·s asiatiques, et on était vingt personnes asiatiques dans un même endroit. J'étais là : « Ah non, j’ai vraiment pas envie d'être là-dedans » [...] Peut-être parce que j'ai pas eu de représentation asiatique non plus cool quand j'étais jeune. Mais c'est ça, ce qui fait que j'ai vraiment associé ça à être [...] vraiment en marge de ce qui était normal. Oui.
Ce désir pour la blanchité est aussi venu structurer son rapport à ses pairs asiatiques : pour être vue comme cool, elle devait maintenir une certaine distance avec eux. Comme Myriam, Lana a commencé à dévaloriser cette partie d’elle.
Myriam et Lana n’ont pas mentionné avoir été exposées à des discours explicites prônant la supériorité de la blanchité qui expliqueraient l’intériorisation de ces croyances. Dans le cas de Rebecca, ce genre d’idées semble avoir été plus explicite chez ses pairs du groupe majoritaire durant ses études universitaires en relation d’aide.
Il y a des filles qui parlaient et qui travaillaient avec... soit des réfugiés, soit des nouveaux arrivants et tout, et il y avait des filles, elles disaient des propos et t'étais genre « Mais pourquoi tu dis ça en tant que future [intervenante], tu vois? » Il y a une fille, je me rappelle et je vais toujours m'en rappeler, elle dit « Pourquoi on n’éduque pas les immigrants à la culture québécoise? » […] Je me suis vraiment pas sentie à ma place, c'était vraiment de la méchanceté gratuite partout. C'était horrible.
Rebecca a ainsi été choquée par ce discours infériorisant véhiculé par ses pairs, surtout puisque ces derniers côtoyaient et seraient portés à côtoyer des personnes issues de l’immigration au cours de leur carrière en relation d’aide. Or la culture des personnes issues de l’immigration était dénigrée et celle du Québec perçue comme supérieure.
Les récits de ces participantes mettent en évidence l’aspect hiérarchisant et infériorisant de la blanchité. Que cette croyance en la supériorité de la blanchité soit transmise de manière implicite ou explicite, elle a mené à une dévalorisation du bagage culturel de certaines.
La réification de caractéristiques stéréotypées
Les témoignages de plusieurs participantes et participants révèlent également la négociation de stéréotypes tenus à l’endroit des personnes asiatiques, et plus précisément à propos d’éléments spécifiques à leur racisation. En effet, dans leurs interactions avec leurs pairs, certains jeunes du corpus ont été confrontés au stéréotype selon lequel les élèves asiatiques réussissent bien à l’école. Il s’agit d’une caractéristique du stéréotype de la minorité modèle assigné aux Asiatiques, et les participantes et participants en étaient bel et bien conscients. Voici des extraits montrant les différentes façons dont ils ou elles ont négocié leur racisation.
Dans le cas de Myriam, elle a vécu sa réussite en mathématiques au secondaire de manière assez mitigée : elle comprenait qu’obtenir des bonnes notes n’était pas intrinsèquement mauvais et elle affirmait elle-même avoir ce désir de réussir. Toutefois, elle semblait craindre de « répondre au stéréotype » pour ne pas être marginalisée par ses pairs (Bablak, Raby et Pomerantz, 2016).
Je sentais que fallait que je sois bonne, tu sais, d’autant que mes parents voulaient que je réussisse, et que moi-même, je voulais réussir, mais je voulais pas répondre au stéréotype de : « Oh oui, elle est asiatique, ce qui fait qu’elle est bonne à l'école. » [...] Même si j'avais cette réflexion-là, je me disais : « Là, je m'en fous, faut que j'aie des bonnes notes si je veux rentrer au cégep. » Ce qui fait que ça m'a pas trop, trop nui.
Ainsi, bien que ce stéréotype ne semble pas négatif à première vue et qu’il représente un indicateur de réussite, il est également mobilisé dans son environnement pour l’altériser : l’assiduité par rapport aux études de certains élèves asiatiques est perçue comme étant déviante (Dhingra, 2021).
Similairement, Grégoire a été catégorisé comme étudiant modèle au niveau académique par ses pairs au secondaire. Bien qu’il ait apprécié cela, il s’agissait d’une représentation unidimensionnelle de sa personne qui ne prenait pas alors en compte ses autres intérêts et forces, par exemple l’activité physique.
On dirait que quelque chose manquait, parce que je voulais pas être reconnu pour seulement l'étudiant vers qui le monde venait pour les questions liées à l'école. Et je pense qu'à la fin du secondaire, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à faire plus de sport, [...] mes accomplissements [...] côté « pas éducatif », [...] les étudiants les reconnaissaient vraiment beaucoup. Ce qui fait que j'étais rendu aussi une référence côté activité physique. Ça, [...] c'était vraiment quelque chose, je pense que c'était [...] un des piliers de la fondation [...] de mon identité, [...] c'est l'activité physique.
Rose a effectué son éducation primaire et secondaire en banlieue de Montréal. Durant l’entretien, elle a exprimé un certain soulagement à l’idée d’avoir intégré un programme international au secondaire puisque cela signifiait, selon elle, un personnel enseignant mieux formé dans la gestion de la diversité, ce qui ne semblait pas être le cas au primaire. Malgré cette croyance, Rose a tout de même vécu des interactions altérisantes avec le personnel enseignant au secondaire.
Au secondaire, c'était moins pire parce que comme je disais, il y avait plus d'Asiatiques [elle rit]. Mais encore là, [...] les profs... [...], surtout les trois premières années de secondaire, ils arrêtaient pas de mélanger les noms entre nous trois. [...] Mais on est extrêmement différentes. Moi, je suis taille « plus » [...], les deux autres filles sont minces comme des piquets. [...] Et il y a une fille qui a des cheveux longs, l'autre fille qui a des cheveux courts, et ils réussissent quand même à se tromper de noms, là [la participante rit].
Les témoignages de Myriam et de Grégoire rendent compte de diverses façons dont le stéréotype de la minorité modèle est négocié par des personnes d’origine vietnamienne de deuxième génération dans leurs interactions dans la sphère éducative. Celui de Rose illustre l’effet des stéréotypes sur la perception des personnes asiatiques qu’a le groupe majoritaire : les stéréotypes viennent renforcer l’idée d’un groupe monolithique et contribuent à les homogénéiser. Ils participent à la déshumanisation des personnes d’origine asiatique en leur niant leur individualité. La réification des stéréotypes joue ainsi un rôle dans la construction de catégories figées des groupes minoritaires. Plus spécifiquement, ces stéréotypes renvoient les personnes asiatiques à d'éternels étrangers et étrangères (Lee et al., 2017). Ainsi, bien que le stéréotype de la minorité modèle les dépeigne de manière favorable, il est également utilisé pour les marginaliser.
Conclusion
Les résultats de notre recherche mettent en évidence les diverses manières dont la blanchité structure les relations entre le groupe majoritaire et le groupe racisé des personnes de minorité vietnamienne de deuxième génération dans les expériences socioscolaires de 13 participantes et participants. L’originalité de notre étude repose sur l’accent mis sur les concepts de la blanchité et de la racisation pour rendre compte du travail de négociation des jeunes d’origine vietnamienne sur les relations au groupe majoritaire dans la sphère éducative. La mobilisation de ces concepts dans l’étude de l’expérience socioscolaire de personnes asiatiques s’avère être une nouveauté dans la littérature scientifique québécoise.
Les catégories conceptuelles construites au fil des analyses (normalisation de la blanchité, hiérarchisation des cultures, réification de caractéristiques stéréotypées) permettent la déconstruction du mythe de la minorité modèle et révèlent l’envers de sa médaille : la vision des personnes asiatiques comme d’éternels étrangers et étrangères. En effet, bien que la communauté vietnamienne au Québec soit généralement vue comme étant bien intégrée, les récits recueillis durant les entrevues montrent qu’il existe tout de même un sentiment de marginalité du fait de subir un processus de racisation. De plus, les représentations des vécus relationnels mettent en évidence que bien que la blanchité repose entre autres sur des différences phénotypiques, elle renvoie aussi à des différences culturelles perçues. Étant donné que leur différence leur est rappelée dans leurs interactions avec leurs pairs et avec le personnel enseignant du groupe majoritaire, ces jeunes se perçoivent assez tôt comme des autres racisés. Le vécu de ces expériences altérisantes se traduit par le développement d’un regard positif par rapport à la diversité ethnoculturelle chez certains participants et participantes puisqu’elle vient normaliser leur différence. Ensuite, par la négociation des rapports de racisation, ces jeunes démontrent une intériorisation de la blanchité posée comme la norme. Cette intériorisation s’illustre dans la dévalorisation de leur héritage culturel vietnamien et dans le développement d’un désir de rapprochement avec la blanchité.
Malgré des politiques québécoises valorisant la diversité ethnoculturelle et visant l’inclusion des groupes issus de l’immigration, il semble que les relations sociales dans la sphère éducative aboutissent à la racisation des jeunes. En effet, selon les résultats de notre étude basés sur les récits de 13 participantes et participants, les rapports de force entre majoritaires et minoritaires qui existent à l’échelle de la société québécoise se reproduisent également au sein des relations interpersonnelles à l’école. Plus de recherches s’avèrent nécessaires pour rendre plus visibles les modalités par lesquelles l’institution éducative perpétue le processus de racisation des élèves issus de groupes minoritaires. Les résultats de notre recherche sont susceptibles d’intéresser aussi bien les décideurs et décideuses politiques que les praticiennes et praticiens des milieux scolaires du Québec qui sont soucieux d’un univers éducatif favorable aux rapports égalitaires entre personnes de toutes origines. En effet, il est pertinent de réfléchir aux différentes manières de promouvoir le développement de rapports intergroupes harmonieux (Magnan, Darchinian et Larouche, 2016).
Il importe également de souligner plusieurs limites de cette recherche. Afin d’explorer les différences qui pourraient avoir eu lieu au fil des transitions scolaires (Magnan et al., 2016), le critère de sélection de la fréquentation d’institutions postsecondaires a été retenu dans la sélection des participantes et participants. Or cela peut contribuer à la reproduction involontaire de l’idée de minorité modèle, en plus d'offrir une perspective qui se limite à celle d’individus hautement scolarisés. De plus, puisque 11 sur 13 personnes étaient des femmes, il était plus difficile de faire émerger des différences genrées dans les expériences socioscolaires lors des analyses. Finalement, la grande majorité des participantes et participants sont issus de la région métropolitaine de Montréal et y ont effectué une bonne partie de leur scolarité, ce qui ne permet pas de rendre compte de la réalité des jeunes adultes d’origine vietnamienne de deuxième génération qui demeurent dans d’autres régions du Québec.
Appendices
Bibliographie
- Bakhshaei, M. (2013). L’expérience socioscolaire d’élèves montréalais originaires de l’Asie du Sud : dynamiques familiales, communautaires et systémiques [thèse de doctorat, Université de Montréal]. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/10117
- Bablak, L., Raby, R. et Pomerantz, S. (2016). ‘I don’t want to stereotype… but it’s true’: Maintaining whiteness at the centre through the `smart Asian’ stereotype in high school. Whiteness and Education, 1(1), 54‑68. https://doi.org/10.1080/13613324.2015.1122661
- Bilge, S. et Forcier, M. (2016). La racialisation. Droits et libertés, 35(2), 13‑14.
- Bonilla-Silva, E. (2004). From bi-racial to tri-racial: Towards a new system of racial stratification in the USA. Ethnic and Racial Studies, 27(6), 931‑950. https://doi.org/10.1080/0141987042000268530
- Brinkmann, S. (2018). The interview. Dans N. K. Denzin et Y. S. Lincoln (dir.), The SAGE handbook of qualitative research (5e édition, p. 984‑1026). SAGE Publications.
- Cervulle, M. (2012). La conscience dominante. Rapports sociaux de race et subjectivation. Cahiers du Genre, 53(2), 37‑54. https://doi.org/10.3917/cdge.053.0037
- Chuang, Y.-H. (2022). Racisme « anti-asiatique », ou le dénigrement d’une minorité. Pouvoirs, 181(2), 109‑117. https://doi.org/10.3917/pouv.181.0109
- Cui, D. (2019). Model minority stereotype and racialized habitus: Chinese Canadian youth struggling with racial discrimination at school. Journal of Childhood Studies, 44(3), 70‑84. https://doi.org/10.18357/jcs00019175
- Darchinian, F. (2018). Les parcours d’orientation linguistique postsecondaire et professionnelle : l’expérience de jeunes adultes issus de l’immigration à Montréal [thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/20057
- Darchinian, F. et Kanouté, F. (2020). Parcours postsecondaires et professionnels et rapports de pouvoir au Québec : discours de jeunes adultes issus de l’immigration. Revue des sciences de l’éducation, 46(2), 69‑92. https://doi.org/10.7202/1073719ar
- Darchinian, F., Magnan, M.-O. et de Oliveira Soares, R. (2021). The construction of the racialized Other in the educational sphere: The stories of students with immigrant backgrounds in Montréal. Journal of Culture and Values in Education, 4(2), 52‑64. https://doi.org/10.46303/jcve.2021.6
- Dennis, E. (2018). Exploring the model minority: Deconstructing whiteness through the Asian American example. Dans G. J. Sefa Dei et S. Hilowle (dir.), Cartographies of race and social difference (p. 33‑48). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97076-9_3
- Denzin, N. K. et Lincoln, Y. S. (2005). The SAGE handbook of qualitative research (3e éd). Sage Publications.
- Dhingra, P. (2021). “Over-zealous Parents, Over-programmed Families”: Asian Americans, academic achievement, and white supremacy. Sociology of Race and Ethnicity, 7(4), 458‑471. https://doi.org/10.1177/23326492211018483
- Dorais, L.-J. (2000). La recherche sur l’immigration vietnamienne au Canada. Moussons. Recherche en sciences humaines sur l’Asie du Sud-Est, (1), 93‑105. https://doi.org/10.4000/moussons.8864
- Dorais, L.-J. et Richard, É. (2007). Les Vietnamiens de Montréal. Presses de l’Université de Montréal.
- Doucet, D. (2021). La négociation ambivalente de l’identité et du rapport à la culture d’une « minorité modèle » : les récits des jeunes de minorité coréenne à Montréal [mémoire de maîtrise, Université de Montréal]. Papyrus. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/26610
- Eid, P. (2018). Les majorités nationales ont-elles une couleur ? Réflexions sur l’utilité de la catégorie de « blanchité » pour la sociologie du racisme. Sociologie et sociétés, 50(2), 125‑149. https://doi.org/10.7202/1066816ar
- Guo, S. et Guo, Y. (2021). Combating anti-Asian racism and xenophobia in Canada: Toward pandemic anti-racism education in post-covid-19. Beijing International Review of Education, 3(2), 187‑211. https://doi.org/10.1163/25902539-03020004
- Ho, R. (2014). Do all Asians look alike?: Asian Canadians as model minorities. Studies on Asia, 4(4), 78‑107.
- Labelle, M. (2010). Racisme et antiracisme au Québec : Discours et déclinaisons, Québec, Presses de l’Université du Québec.
- Larouche, É. (2016). École, identification et négociation des frontières ethniques : une étude de cas sur les jeunes de la 2e génération issue de l’immigration à Montréal [mémoire de maîtrise, Université de Montréal]. Papyrus. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/18607
- Lee, S. J., Park, E. et Wong, J.-H. S. (2017). Racialization, schooling, and becoming American: Asian American experiences. Educational Studies, 53(5), 492‑510. https://doi.org/10.1080/00131946.2016.1258360
- Li, G. (2005). Other people’s success: Impact of the « model minority » myth on underachieving Asian students in North America. KEDI Journal of Educational Policy, 2(1), 69‑86.
- Li, P. S. (2003). Chapitre 4. Les minorités visibles dans la société canadienne : les défis de la diversité raciale. Dans D. Juteau (dir.), La différenciation sociale : modèles et processus (p. 121‑154). Presses de l’Université de Montréal. http://books.openedition.org/pum/21145
- Magnan, M.-O., Darchinian, F. et Larouche, É. (2016). École québécoise, frontières ethnoculturelles et identités en milieu pluriethnique. Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society, (7), 97‑121. https://doi.org/10.7202/1036418ar
- Mc Andrew, M. (2010). Les majorités fragiles et l’éducation : Belgique, Catalogne, Irlande du Nord, Québec. Presses de l’Université de Montréal. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43582086f
- Méthot, C. (1995). Du Viêt-Nam au Québec: la valse des identités. Institut québécois de recherche sur la culture.
- Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. (2019). Portrait statistique : Population d'origine ethnique vietnamienne au Québec en 2016. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/immigration/publications/fr/recherches-statistiques/diversite-ethnoculturelle/2016/STA_Vietnamienne_Portrait2016.pdf
- Paillé, P. et Mucchielli, A. (2016). Chapitre 11 - L’analyse thématique. Dans P. Paillé et A. Mucchielli (dir.), L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales (p. 231-314). Armand Colin.
- Poon, O., Squire, D., Kodama, C., Byrd, A., Chan, J., Manzano, L., Furr, S. et Bishundat, D. (2016). A critical review of the model minority myth in selected literature on Asian Americans and Pacific Islanders in higher education. Review of Educational Research, 86(2), 469‑502. https://doi.org/10.3102/0034654315612205
- Potvin, M. (2010). Interethnic Relations and Racism in Quebec. Dans S. Gervais, C. J. Kirkey et J. Rudy (dir.), Quebec questions: Québec studies for the 21st century (p. 267-286). Oxford University Press.
- Sabbagh, D. (2003). Le statut des « Asiatiques » aux États-Unis : L’identité américaine dans un miroir. Critique internationale, 20(3), 69‑92. https://doi.org/10.3917/crii.020.0069
- Savoie-Zajc, L. (2016). L’entrevue semi-dirigée. Dans B. Gauthier et I. Bourgeois (dir.), Recherche sociale : de la problématique à la collecte de données (6e édition, p. 337-364). Presse de l’Université du Québec.
- Scott, C. (2016). How French Canadians became White Folks, or doing things with race in Quebec. Ethnic and Racial Studies, 39(7), 1280‑1297. https://doi.org/10.1080/01419870.2015.1103880
- Shih, K. Y., Chang, T.-F. et Chen, S.-Y. (2019). Impacts of the model minority myth on Asian American individuals and families: Social justice and critical race feminist perspectives. Journal of Family Theory & Review, 11(3), 412‑428. https://doi.org/10.1111/jftr.12342
- Statistique Canada. (2021). Mois du patrimoine asiatique... en chiffres. https://www.statcan.gc.ca/fr/dai/smr08/2021/smr08_250
- Sun, M. (2013). The educational experience of students of Chinese origin in a French-speaking context : the role of school, family, and community [thèse de doctorat, Université de Montréal]. Papyrus. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/10889
- Tran, L.-C. M. (2012). La communauté vietnamienne de Montréal : l’identité ethnoculturelle des jeunes viéto-montréalais [mémoire de maîtrise, Université de Vienne]. u:theses. https://utheses.univie.ac.at/detail/20370
- Vo, V. (2019). Interrupting the « model minority » narrative: The voices of Vietnamese Canadian youth [thèse de doctorat, Western University]. https://ir.lib.uwo.ca/etd/6044
- Wong, A. (2013). “Between rage and love”: Disidentifications among racialized, ethnicized, and colonized allosexual activists in Montreal [thèse de doctorat, Université Concordia]. Spectrum. https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/977483/

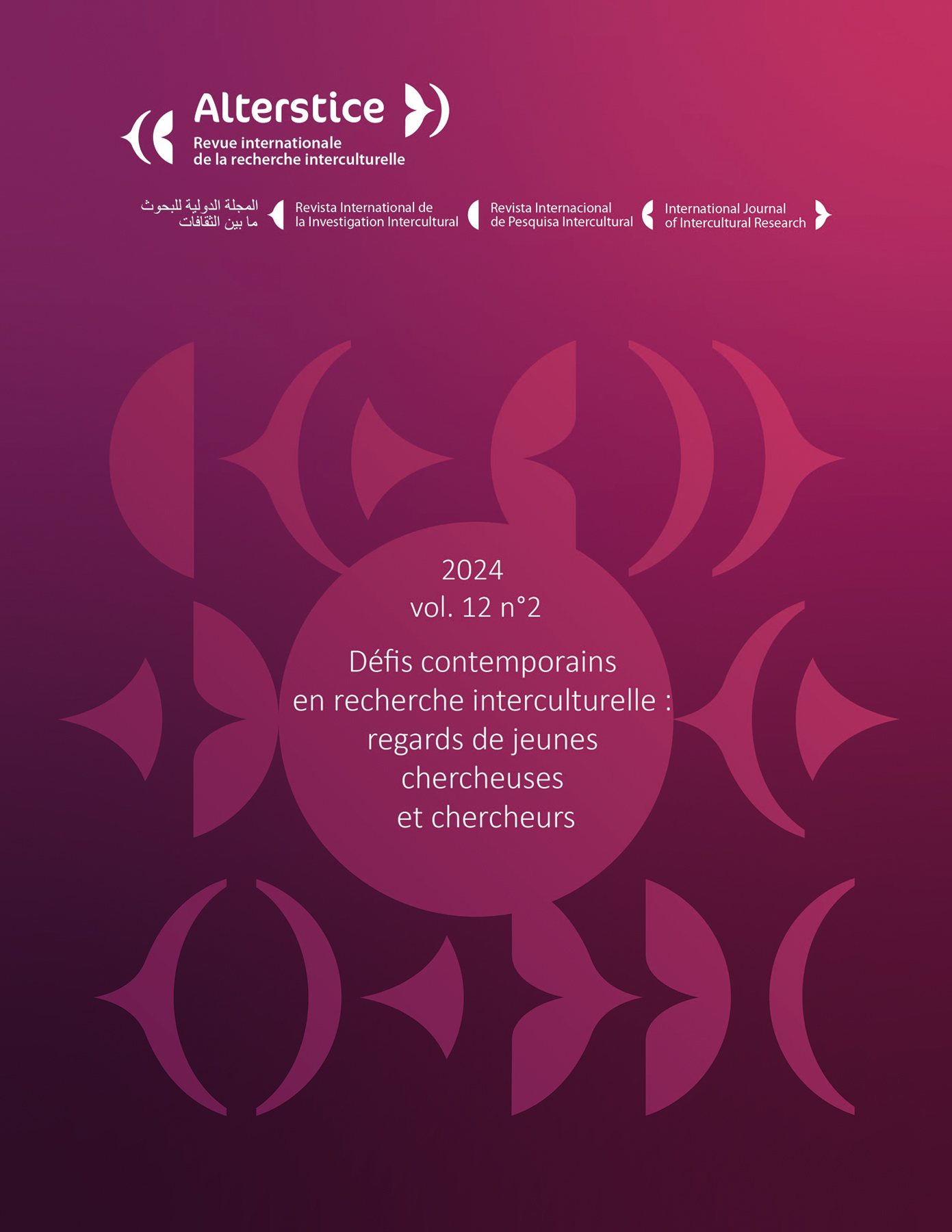

 10.7202/1073719ar
10.7202/1073719ar