Abstracts
Résumé
L’article s’intéresse à la structuration du handi-ski dans les stations de ski du massif des Pyrénées-Orientales (PO) et au développement d’un tourisme de loisir intégré qui en découle. Dès 1985, la mise en place de compétitions handi-ski dans les PO va rapprocher des acteurs locaux, Michel Douard (président de Handisport Béziers) et Jean-Claude Pous (élu délégué au sport et vice-président de la régie des skis des remontées mécaniques à Font-Romeu), et un acteur national, Georges Dejonghe (CTN handisport FFH). L’histoire de vie de ces acteurs montre comment ils ont créé les conditions pour sensibiliser les parties prenantes des stations de ski des PO à l’accueil des handi-skieurs. Cette sensibilisation passe par l’organisation de stages d’initiation associés aux compétitions handi-ski, dont le potentiel touristique devient alors un levier pour le développement d’un loisir intégré sur le territoire des PO. L’acceptation du handi-ski est d’autant plus convaincante auprès des décideurs qu’il représente une manne économique qui permet de combler les périodes « creuses » au sein des stations de ski des PO. Au final, cette opportunité saisonnière, répondant à des enjeux politico-économiques locaux, a permis d’encourager les conditions d’accueil des handi-sportifs en stations de ski des PO et, in fine, la participation sociale des handi-skieurs.
Mots-clés :
- handi-ski,
- loisirs intégrés,
- Pyrénées-Orientales,
- facteurs environnementaux,
- participation sociale
Abstract
The article focuses on the structuring of handi-skiing in the ski resorts of the Pyrénées-Orientales (PO) mountain range and the development of integrated leisure tourism that results from it. From 1985 onwards, the establishment of handi-ski competitions in the POs brought together local players, Michel Douard (president of Handis-port Béziers) and Jean-Claude Pous (elected delegate for sport and vice-president of the ski lift management in Font-Romeu), and a national player, Georges Dejonghe (CTN handi-sport FFH). The life story of these figures shows us how they created the conditions to raise awareness among the stakeholders of PO ski resorts concerning the reception of disabled skiers. This awareness is achieved through the organisation of introductory courses associated with handi-ski competitions, whose tourism potential then becomes a lever for the development of an integrated leisure activity on the territory of the POs. The acceptance of handi-skiing is all the more convincing to decision-makers as it represents an economic windfall that makes it possible to fill the "off" periods within PO ski resorts. In the end, this seasonal opportunity, responding to local political and economic issues, made it possible to enhance the reception conditions of disabled athletes in PO ski resorts and, ultimately, the social participation of disabled skiers.
Keywords:
- Handi-skiing,
- integrated leisure,
- Pyrénées-Orientales,
- environmental factors,
- social participation
Article body
Introduction
Que ce soit en stations de ski des Pyrénées-Orientales ou des Alpes françaises jusqu’aux moyennes montagnes du Jura et des Vosges, la pratique du handi-ski est aujourd’hui visible et bien ancrée. Les fauteuils-skis, pilotés par des bénévoles et/ou des moniteurs, ou utilisés en autonomie, facilitent la participation sportive en stations de ski. L’engouement est d’autant plus important que les sports de nature connaissent un essor important ces dernières années à la Fédération Française Handisport (FFH) avec un nombre de licenciés qui a quintuplé : entre 1977 et 2022, les adhésions sont passées de 4 809 à 27 100 licenciés tandis que le nombre d’associations augmentent de 200 associations à plus de 1 630 associations affiliées à la FF Handisport[1]. Parallèlement, le matériel s’est développé et perfectionné ; il existe aujourd’hui toute une gamme de fauteuils-skis ajustables aux télésièges et adaptés aux différents types de déficiences, voire spécifiquement ajustés à la personne (Perera et al., 2020). La place du handi-ski en station de ski française s’est ainsi forgée, et ce, dès les origines du processus de structuration du mouvement handisport en 1954 avec la création de l’Amicale Sportive des Mutilés de France (ASMF) par Philippe Berthe (Ruffié et Ferez, 2013)[2].
Dès sa création, l’ASMF propose des activités sportives dans une logique de rééducation et de réadaptation comme le ski, le cyclisme, l’automobile et l’aviron[3]. Rappelons que Berthe, blessé de guerre et amputé fémoral, pratiquait déjà le ski alpin avant la guerre. Lors d'un voyage d’études en Autriche, il a réappris à skier avec des skieurs, amputés autrichiens (Ruffié et Ferez, 2013). Dès lors, il milite déjà pour la mise en place de stages de formation des encadrants bénévoles en handi-ski, et participe à l'organisation des premiers stages de ski debout (Ruffié et Perera, 2013). Il faut attendre 1962, pour voir l’implication de l’École Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA) dans les stages handi-ski pour former des encadrants (Ruffié et Ferez, 2013). Une formation d’autant plus nécessaire que se développent dans les années 1980, des fauteuils-skis pour la pratique du ski assis (Le Roux et al., 2014), permettant de passer d’une pratique orientée à ses débuts plutôt vers des personnes amputées[4] à un usage par l’ensemble des catégories de déficiences[5].
Dans ce sens, l’article de Le Roux et al. (2014) rend compte des évolutions de la pratique du ski assis à partir des années 1980 et se focalise ensuite sur la créativité des acteurs, en s’intéressant au développement de la pratique dans la région Languedoc-Roussillon et plus précisément dans le massif des Pyrénées-Orientales à partir de deux histoires de vie, celles de Jean-Marc Barbin et de Henry Sahuquet[6]. Barbin[7] constate lors d’un stage de ski organisé par la FFH dans les Pyrénées « qu’il n’y avait rien de structuré. Celui qui avait des prédispositions pour le ski ça allait bien [...] donc fédération handisport, stage, je m’attends à voir quelque chose de structuré […], mais dans leur conception il fallait tout faire, on était l’entraîneur, on était le sherpa, on était tout ! ». Dans ce cadre, il rencontre Sahuquet[8], expérimenté en ski debout et « bricoleur », qui pense également que « tout était à faire » : de l’adaptation du matériel au cas par cas à la réflexion pédagogique jusqu’aux relations avec les stations de ski (Le Roux et al., 2014). Barbin et Sahuquet, aidés par des « copains profs de gym » et un infirmier de PROPARA, un centre de rééducation situé à Montpellier, lancent leurs premiers stages[9] ; ils débutent avec cinq ou six personnes handicapées motrices puis rassemblent jusqu’à 50 personnes par saison au cours des dernières années. À partir de ces éléments, Le Roux et al. tirent des conclusions un peu hâtives quant à leur implication à « structurer l’activité ski assis dans la région Languedoc-Roussillon et précisément sur le massif des Pyrénées Orientales » (2014 : 115). En effet, si ces acteurs ont contribué à proposer des séjours handi-ski sous forme de stage loisir dans la région Languedoc-Roussillon et des Pyrénées-Orientales durant la moitié des années 1990, il faut toutefois préciser que la structuration de la pratique handi-ski était déjà en place dans ces régions. Ainsi, dans cet article, nous proposons d’analyser les prémices et le développement du handi-ski dans différentes stations de ski des Pyrénées-Orientales (PO). Nos analyses montrent qu’à partir des années 1980, des acteurs locaux, soutenus par la FFH, mettent en place, chaque année, dans des stations de ski différentes des PO, des compétitions internationales de handi-ski associées à des stages d’initiation au handi-ski, mais aussi de préparation au haut niveau. Ces manifestations contribuent à la visibilité des pratiquants et à la mise en accessibilité du territoire des PO, améliorant ainsi la participation sociale des handi-skieurs[10]. Cette pratique est d’autant plus acceptée et intégrée dans ces stations de ski qu’elle s’insère dans les politiques de développement touristique de la région.
I. Méthodologie
Pour analyser l'émergence et le développement du handi-ski dans les stations de ski des PO des années 1980, nous avons réalisé des entretiens avec les pionniers de l’activité. Trois entretiens de type « histoire de vie et de pratique » (Bertaux, 1997) ont été menés avec Jean-Claude Pous (ancien président du Comité Départemental handisport des PO, durée 2 heures 20 minutes, 20/03/2018), Michel Douard (président Handisport Béziers, durée 3 heures, le 16/04/2018) et George Dejonghe (ancien Directeur technique national (DTN) Activité physique de pleine nature (APPN) FF Handisport, durée 2 heures, le 4/06/2018). Il s’agit de trois acteurs clés qui se sont coordonnés aux niveaux départemental, régional et national pour « faire la trace » (comme le dit Pous) d’une structuration de la pratique handi-ski dans les PO ; trace que Barbin et Sahuquet ont finalement empruntée. Pous a été identifié dans un premier temps, à la suite d’un échange avec des responsables du Comité Régional Handisport du Languedoc-Roussillon. Puis, par effet boule de neige, Pous a insisté sur l’importance de rencontrer Douard et Dejonghe au sujet des évènements handi-ski dans les PO des années 1980. D’ailleurs, pour saisir le rôle et les actions de chacun dans la structuration du handi-ski dans les PO, un premier entretien de groupe a été réalisé au local de l’Association Sportive de Bézier le 16/04/2018 (durée 2 heures 45 minutes), complété par un second (durée 2 heures 58 minutes) le 15/07/2023 à Banyuls au domicile de Pous, afin d’approfondir l’histoire du handi-ski dans les PO.
Il a été demandé à ces pionniers de retracer leur histoire personnelle et plus particulièrement de revenir sur la période concernant l’émergence de la pratique du handi-ski dans les PO à la fin des années 1970. Ces entretiens, qui se rapprochaient le plus possible de la simple conversation (Olivier De Sardan, 1995), favorisent ainsi l’émergence d’une « micro-histoire » (Revel, 1996) faite de l’expérience des individus à partir de leurs discours et des traces (documents administratifs, photos, etc.) que les acteurs nous ont confiées. Pous, initialement professeur d’éducation physique et sportive (lycée du Portail, Saint-Étienne) en 1967, entre dans l’administration et la direction de la cité préolympique de Font-Romeu[11] en 1969. Puis, il est élu délégué au sport et vice-président de la régie des remontées mécaniques de la commune en 1983. En tant qu’élu, il est sollicité par Douard (conseiller technique fédéral régional de ski alpin[12], président de l’association sportive handisport de Béziers), en 1985, pour organiser une épreuve de ski pour personnes handicapés physiques du ski club de Bézier. Par la suite, Pous va participer à l’organisation de Championnats de France et à l’élaboration de stages internationaux Pyrénées-Roussillon.
Quant à Douard, atteint de la polio depuis l’âge de 3 ans, il était conseiller technique à la mairie de Béziers. En 1977, il découvre la pratique du ski debout avec des stabilisateurs grâce à l’Association Sportive de Bézier ski (ASB ski) dont il prend la responsabilité de la section handisport. Il va créer en 1981 l’association « Handisport Bézier ». C’est en 1985 qu’il fait la rencontre de Pous pour organiser des compétitions handi-ski. Il participe ainsi au développement du ski assis au niveau régional tout en se préoccupant de l’amélioration des fauteuil-skis en termes de sécurité, confort et performance.
Ensuite, Dejonghe a débuté en 1963 en tant que professeur d’éducation physique et sportive en Seine-Saint-Denis, puis, il a travaillé au service « natation » de la Ville de Paris jusqu’en 1979. Il devient ensuite conseiller technique départemental (CTD) dans la section « handicapés » à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS) de Bobigny avant d'entrer plus précisément dans le monde du handi-ski. De 1983 à 2004, il assure le poste de conseiller technique national (CTN) « Handisport chargé des Sports de Glisse et de Pleine Nature » au sein de la FFH tout en étant Directeur Technique Fédéral du ski alpin de 1983 à 1994 ainsi que directeur du département « Activités Physiques de Pleines Natures » (APPN) de 1994 à 2004. Dejonghe a notamment organisé, tous les ans, les Championnats de France l’amenant à rencontrer et à travailler avec Pous et Douard.
Enfin, leurs discours[13] et les documents qu’ils nous ont confiés (affiches, flyers, photos, courriers, comptes rendus et dossiers évènements handi-ski) ont été croisés avec les revues Handisport Magazine[14], consultées de 1970 à 1992[15]. Il est question d'avoir des repères permettant d'identifier des étapes (évènements et faits divers) de l'évolution du handi-ski en lien avec le mouvement fédéral handisport. Ainsi, nous avons pu mettre en évidence comment la structuration des stations de ski des PO passe par la mise en place de compétitions handi-ski qui favorisent la participation sociale des handi-skieurs depuis le début des années 1980.
II. Structurer le handi-ski par la compétition
Le handi-ski est l’une des activités proposées dès la création de l’ASMF. Cependant, jusqu’aux années 1980, hormis la mise en place de stages de ski, rien n’est réellement structuré comme l’explique Douard : « c’était une époque où tout est à faire » où « tous ces stages, à l’époque, démarraient systématiquement sur le volontariat des anciens qui prenaient, par famille de handicap, un débutant ». L’implication de bénévoles est centrale, comme l’engagement des interviewés et chacun à leur niveau a contribué à l’organisation du handi-ski dans les PO. L’engagement de Douard à l’ASB ski[16] contribue à l’organisation de la toute première rencontre handi-ski dans la région des PO en 1979 (du 30 janvier au 4 février) aux Monts d’Olmes (Second souffle, n°8, avril 1979). À cette époque, il fallait aller dans les Alpes pour pratiquer le handi-ski dans le cadre de « stages FFH/ASMF ». Ces stages étaient ouverts « à tous les licenciés FFH, débutants, moyens, confirmés » (Second souffle, n°10, octobre 1979 : 47) et organisés par des associations locales, qui, peu nombreuses, proposaient un stage d’initiation par an. Douard, alors président de Handisport Béziers accélère la coordination de la pratique du handi-ski dans les PO, en 1985, lorsqu’il fait appel à Pous, alors élu délégué au sport et vice-président de la régie des skis des remontées mécaniques à Font-Romeu, pour organiser la rencontre annuelle de l’ASB ski. La tâche fut ardue pour Pous, car « il fallait convaincre les uns et les autres d’accueillir les handis et tout ce qui s’ensuit ». Il s’agissait non seulement de convaincre, mais aussi d’impliquer des acteurs pour développer la pratique du handi-ski dans les PO. L’arrivée de Dejonghe en 1983 à la FF Handisport comme CTN handisport renforce cette dynamique compétitive du handi-ski au niveau national en insistant sur l’importance des logiques d’initiation à la pratique pour révéler de futurs champions.
A. Structurer le handi-ski de haut niveau par le loisir
Avant 1983, la fédération a disposé d’un directeur technique fédéral ski, Pierre Knaff un ancien militaire dont le rôle était de « monter une petite équipe pour réaliser des courses internationales [notamment avec son fils Patrick qui était amputé fémoral], mais la pratique est restée très marginale ». Au niveau des associations handi-ski, mise à part « l’ASB ski Béziers et l’ASMF qui montaient des actions ponctuelles, il n’y avait pas de structures réelles » (Dejonghe). Dès avril 1979, un article de Knaff précisait déjà « les difficultés auxquelles se heurtent les organisateurs » et que « la bonne volonté ne peuvent plus suffire, face aux impératifs financiers. Ainsi nous ne savons pas qui organisera les prochains championnats » (Second Souffle, n°8 : 37). Quelques temps après, le 22 mars 1980, la « dissolution de la commission fédérale de ski » (Second souffle, n°13, juin 1980 : 48) met en évidence l’absence d’organisation du ski à la FF Handisport, un tournant pour envisager une nouvelle commission avec une politique d’action. Dans ce sens, Knaff va cosigner un article avec ses 3 directeurs techniques fédéraux adjoints et compétiteurs, Baudean (le plus titré des handi-skieurs), Knaff, Perron, pour présenter « les problèmes français » en handi-ski. Ils révèlent que « les skieurs handicapés (…) sont essentiellement des individuels (il y a peu de clubs actifs), disséminés autour de massifs montagneux (…) la relative faiblesse d’effectifs de nos licenciés (…) face aux défis actuels lancés par l’évolution générale observée à l’extérieur »[17] (Second Souffle, n°14, octobre 1980 : 38). Ces trois acteurs tirent en quelque sorte la sonnette d’alarme en décrivant une situation du handi-ski dispersée, qui « a du mal à maintenir le contact avec le peloton de tête » (Ibid.). En 1982, Knaff, peu entendu par la FF Handisport[18], mettra fin à son implication.
En septembre 1983, Dejonghe, conseiller départemental « sport et handicap » à la DDJS de Bobigny depuis 1979, prend le poste de CTN handisport à la FFH, avec « la promesse de développer des sports de pleine nature ». Mais par la force des choses, son rôle va aller bien au-delà et se tourner vers la gestion des compétitions handi-ski. « Il y avait des Jeux Olympiques d’hiver en janvier 1984, mais il n’y avait plus de structure de ski handisport. Il y en avait eu une auparavant, mais (…) plus rien, aucune organisation, aucune préparation. Le président[19] m’avait dit qu’il serait quand même dommage de ne pas pouvoir envoyer les skieurs alors qu’on avait quelques bons skieurs.
Donc il m’a donné la mission, en trois mois, de monter une équipe pour partir aux Jeux. De là, ils m’ont nommé directeur technique du ski alpin ». Le président de la FF Handisport, André Auberger (de 1981 à 2007), appuyé par le DTN François Terranova (1981-1993), se tourne ainsi vers Dejonghe qui dispose des bonnes compétences en étant non seulement professeur d’EPS, mais aussi moniteur de ski. Missionné par le président de la FFH, Dejonghe fait ainsi face à un défi de taille : réunir une équipe d’handi-skieurs pour les Jeux olympiques[20] d’hiver d’Innsbruck (Autriche) en 1984. Très rapidement, il crée une commission technique du ski alpin et il travaille avec l’ENSA, notamment avec Philippe Berthe (fondateur de l’ASMF, moniteur ESF en tant qu’amputé fémoral). Même s’il arrive à rassembler une équipe de handi-skieurs en 3 mois, la préparation pour les Jeux paralympiques repose sur 2 stages d’entraînement d’une semaine, ce qui est loin d’être suffisant pour préparer sérieusement les compétiteurs. Pour gérer cette préparation et les Jeux d’Innsbruck, Dejonghe s’entoure d’une équipe technique en lien avec la FFS : l’entraîneur Pellegrino (moniteur de ski), le docteur Jacques Grison[21] et Pierre Martin[22] (kinésithérapeute de l’équipe de France handi-ski). Malgré tout, l’équipe de France handi-ski réussit à revenir avec six médailles. Pour Dejonghe, cette expérience confirme combien il est primordial d’initier le plus grand nombre à la pratique du handi-ski en France. De cette manière, Innsbruck « a été vraiment le point de départ ». Dejonghe, maintenu à la « direction technique du ski parce qu’il n’y avait personne », se retrouve alors à développer d’un côté les activités de loisirs de pleine nature « qui balbutiait un peu à l’époque à la fédération » et d’autre part la compétition handi-ski qui « se gère différemment (…) il fallait monter une structure, il a fallu que je mette en place la commission technique ski alpin avec ses problèmes : le développement, la formation, le volet préparation équipe de France » (Dejonghe). Pour lui, la structuration du handi-ski compétitif en France doit s’organiser par le loisir : « si vous ne développez pas la pratique de base des sports de loisirs, comment allez-vous trouver les talents pour aller plus haut ? ». La pratique du handi-ski en loisir devient une priorité ; c’est une étape importante avant d’envisager la compétition qui permet au handi-skieur de se rendre compte de ses capacités. Cette mission s’avère toutefois compliquée du fait que dans les années 1980-1990, au sein de la FF Handisport, Dejonghe[23] devait composer avec des bénévoles. Dans ces conditions, l’engagement technique et physique des handi-skieurs en mode loisir et haut niveau va s’organiser à travers des stages. Si dès le début, le mouvement handisport propose un stage par an, Dejonghe a pu, dès 1985, passer à deux stages d’une semaine par an. L’enjeu de ces stages est aussi « social » selon Dejonghe car il s’agit de montrer aux athlètes « valides » les capacités des handi-skieurs. D’où l’importance pour Dejonghe de réaliser les championnats de France handi-ski dans des stations différentes, des Alpes aux Pyrénées-Orientales.
B. Organiser des compétitions d’envergure pour une visibilité du handi-ski dans les stations de ski des PO
Au niveau local, Douard en tant que conseiller technique fédéral régional et Pous salarié à la DDJS des Pyrénées-Orientales défendent la même logique que Dejonghe en proposant des stages d’initiation à la pratique du handi-ski avant d’envisager la compétition de haut niveau. L’enjeu de ces stages est avant tout la promotion et l’attractivité : il s’agit de faire connaître la pratique du handi-ski aux débutants et de proposer des entraînements à ceux qui souhaitent se perfectionner pour les compétitions. Dans les PO, « le processus s’est enclenché comme ça : arriver à convaincre que les gens ont la possibilité de faire du sport de haut niveau, c’est les mettre en situation d’avoir un instrument de sport entre les mains. Ça ne leur parlait pas Jeux olympiques, car ils pensent ne jamais atteindre ce niveau. Mais ça ne fait rien, ce n’est pas le niveau qui compte c’est le fait qu’ils mettent un pied à l’étrier et qu’ils se disent qu’ils améliorent leur qualité de vie » (Pous). Ces stages sont ainsi associés à l’organisation de compétitions handi-ski.
Cette articulation compétition et initiation au handi-ski débute à la fin des années 1970, lorsque Douard prend la responsabilité de la section handisport à l’ASB ski. Il se retrouve rapidement avec 6 ou 7 copains handi-skieurs. En 1979, il lance l’organisation de la première compétition handi-ski aux Monts d’Olmes, la station des Pyrénées « la plus proche de Béziers » (Douard). Il s’agit des « XIIe Championnats de France[24] de ski alpin » pris en charge « par la section ski d’une association sportive illustre : l’association sportive biterroise [ASB ski] (…) Les championnats réussis n’ont pourtant pas toujours lieu dans les Alpes [mais cette fois-ci dans les PO] » (Second souffle, n°8, avril 1979 : 36). Puis en 1985, Douard va lancer une dynamique de compétitions handi-ski dans les PO, en se tournant vers Pous, alors élu délégué au sport et vice-président de la régie des remontées mécaniques de Font-Romeu, pour lui demander d’organiser une épreuve de ski pour son championnat annuel. C’est un véritable challenge pour Pous qui essuie tout d’abord un refus de la part du maire de Font-Romeu « qui ne veut pas voir de skieurs handicapés sur les pistes ». Pour dépanner Douard, Pous l’oriente alors vers une station voisine, l’Err-Puigmal[25]. Pendant 2 ans, le championnat de l’Association Sportive de Bézier ski (ASB ski) sera organisé dans cette station de ski « toujours en liaison avec la Fédération française de ski. J’ai toujours estimé quand même que pour les chronométrages et pour toutes ces choses-là il fallait l’appui de professionnels » (Douard). Entre-temps, Pous élabore « l’idée d’une compétition handi-ski où l’image forte est celle du sportif et non du handicap » (doc. « Coupe internationale des PO de ski alpin handisport », Pous : 2).
Pous analyse le refus du Maire d’organiser une manifestation en expliquant que « d’abord ils ne connaissent pas le handicap (…) deuxièmement, ne le connaissant pas, ils s’en font une idée, qui n’est pas la bonne. Donc il faut remplacer l’idée qu’ils se font par une idée qui soit plus valorisante. Donc on ne fait pas l’épreuve handi-ski Handisport Béziers, on passe à la coupe Internationale des Pyrénées. Voilà la raison de l’appellation ». Dejonghe complète en disant : « Internationale pourquoi parce que tu avais lancé l’action en partenariat avec les espagnols et les andorrans ».
Ainsi en 1987, avec le concours d’Handisport Béziers, la 1ère Coupe internationale des Pyrénées pour skieurs handicapés se déroule sur une piste de Font-Romeu (13, 14, 15 mars) avec l’aide du Rotary-Club Font-Romeu-Cerdagne-Capcir[26]. Pous choisit d’utiliser une piste bien visible de la station exclusivement dédiée à cette compétition et la manifestation se déroule sans encombre. Pour sa mise en place, il ne précise pas auprès de la station de ski qu’il s’agit d’une compétition pour personnes handicapées physiques, il parle de « la compétition du club de Béziers ». Dans cette dynamique internationale, en 1988, il décide de se rapprocher de la frontière espagnole, à la station de ski espagnole La Molina (située en Basse-Cerdagne) où il parvient à organiser une deuxième manifestation handi-ski, en liaison avec la FFS, mais aussi avec la fédération de ski espagnole : c’est la 2ème Coupe internationale handi-ski des Pyrénées. Pour gérer cet évènement handi-ski, Pous crée le Club handisport Cerdagne Capcir. La 3e Coupe aura lieu à Pal Massana (Andorre) en 1989 (3, 4 et 5 mars). C’est en 1990 qu’il décide de se rapprocher des Angles (impliquant également les stations de Formiguères-Matemale-Puyvalador) pour réaliser la quatrième Coupe internationale handi-ski des Pyrénées (26, 27, 28 janvier) où il obtient l’accord du maire, Christian Blanc. C’est aussi la mise en place du 1er Camp international d’entraînement Pyrénées-Roussillon. Ce camp permet aux handi-skieurs de vivre une expérience sportive compétitive « comme tout le monde », c’est-à-dire une participation sociale pleine et entière. On note également l’implication des médias (télévision[27], radio et presse) qui participent de cette dynamique et à la visibilité de la pratique du handi-ski. Selon Pous, dès l’instant où un événement est médiatisé, il change son « volume » jusqu’à atteindre les personnes politiques comme lors des premiers Camps Internationaux Pyrénées Roussillon aux Angles en 1990, qui, par exemple, avaient accueilli un chef d'État du gouvernement espagnol. Lorsque les compétitions handi-ski étaient médiatisées, la station d’accueil andorrane fournissait plus facilement les forfaits aux compétiteurs que pour une compétition non médiatisée.
En 1990, Pous se met en relation avec le « comité de travail des Pyrénées » pour organiser alternativement chaque année des compétitions handi-ski « une fois en France, une fois en Espagne, une fois en Andorre : toute la chaine des Pyrénées ». Cette organisation implique la participation de compétiteurs français, espagnols et andorrans[28]. L’organisation de ces manifestations handi-sportives « est toujours précédée d’un stage de découverte et d’apprentissage du handi-ski » (doc. « Coupe internationale des PO de ski alpin handisport », Pous : 2). Cette logique qui consiste à changer de station à chaque manifestation est un principe en place au niveau national valorisé par Dejonghe.
En parallèle, ce dernier organise dans des stations différentes, « les championnats de France tous les ans et là, effectivement, à l’époque les championnats de France étaient ouverts pour tout le monde puisqu’on n’avait pas assez d’activités dans les clubs pour pouvoir faire des éliminatoires, etc. Donc on avait une cinquantaine de coureurs qui venaient pour les championnats chaque année… » (Dejonghe). Le changement de station de ski à chaque championnat mobilise l’engagement de la station de ski et ses intervenants dans l’organisation et participe à la sensibilisation de la pratique du handi-ski.
Toujours en 1990, au sein du département des Pyrénées-Orientales, Pous constate l'absence d’un comité départemental handisport. Il juge important d’en fonder un pour que la FFH exerce sa politique fédérale au sein du département : « Il n’y avait pas de comité départemental, il n’y a pas de communication et d’ailleurs je n’en avais pas vu d’autres. Donc on mettait des handi-guides, il y avait marqué “le sommaire”, je présentais la fédération française, la commission nationale du sport, le comité régional Languedoc-Roussillon, le comité départemental, la liste des associations avec toutes les références » pour que les personnes handicapées puissent savoir quelles activités sont possibles et où les pratiquer. Fondé le 10 mai 1990, il sera présidé par Pous pendant quatre ans. Les objectifs seront « la promotion d’évènements handisports, augmentation du nombre de pratiquants et du nombre d’association, formation des dirigeants » (Handi-guide 66 : 8). Au final, la première année suivant la création du comité départemental, Pous pouvait compter sur 261 licenciés[29]. La dynamique compétitive du handi-ski impulsée dans les PO prend forme et, ainsi, Dejonghe a pu apprécier l’engouement des pratiquants lors de la création du comité départemental impliquant différents clubs et associations.
De cette façon, les manifestations sportives accueillent de plus en plus de licenciés et le principe de changement de station de ski à chaque manifestation handi-ski renforce l’accueil et la sensibilisation à la pratique du handi-ski. S’organise ainsi une visibilité sociale du handicap à partir de la mise en place de compétitions nationales et internationales. L'adoption de logiques compétitives du handi-ski, considéré comme une pratique « normativante » (Marcellini et al., 2003 ; Marcellini, 2005), favorise ici un processus de déstigmatisation et contribue à éviter des refus d’accès aux stations de ski des PO. Ces manifestations handi-ski d’envergure proposent une forme de visibilité sociale plus engageante vis-à-vis des stations de ski et moins stigmatisante que celle d’une pratique handi-ski loisirs isolée. Par ailleurs, une volonté forte demeure d’associer aux compétitions des conditions pour initier au handi-ski sous forme de stages dont la dynamique offre un potentiel touristique remarquable sur le territoire de la chaîne des PO.
III. Les manifestations handi-ski, un potentiel touristique pour les PO
L’histoire du handi-ski montre que pour pérenniser cette pratique dans la région des PO, des stages d’initiation et de préparation aux compétitions se systématisent. L’engouement est tel que les pratiquants venaient de toute la France, sensibilisés par les établissements de l’Association des paralysés de France (APF) à des stages avec transport, hébergement et matériel compris. Cet essor pour le handi-ski loisirs conduit Pous à proposer à la FFH de créer une licence loisir car « On ne peut pas demander à des gens qui ne s’imaginent pas en état de faire du sport qu’il faut prendre une licence de compétition. Ça n’existait pas à l’époque. La fédération n’a pas voulu. Maintenant, ça existe ». Au début des années 1990, le Club Handisport Cerdagne Capcir était en mesure d’organiser près d’un stage par mois. Dans ces conditions, la dynamique d’accès au loisir handi-ski que ce soit au niveau national ou dans les PO participe à structurer le haut niveau de cette pratique avec en point de mire les Jeux paralympiques. Si la compétition handi-ski reste l’enjeu central, la gestion de ces manifestations sportives et des séjours handi-ski renforce la sensibilisation des acteurs clés des stations de ski à l’accueil du public handicapé et finalement, en allant d’une station de ski à une autre, développe une mise en tourisme du territoire des PO. Cette mise en tourisme bénéficie de la promotion des séjours handi-ski qui diffusent des informations et renseignements aux personnes handicapées sur l’accessibilité des stations de ski, indiquant où trouver du matériel en prêt ou en location et dans quelle école de ski se trouvent des moniteurs formés.
A. Sensibiliser les élus et les responsables de station de ski des PO au handi-ski
En 1987, Pous avait bien saisi que la station d’Err-Puigmal, n’était pas équipée pour recevoir le championnat de la section handi-ski du club de Béziers, notamment à cause de l’éloignement entre l’hébergement et les pistes distant d’environ seize kilomètres. Cette distance représente une difficulté au niveau du transport, à la fois des pratiquants et du matériel tandis que dans les stations des Angles ou de Formiguères, les hébergements se situent au pied des pistes.
Lorsque Pous réalise sa première compétition[30] avec l’ASB ski à la station de Font-Romeu, c’est plutôt dans la discrétion qu’il l’organise, évoquant « la compétition du club de Béziers », et choisissant d’utiliser exclusivement une piste réservée à cette compétition. De cette manière, il s’assure que lors de l’évènement « la piste leur est consacrée » et que la compétition soit bien visible de tous les skieurs. Pour cela, il sélectionne la piste dont l’arrivée est au pied des pistes.
Ainsi, il fait en sorte que le directeur de la station de ski, les responsables et les moniteurs de ski assistent à la compétition pour les sensibiliser au handicap. Plus précisément, durant ces manifestations handi-sportives, Pous n’hésite pas à sensibiliser « tous les conseillers généraux, tous les conseillers régionaux, tous les maires des stations, tous les directeurs de ski, tous les moniteurs des écoles de ski » en envoyant un programme de la compétition handi-ski. Cette sensibilisation ne s’arrête pas là : il va éduquer des acteurs politiques et ceux du monde du sport comme il nous l’explique : « tous les soirs, j’avais un conseil général (…) Un jour, c’était avec les élus du canton, les champions de l’équipe de France et les responsables des directions des sports, etc., pour discuter de la façon dont on peut imaginer l'accueil des handicapés. C’était avec la fédération française qui nous expliquait. La fois d’après c’était avec des élus. Et comme ça, chaque soir, on a essayé de sensibiliser ». Les médias télévisuels relayaient l’information : « La télévision espagnole venait, la télé-presse faisait des reportages de 7 minutes ».
Pous construit ainsi de « bons rapports » avec les stations de ski des PO avec lesquelles il travaille, à tel point qu’il proposera la candidature de la station des Angles (impliquant les stations Formiguères, Bolquère, Saint-Pierre-dels-Forcats et Puyvalador)[31] pour les 24es Championnats de France à Dejonghe (DTF FFH) qui se dérouleront en 1991. Ce dernier n’avait jamais eu de candidatures pour l’organisation de compétitions handi-ski, il était toujours « obligé d’aller militer dans les stations pour avoir une petite place ». Le président de la FF Handisport se rendra sur place pour visiter le domaine et valider la tenue des 24es Championnats de France handi-ski aux Angles. Pour ces championnats, Pous invite le directeur et les responsables de la station des Angles ainsi que les moniteurs de ski qui ont accepté cette nouvelle forme de pratique du ski. On comprend ici « qu’il y avait un objectif précis qui était de sensibiliser tous les responsables des pistes, de se former pour accueillir des personnes handicapées. Que ça ne soit pas seulement l’occasion de la manifestation, mais qu’ils soient capables en toutes saisons d’accueillir des personnes handicapées ». En invitant les acteurs clés de la station de ski, mais aussi des élus et des champions, Pous perpétue l’organisation des compétitions et valorise l’accueil des skieurs handicapés. Les sponsors étaient également sensibilisés, au même titre que les directeurs et moniteurs d’école de ski, avec un comité d’honneur où ils recevaient des livrets de présentation de la compétition. Il n’hésite pas non plus à impliquer ses invités et les mettre en situation : « on a mis les élus dans des fauteuils, on leur a fait faire une petite descente et ils étaient très impressionnés, car c’était ludique ». Ils pouvaient ainsi se rendre compte des difficultés rencontrées par les handi-skieurs et mesurer leurs performances. Par la suite, la majorité a voulu améliorer l’accessibilité de leur station de ski. De la sorte, Pous souligne le potentiel de la pratique du handi-ski auprès des professionnels de la montagne en changeant les représentations au centre des réticences par rapport à l’accueil de personnes handicapées. Pour Pous, le choix d’accueillir des skieurs handicapés est doublement gagnant car « Ça veut dire que vous avez un tel niveau supérieur de l'accueil, parce que vous êtes en capacité d'accueillir le plus difficile ». L’argument de Pous consiste à dire qu’il faut « faire en sorte que les efforts des stations de ski pour accueillir ces skieurs et ces compétitions, contribuent à l’image de la qualité de la station » (doc. « Coupe internationale des PO de ski alpin handisport », Pous : 2). Ainsi, l’objectif de développer la qualité d’accueil des handi-skieurs, pour leur faciliter toute participation sociale en station de ski, devient un levier potentiel d’un tourisme sportif pérenne.
B. « Accueillir les handis », une manne touristique et financière pour les stations de ski des PO
Les retombées économiques d’une stratégie touristique dédiée à l’accessibilité deviennent un argument de poids pour Pous pour convaincre les stations de ski des PO. Cette stratégie touristique prend forme avec l’organisation du 1er Camp International d’entraînement Pyrénées-Roussillon en 1990, en période touristique creuse, là où les hôtels sont vides[32] ; c’est-à-dire après les vacances de Noël, pendant la deuxième semaine de janvier. Avec les camps internationaux, « la manifestation ne se déroule plus sur un week-end prolongé, mais sur toute une semaine. Avec les trois premiers jours consacrés à aller visiter Puy-Valador, Saint-Pierre, Eynes… » (Pous).
Même si les stations ne sont pas homologuées pour accueillir des handi-sportifs, elles y sont sensibilisées. « Puis en 1994 ça change d’appellation pour devenir la semaine handi-ski » (Pous). Avec une manifestation qui allait d’une tenue sportive officielle jusqu’à la cérémonie d’ouverture au repas de clôture impliquant les élus (du discours d’ouverture à la remise de coupes…). Lorsqu’il évoque un de ces stages, Pous explique qu’il comptait plus de 200 personnes, ce qui permettait de remplir 3 hôtels et un centre de vacances. L’ensemble de la manifestation représente un budget conséquent de 450 000 francs[33].
Dans cette optique, Pous va proposer chaque année des compétitions handi-ski à différentes stations de ski sur la chaîne des Pyrénées jusqu’à rapprocher l’offre handi-sportive des territoires des PO. « Il y a quatre communes : Targasonne, Egat, Font Romeu et Pyrénées 2000. J’ai dit qu’il fallait qu’on travaille ensemble. Pourquoi ? Parce que ces quatre communes sont adossées au même massif où il y a du ski, de la promenade, du parapente. Donc on aurait intérêt à monter un produit comme ça ». La pratique du handi-ski devient une occasion de créer une dynamique touristique[34] sur l’ensemble des PO.
Sur huit ans à partir de 1987, « la manifestation a été organisée quatre fois en France, deux fois en Andorre et deux fois en Espagne, se déplaçant dans neuf stations différentes » (doc. « Coupe internationale des PO de ski alpin handisport », Pous : 3). Par ailleurs, les stages d’initiation au handi-ski sont devenus des stages internationaux d’entraînement. Le nombre de participants a évolué : avec une moyenne de soixante-cinq, le stage de 1995 compte quatre-vingt-onze inscrits. Cette évolution apparaît également « en qualité, véhiculant par la même une image des Pyrénées » (Ibid.). Ces stages assuraient ainsi un complément touristique non négligeable pour la station de ski d’accueil.
Le reliquat budgétaire des évènements était investi pour faciliter l’accueil des handi-skieurs en station de ski. Pous déclare par exemple qu’il a acheté « du matériel de ski fauteuil[35] que j’ai mis à la disposition de l’école de ski des Pyrénées 2000 avec en plus, prise en charge d’un de ses moniteurs qui a passé une semaine avec l’équipe de France à Tignes pour avoir les compétences pour enseigner. Mais ça, ce n’est pas pour la compétition. Ça, c’était pour que les professionnels du ski soient en mesure d’accueillir des personnes handicapées » (Pous). L'année 1992 marque une nouveauté : « pour la première fois en France la mise en place d’un enseignement spécialisé handi-ski au sein d’une école de ski (Bolquière Pyrénées 2000) permet un accès simple, individuel à la pratique du ski » (doc. « Coupe internationale des PO de ski alpin handisport », Pous : 3). Cette première a fait l’objet d’un dépliant spécialement dédié aux personnes handicapées distribué à l’office de tourisme de Bolquière Pyrénées. Le flyer présente le club de ski, le domaine skiable et les hébergements accessibles. À cette époque et dans une logique de loisir, Pous change le nom de l’association « Handisport Cerdagne Capcir » qui devient « Sport loisir handi ». Il propose aux moniteurs de ski d’associer la location du matériel à une adhésion de « 1 franc (…) pour la disposition des fauteuils, car si une personne se fait mal, il se retourne contre le propriétaire du fauteuil. Pour avoir une couverture, j’avais une assurance (…) je disais aux moniteurs de ski, quand vous aurez des candidats, vous vendez un franc… » (Pous).
D’ailleurs, ce potentiel touristique n’a pas échappé à Douard, président de l’association Handisport Béziers, qui « a compris depuis longtemps qu’il fallait de temps en temps proposer autre chose (…) en outre son aspect vacances et tourisme, la pleine nature revêt un aspect sportif souvent très pointu que la FF Handisport se doit d’orchestrer et de canaliser » (Handisport Magazine, n°62, 1er trimestre, 1990). De ce fait, Douard et Dejonghe[36] vont créer le label Espace loisir handisport (EHL)[37] dont l’enjeu est « de cibler et d’identifier des sites, les faire connaître, pour que les gens qui avaient envie de pratiquer une activité soient sûrs d'être accueillis dans de bonnes conditions : le matériel adapté et puis la formation, donc avec le certificat de qualification handisport » (Dejonghe). Ce label, rénové en 2006[38] (Handisport magazine, n°125, mai-juin-juillet, 2006) et stoppé en 2018[39], était un moyen de garantir « des conditions au niveau de l’organisation de l’activité sportive ainsi que de la formation de l’encadrement » (Reichhart, 2020 : 18).
On constate donc que les manifestations sportives de handi-ski au niveau des PO impliquent tous les acteurs clés des stations de ski accueillantes jusqu’à sensibiliser les élus, et ce, afin de faire évoluer les représentations négatives sur le handicap. Cette gestion des évènements handi-ski concourt à « éduquer » d’une part une société (Ville, 2014) loin de connaître le handi-ski et à renforcer un intérêt touristique non négligeable. Une mise en tourisme se décline alors en valorisant des conditions d’accueil des handi-sportifs en stations de ski des PO.
On assiste à l’émergence et au développement d’un tourisme intégré (Reichhart, Lomo, 2013) lorsque Pous met à disposition du matériel de ski fauteuil à l’école de ski Bolquière Pyrénées 2000 avec un moniteur formé pour faciliter un accès au loisir du handi-ski. Le dépliant valorisant cette offre de « loisir touristique intégré » (Reichhart, 2009), distribué à l’office de tourisme de Bolquière Pyrénées 2000, détaille les moyens mis à disposition[40] des handi-skieurs parmi les offres classiques de séjours ski. Cette initiative donne une occasion aux handi-skieurs de participer activement aux activités de cette station, reléguant en arrière-plan l’image « des personnes à qui il faut seulement venir en aide » (Gaillard et Le Roux, 2010 : 3). Le label EHL renforce ce développement en certifiant le degré d’accessibilité des équipements, infrastructures, services, etc., « dont l’enjeu est la finalité de rendre visible ce qui est accessible » (Reichhart, Lomo, 2013 : 83). Pour Dejonghe et Douard, ce label incarne une occasion de mettre en avant des sites accessibles tout en favorisant une « visibilité en informant le public de l’offre accessible sur un territoire » (Reichhart, 2017 : 19).
Conclusion
La collaboration tripartite entre Douard, président de Handisport Béziers, Pous élu délégué au sport et vice-président de la régie des skis des remontées mécaniques à Font-Romeu et Dejonghe, en tant que conseiller technique national de la FF Handisport, va permettre d’impulser, dès 1985, de manière complémentaire, une dynamique compétitive du handi-ski à un programme d’initiation handi-ski dans les PO. D’un côté, les manifestations handi-ski nationales et internationales facilitent la sensibilisation au handicap et à l’accessibilité des parties prenantes des stations de ski accueillantes. De l’autre, l’organisation de stages d’initiation associés aux compétitions handi-ski, passant d’un stage par an à un stage par mois, devient un potentiel touristique remarquable sur le territoire de la chaîne des PO et conforte une visibilité de la pratique du handi-ski en stations de ski dans la durée. Le tourisme s’affirme alors comme un levier pour le handi-ski mais aussi une manne économique qui semble convaincre les décideurs bien plus que les enjeux de l’inclusion. Toutefois, cette participation sociale est d’autant plus discutable que les stages et les compétitions handi-ski ne font que combler les périodes « creuses » des stations de ski des PO durant lesquelles la visibilité des handi-skieurs demeure relative.
Cependant, cette opportunité saisonnière va encourager progressivement un tourisme intégré et inclusif alimenté par les conditions d’accueil de handi-sportifs en stations de ski des PO : de multiples moyens (matériels adaptés à disposition, aménagements pour rendre accessibles les services, établissements de restauration, toilettes accessibles et professionnels formés (moniteurs mais aussi personnels d'accueil) sont mis à disposition de certaines stations de ski des PO pour accueillir des handi-skieurs jusqu’à la création du label « ELH » dont Dejonghe et Douard sont à l’origine.
Ainsi, que ce soit Pous et Douard au niveau local, Dejonghe au niveau national, tous ont oeuvré de manière concertée et bénévole pour créer une dynamique de structuration du handi-ski dans les PO orientée vers un tourisme de loisir intégré. Cette organisation et mise en visibilité du handi-ski dans les PO ont permis de « faire la trace », comme le dit Pous, aux premiers stages proposés par Barbin et Sahuquet (Le Roux et al., 2014). Toutefois, si on a pu montrer ici combien l’implication de ces trois acteurs, handi-skieurs comme valides, sont à l’origine de changements dans l’acceptation d’handi-skieurs en stations de ski, il reste à étudier la constance de cette acceptation à la suite de leur départ. En effet, ces trois acteurs ont bénévolement pris le temps et les responsabilités de gérer des stages et des manifestations handi-sportifs, ce qui nous amène à nous demander l’implication actuelle de bénévoles dont l’engagement relève bien souvent d’une aide humaine calculée.Cette implication est d’autant plus à questionner que les pratiques handi-sportives de pleine nature comme le handi-ski deviennent de plus en plus techniques.
Appendices
Notes
-
[1]
Chiffres de la FFH arrêtés en janvier 2023.
-
[2]
Philippe Berthe devient président fondateur de l’ASMF et premier président de la fédération en 1963. En effet, l’ASMF prend rapidement de l’ampleur et en dix ans elle devient la base de la Fédération Sportive des Handicapés Physiques de France (fshpf) (11 mai 1963).
-
[3]
Compte-rendu de l’Assemblée générale 1958 de l’ASMF publié dans la Revue des Mutilés de France.
-
[4]
Le ski « debout » a été une des premières activités investies par les mutilés de guerre à l’origine du mouvement sportif français pour handicapés physiques.
-
[5]
Motrices, sensorielles (visuelles et auditives), mentales, psychiques et maladies invalidantes.
-
[6]
Entretien avec Barbin et Sahuquet le 22 avril 2013.
-
[7]
En 1985, Barbin va développer un service des sports au centre de rééducation fonctionnelle de propara de Montpellier, centre de rééducation et de réadaptation neurologique et fonctionnelle créé en 1982.
-
[8]
Amputé fémoral à la suite d’un accident du travail, il participera à des stages handi-ski avec la FFH et le club handisport de Béziers.
-
[9]
Ces stages sont organisés dans le cadre de Montpellier club Handisport et Propara. Organisés pendant 20 ans, ces stages vont cesser à l’hiver 2011.
-
[10]
Le concept de participation sociale dépasse la simple possibilité de pratiquer du ski. La participation sociale pleine et entière vise la possibilité pour les personnes concernées de bénéficier des autres biens et services d'une station de ski comme tout un chacun (restauration, autres divertissements…) (Fougeyrollas et al., 2015).
-
[11]
La cité olympique de Font-Romeu a été construite dans le but de préparer les athlètes aux Jeux Olympiques.
-
[12]
Poste occupé de 1982 à 1994 avec la mission de fédérer les forces vives à pratiquer cette discipline en Languedoc-Roussillon.
-
[13]
Les discours apparaîtront dans le corps de l'article entre guillemets et en italique.
-
[14]
La revue Handisport Magazine parait en 1982 et fait suite à cinq revues publiées par les associations qui ont fédéré le mouvement handisport français des années 1950 aux années 2000 : la Revue des mutilés de France (1955-1959), l’ASMF Magazine (1959-1963), le Second Souffle (1964-1981), le FFHOP Magazine (1972-1977) la revue Handisport Magazine (à partir de 1982) et depuis 2011, c’est le Handisport Le Mag.
-
[15]
1992 est la date des Jeux olympiques et paralympiques de Tignes évoqués dans les entretiens comme un tournant dans la pratique du handi-ski.
-
[16]
Douard remplace Hubert Dussol (militaire, amputé fémoral et handi-skieur) pour gérer la partie handisport de l’ASB ski qui est un club « valide » (de plus de 800 membres) situé à Béziers. En 1981, il va créer Handisport Béziers pour proposer du multisport.
-
[17]
Pierre Knaff explique que « dans plusieurs pays, ces aspects [les avantages du handi-ski] sont si bien connus que le ski devient l’activité privilégiée des clubs sportifs pour handicapés [en France le handi-ski semble secondaire], malgré des difficultés géographiques bien plus aiguës que chez nous » (Second Souffle, n°14, octobre 1980 : 39).
-
[18]
La réponse du président de la FFH, Marcel Avronsart à Pierre Knaff au sujet des problèmes du handi-ski en France va à son encontre qu’au sein de la Fédération « le ski alpin est le plus favorisé. » (Second Souffle, n°14, octobre 1980 : 39).
-
[19]
André Auberger était le quatrième président de la FFH de 1981 à 2007.
-
[20]
À cette époque on parlait des Jeux Olympiques d’Hiver, le terme Paralympiques arrivera plus tard.
-
[21]
Le docteur Grison était médecin-chef à Grenoble (centre de réadaptation de Voreppe).
-
[22]
Pierre Martin était professeur d’EPS à Saint-Hilaire-du-Touvet, un centre de réadaptation où il exerçait avec son diplôme de kiné qu’il avait aussi.
-
[23]
Dejonghe avait un statut de professeur d’EPS à 18 heures par semaine, il travaillait en réalité entre 60 et 70 heures par semaine pour la fédération qui n’avait que 4 cadres d'État pour 32 disciplines.
-
[24]
Pour prétendre à l’organisation championnats de France les associations organisatrices « sont priées de faire parvenir un dossier de candidature au siège de la fédération. Ce dossier après étude de la Commission Sportive sera retourné aux intéressés avec la décision prise. » (Second Souffle, n°26, 1971 : 5).
-
[25]
Créé par le conseil général et fermée depuis.
-
[26]
Pous est Président du Rotary International Font-Romeu Cerdagne.
-
[27]
Sur la chaine espagnole TV3 et sur France 3 durant l’émission Stade 2.
-
[28]
Cette dynamique implique la création de la première association des handicapés d’Andorre en 1993.
-
[29]
À titre de comparaison, le comité départemental le plus ancien, celui de l’Hérault dont Douard avait la délégation, comptait 262 licenciés.
-
[30]
Soutenue par le sénateur et maire de Prades, qui a été premier vice-président de la région, Paul Blanc.
-
[31]
Comme l’explique Pous, ce n’est pas une station de ski qui est candidate, « c’est tout un canton qui est impliqué ».
-
[32]
À partir de 1990, il est organisé tous les 2 ans.
-
[33]
Pour gérer un tel budget, Pous a créé la première association Handisport Cerdagne Capcir en 1990.
-
[34]
On retrouve des « possibilités d’accueil permanent » dès 1987, principalement dans les stations des Alpes (…) ou bien encore dans le Jura (Handisport Magazine, n°45-46, 1987 : 23).
-
[35]
Un fauteuil ski coutait « presque 10 000 francs à l’époque. » (Pous).
-
[36]
Dejonghe travaillait en parallèle sur le développement du tourisme handicapé. L’idée est venue de « faire connaître des sites qui rassembleraient à la fois l’accessibilité, à la fois un éventail d’activités de pleine nature (au moins 3), (…) du matériel adapté présent et des cadres qualifiés (…) ça nous permettait de labelliser un site qui s’appelle « espace loisir handisport ». Depuis, l’obtention du label nécessite de « proposer a minima 2 activités dont 1 sport de nature » (Guide Handisport, 2016-2017 : 65).
-
[37]
Selon Dejonghe, le label a été validé par le comité directeur en 1996.
-
[38]
Une nouvelle version label EHL est proposée à la suite d’une « enquête réalisée en 2005 auprès des licenciés et des responsables de structures ». Cette « rénovation » s’accompagne d’objectifs : « 20 sites ELH en 2008, et au moins un site par région en 2010 » (Handisport magazine, n°125, mai-juin-juillet, 2006 : 20).
-
[39]
La référente nationale en charge du label EHL évoque un arrêt du label en 2018 pour des raisons de « lourdeurs » logistiques notamment au niveau de l’évaluation et du suivi.
-
[40]
Le dépliant propose une description de l’École du Ski Français de Pyrénées 2000 sur lequel on peut lire qu’elle « possède les compétences et le matériel requis pour : l’apprentissage, le perfectionnement, la préparation aux compétitions. Tous les handicapés peuvent être accueillis et formés : tétra ou paraplégiques, IMC, non-voyants, etc. L’École du ski français (ESF) fournit le matériel : fauteuil uniski, stabilisateurs, etc. ». Les domaines skiables sont ensuite présentés, du ski de piste au ski de fond. Enfin plusieurs hébergements sont référencés.
Bibliographie
- Bertaux, D. (1997). Les récits de vie. Nathan.
- Fougeyrollas, P., Boucher, N., Fiset, D., Grenier, Y., Noreau, L., Philibert, M., Gascon, H., Morales, E. et Charrier, F. (2015). Handicap, environnement, participation sociale et droits humains : du concept d’accès à sa mesure. Développement Humain, Handicap et Changement Social, Hors-série, 5-28.
- Gaillard, J. et Le Roux, N. (2010). Pratiques sportives et handicap, de nouveaux enjeux. Revue européenne de management du sport, 28, 3-62.
- Le Roux, N., Haye, L. et Perera, E. (2014). Les innovations technologiques pour le ski handisport et l’accès à la pratique : sport de compétition, sport loisir, sport familial, tourisme sportif. Dans A. Marcellini et G. Villoing (dir.), Corps, Sport, Handicaps : le mouvement handisport au XXIe siècle - Lectures sociologiques (p. 113-128). Téraèdre.
- Marcellini, A. (2005). Des vies en fauteuil…Usages du sport dans les processus de déstigmatisation et d’intégration sociale. CTNERHI.
- Marcellini, A., Leselec, E. et Gleyse, J. (2003). L’intégration sociale par le sport des personnes handicapées. Revue internationale de psychosociologie, Vol. IX(20), 59-72.
- Massé, R. (1996). Compte rendu de [Jacques REVEL (dir.), Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience. Gallimard et Le Seuil. 1996, 243 p., bibliogr.] Anthropologie et Sociétés, 20(3), 143-145.
- Olivier De Sardan, J.-P. (1995). Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social. APAD - Karthala.
- Perera, E., Beldame, Y. et Soulé, B. (2020). L'accessibilité des domaines skiables aux personnes en situation de handicap : des ressorts associatifs et matériels pour pallier le volontarisme ténu des gestionnaires des stations de montagne. Dans D. Issanchou et E. Perera (dir.), Corps, Sport et Handicaps. Expériences et expérimentation sociales de la technologie (Tome 3) (p. 145-163). Téraèdre.
- Reichhart, F. (2017). Les activités physiques et sportives de pleine nature : quelle accessibilité pour les publics en situation de handicap ? Introduction au dossier. Nature et Récréation, 8, 15-20. La naturalité en mouvement, ETE. Éditions ESPACES.
- Reichhart, F. (2020). De la mise en accessibilité à sa visibilité : étude de cas de l’accessibilité touristique en France. Nature et récréation, 8, 11-21.
- Reichhart, F. et Lomo Myazhiom A.-C. (2013). Quel tourisme pour les personnes handicapées ? Enjeux et pratiques du tourisme adapté. Téoros, 32(2), 81-85.
- Ruffié, S. et Perera, E. (2013). De l'ASMF à la FSHPF, Des amicales au regroupement fédéral. Dans S. Ruffié et S. Ferez (dir.), Corps, Sport, Handicaps : l'institutionnalisation du mouvement handisport (1954 – 2008) (p. 49-72). Téraèdre.
- Ruffié, S. et Ferez, S. (2013) Corps, Sport, Handicaps : l'institutionnalisation du mouvement handisport (1954 – 2008). Téraèdre.
- Ville, I. (2014). Les savoirs de la sociologie. Handicap, une encyclopédie des savoirs. ERES, 23(1), 399-413.

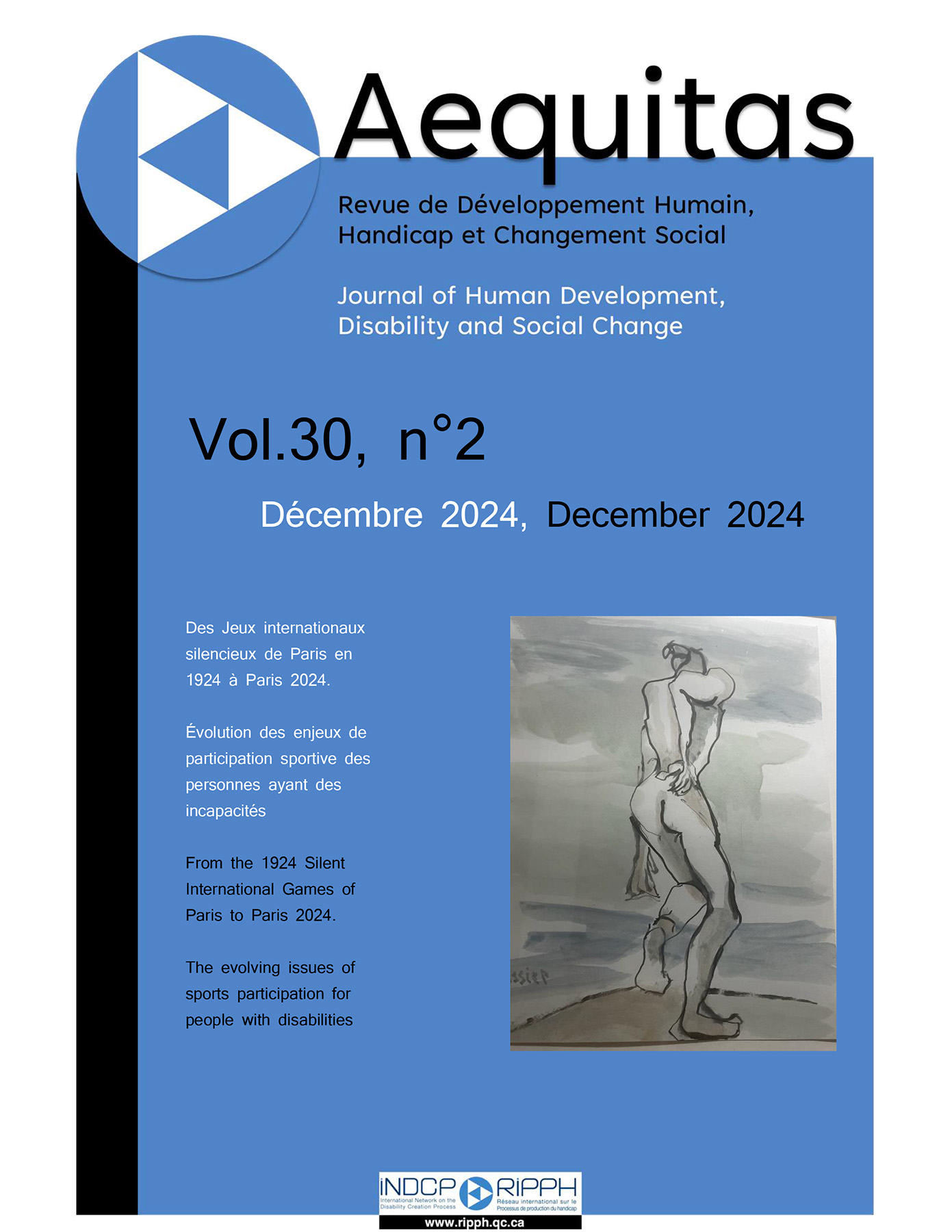
 10.7202/1086792ar
10.7202/1086792ar