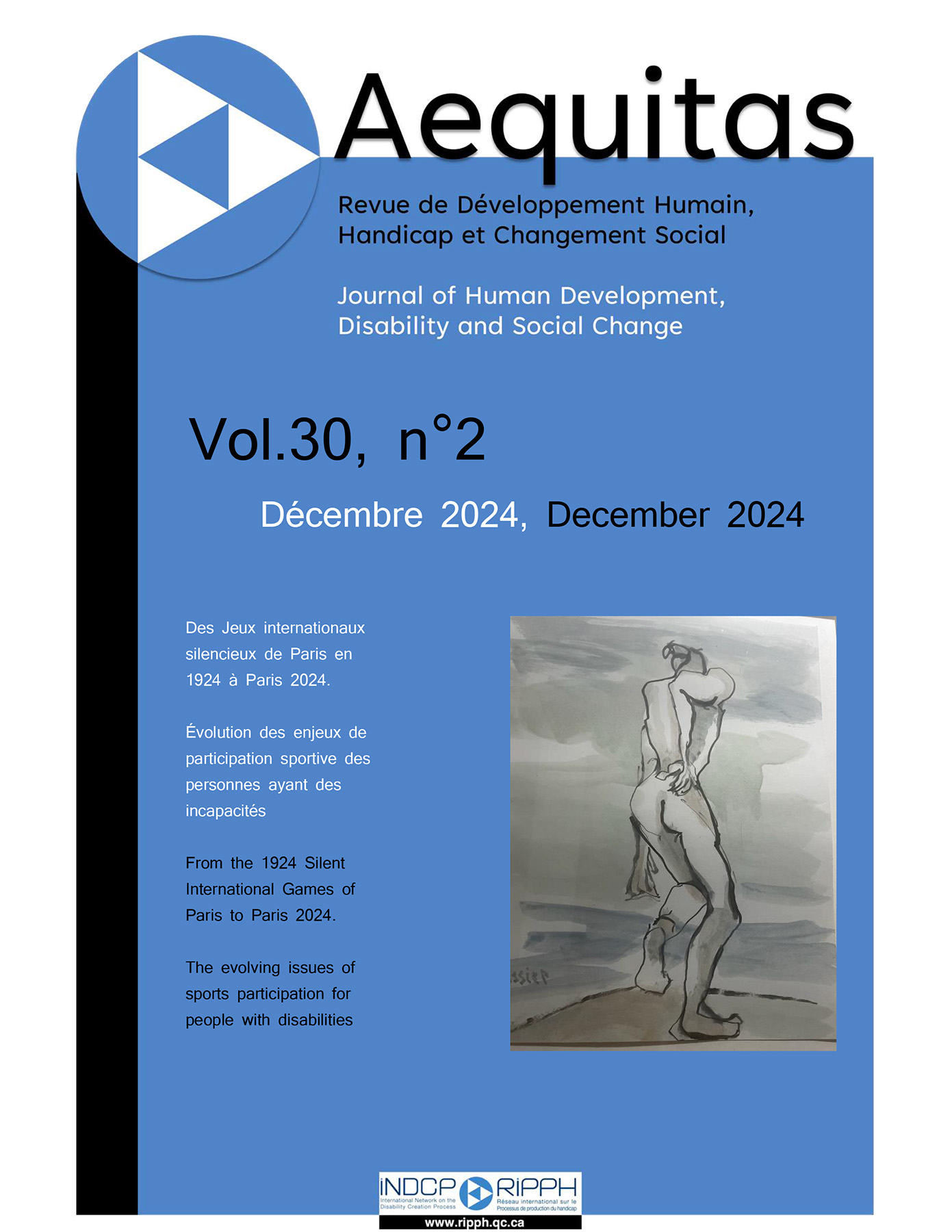Article body
Profitant de l’occasion de l’organisation et de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques à Paris (JOP) en 2024, ce numéro de la revue Aequitas a souhaité porter attention aux évolutions qui touchent tout autant le sport compétitif de haut niveau que les diverses formes d’activités sportives, physiques ou motrices de loisirs pour les personnes ayant des incapacités. En quoi les transformations internationales du sport-sourd, du para-sport et du paralympisme, ou celles plus locales du sport pour tous les publics spécifiques, particuliers ou vulnérables – incarné par les fédérations « handisport » et du « sport adapté » en France – ou encore les mutations du sport partagé, collaboratif ou participatif dans des institutions particulières, nous informent-elles sur le renouvellement du regard porté sur la participation sociale des personnes vivant des situations de handicap ?
Cette question de la participation sportive, qui apparaît désormais moins directement liée à des enjeux d’éducation, de rééducation ou de santé qu’à une question de droit, est portée par la visibilité croissante des personnes ayant des incapacités dans le sport. Dans ce contexte, quelle est la relation entre l’objet étudié, celui du sport, et le concept de participation sociale ? Cette relation entre sport et participation sociale a-t-elle évolué au cours du temps ? Recoupe-t-elle des préoccupations contemporaines inédites ? Si oui, quelles formes prennent-elles ? Plus globalement, quels sont les freins et les leviers à une plus grande participation de ces publics historiquement exclus des pratiques sportives ? Comment cette participation, désormais reconnue comme un droit, peut-elle devenir encore plus effective demain, dans des espaces plus inclusifs impliquant des usages plus collaboratifs ?
Il s’agit donc d’interroger la manière dont les acteurs du sport de haut niveau, mais aussi les professionnels de la rééducation, de l’éducation et les organisations du secteur des loisirs physiques et sportifs envisagent, ou non, la pratique du sport sous l’angle de la participation sociale au quotidien. Quelles formes cette participation sociale prend-elle aujourd’hui dans les différents lieux et dans les différentes institutions qui organisent le sport ? Comment cette participation sociale est-elle pensée par les décideurs, conçue par les politiques publiques, mise en oeuvre par les opérateurs et vécue par les acteurs du sport ? Quels sont les points d’achoppement et de friction qui demeurent entre les différentes parties ? Qu’en est-il, par exemple, de l’introduction de nouvelles pratiques physiques ou sportives dans les grandes compétitions, ou bien encore de l’accessibilité universelle à une offre de loisirs sportifs diversifiés, notamment dans les pratiques dites de « pleine nature » ?
Pour tenter d’apporter des éléments de réponse à ces différents questionnements, ce numéro rassemble six articles originaux de type académique, produits par des chercheuses et chercheurs d’horizons et de disciplines variées du domaine des sciences sociales (allant des sciences du sport aux sciences de l’éducation, de l’histoire à la sociologie, des sciences politiques aux sciences de l’information et de la communication). Leurs travaux, qui s’intéressent à différents types de publics, relatent des terrains d’enquêtes diversifiés, en mobilisant des cadres théoriques issus des approches historique, anthropologique, sociologique, juridique, etc., en vue de saisir les situations étudiées et les paroles des acteurs.
***
Les trois premiers articles académiques privilégient un questionnement sur les enjeux de regroupement/ distinction des déficiences (en partant de l’histoire du sport des sourds), de catégorisation des déficiences et des incapacités dans les compétitions (avec la mise en place de classifications fonctionnelles à partir des années 1970) et de représentation médiatique des athlètes appareillés. Il privilégie une analyse de grandes transformations qui s’opèrent sur le temps long. Les trois autres articles académiques s’intéressent à des évolutions plus récentes, liées à des pratiques sportives (le para-dressage, la joëlette et le handi-ski) dont le développement implique un questionnement sur le rapport entre sport de loisirs (et les acteurs économiques du secteur touristique) et le sport de compétition, mais aussi sur la problématique de l’accès à la « pleine nature ».
Sous le titre Les Sourds sportifs sont-ils des sportifs comme les autres ? l’article sur le sport des sourds de Didier Séguillon et Patrick Fougeyrollas présente une dynamique totalement à part des Jeux paralympiques ; et à bien des égards plus proche des Jeux olympiques que du sport paralympique[1]. Les auteurs nous entraînent ainsi dans les méandres du sport silencieux, comme l’on disait dans la première moitié du XXe siècle, dans lequel la participation sportive est centrale. Or, cette dernière est aujourd’hui malmenée, le sport des sourds se trouvant écartelé entre la défense d’une identité particulière à travers le sport, celui des « sourds sportifs », et la nouvelle revendication des plus jeunes ou « sportifs sourds », souvent déficients auditifs (ne connaissant par la culture sourde et n’ayant pas ou peu de contact avec la communauté sourde), de participer aux Jeux paralympiques ; avec les promesses d’aide, de visibilité et de récompenses associées à ces Jeux, aujourd’hui beaucoup plus attractifs que les Deaflympiques, jeux spécifiques des sourds utilisant comme média de communication la langue des signes.
Le texte de Damien Issanchou, Sylvain Ferez et Sébastien Ruffié revient pour sa part sur Le génie pragmatique du travail de construction des classifications sportives des "handicapés physiques" en France entre 1968 et 1976. Il éclaire le travail caché qui conduit, en 1976, à l’ouverture des « Jeux para-olympiques », jusqu’alors réservés aux blessés de la colonne vertébrale en fauteuil, aux amputés et aux déficients visuels. Ainsi débute le mouvement d’élargissement des types de participants qui conduira, en 1989, à la création du Comité paralympique international. Ce mouvement implique à la fois l’introduction de nouvelles disciplines sportives (adaptées aux incapacités des publics entrants) et une réflexion sur les classifications des sportifs. À partir du cas de la France, Damien Issanchou et ses collaborateurs étudient l’émergence de classifications fonctionnelles, pour chaque épreuve sportive, dans le cadre d’une dynamique d’émancipation à l’égard de l’ancienne logique de regroupement par déficiences. Loin de s’ancrer dans une réflexion purement théorique, les innovations classificatoires s’opèrent ici à partir des litiges et critiques des résultats des compétitions. Ainsi s’esquisse une vision inédite du handicap, lié au contexte et conçu selon les situations.
Dans un troisième article, Anthony Flores Caballero, Robin Guyot et Anne Marcellini nous invitent à étudier et analyser les représentations médiatiques des athlètes paralympiques durant les quarante ans qui précédent les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. En effet, cette contribution porte sur celles-ci et a pour titre L’évolution des représentations médiatiques des équipements sportifs utilisés par les athlètes paralympiques : étude des productions audiovisuelles de la Télévision Suisse romande (1976 – 2021). L’article démontre comment, dans une complémentarité existante entre les discours journalistiques et les images, les représentations télévisuelles vont, non pas souligner, mais renforcer l’idée même d’une symbiose réussie entre l’homme et la machine. De plus, la construction médiatique des Jeux paralympiques contribue à l’émergence de la figure de l’athlète hybride, mythe présentant l’idée de l’humain augmenté comme une évidence.
L’article de Zinnia Guittin, Vanina Deneux-Le Barh, Jocelyne Porcher et Sylvie Perez se centre sur une évolution plus récente, en essayant de saisir les effets de l’introduction du para-dressage depuis les Jeux d’Atlanta 1996 à partir d’une revue de littérature sur cette seule et unique discipline équestre représentée aux Jeux paralympiques. Ces derniers peuvent-ils constituer une opportunité pour développer plus largement la pratique de l’équitation chez les personnes ayant des incapacités ? Si la littérature scientifique pointe l’intérêt d’une telle pratique, qui produit de nombreux bénéfices psycho-affectifs et sociaux pour les personnes (en leur permettant de construire une identité de cavalier ou cavalière socialement reconnue), la question de l’accessibilité et des conditions de la participation sportive reste posée. D’un côté, l’exposition médiatique du para-dressage depuis son entrée aux Jeux paralympiques offre non seulement une formidable vitrine pour louer ses « bienfaits » pour les personnes vivant des situations de handicap, mais aussi une occasion de montrer combien les adaptations de l’équitation sont simples et peu nombreuses pour rendre la pratique « ordinaire » plus inclusive.
De l’autre côté, les autrices concluent néanmoins que ces adaptations ne vont pas de soi. Il apparait donc nécessaire de rendre visibles les enjeux associés au développement d’une pratique équestre inclusive bien en amont des Jeux, et d’accompagner ce dernier avant et après l’événement.
En interrogeant La pratique de la joëlette en contexte compétitif : du partage à l’invisibilité de la personne en situation de handicap, l’article de Nathalie Pantaléon et Mai-Anh Ngo analyse non seulement la question de la mise en visibilité/invisibilité, mais également celle de l’usage du matériel et du recours à la compensation humaine pour exercer sa pratique sportive. En se centrant sur le point de vue des pratiquantes et pratiquants, à partir d’une enquête par entretiens et par observations participantes, les autrices montrent que leur expérience de ces différentes dimensions (visibilité/matériel/compensation humaine) varie très fortement en fonction du mode d’engagement dans la pratique, plus ou moins contemplatif ou compétitif. En fait, c’est la place même de la personne ayant des difficultés de mobilité au sein de l’équipe qui se transforme entre un usage ludique en contexte de loisirs de pleine nature et un usage dans le cadre d’une compétition sportive de type semi-marathon ou trail. Le contexte compétitif engendre d’autres types de relations sociales, dans lesquelles l’altruisme et le partage mis en exergue dans une pratique non compétitive tendent à être occultés.
Si le dernier article académique s’intéresse aussi à une pratique qui se déroule dans des espaces naturels, il conduit à changer d’angle de vue en s’intéressant à la question de la construction d’une offre touristique, en lien avec le développement d’une pratique de compétition. Éric Perera, Gaël Villoing et Nathalie Le Roux retracent ainsi le processus de structuration du handi-ski dans les stations du massif des Pyrénées-Orientales (PO) françaises et le développement d’un tourisme de loisir intégré associé. Sous le titre, Des compétitions handi-ski d’envergure pour un tourisme sportif intégré au sein des stations de ski des Pyrénées-Orientales, cette contribution conduit à souligner combien l’opportunité d’organiser des compétitions de handi-ski répond initialement à des enjeux politico-économiques locaux. En encourageant le développement de conditions d’accueil des handi-sportifs en stations de ski, ces enjeux contribuent in fine à renforcer la participation sociale de tous les handi-skieurs.
***
Outre ces six articles académiques, le numéro propose deux textes présentant des regards experts et des « savoirs professionnels » sur l’évolution du mouvement parasportif français. Celui de Valentine Duquesne, docteure en sciences du sport et salariée du Comité paralympique et sportif français (CPSF), présente la construction atypique de ce dernier, fondé sur une structuration hybride impliquant à la fois les fédérations sportives spécifiques (la fédération handisport et la fédération du sport adapté) et le milieu sportif « ordinaire ». À l’articulation de ces deux mondes, l’autrice met en lumière les enjeux et défis auxquels le CPSF est confronté.
Le second regard d’experte relate une rencontre avec la présidente du CPSF, Marie-Amélie Le Fur. Athlète paralympique multi-médaillée entre 2008 et 2021, impliquée dans la candidature de Paris pour les Jeux de 2024, puis dans l’organisation de l’événement, elle se situe aux premières loges pour évoquer les transformations du mouvement paralympique depuis deux décennies, « l’héritage » de Paris 2024 en matière d’inclusion et les enjeux d’accompagnement du développement du parasport par la recherche en sciences humaines et sociales.
Enfin, deux textes de la rubrique « Les échos de la communauté » viennent clore le numéro. Le premier rend compte des missions et activités du groupe d’experts d’usage mis en place au premier trimestre 2023 par l’État français au sein de la Délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP). Le second revient sur l’exposition « Histoires Paralympiques. De l’intégration sportive à l’inclusion sociale (1948-2024) », proposée par le Centre des monuments nationaux (CMN) français au Panthéon, dans le 5e arrondissement de Paris, entre le 11 juin et le 29 septembre 2024. En retraçant le chemin menant des « Jeux hospitaliers » de Stoke Mandeville, créés en 1948 par le neurochirurgien Ludwig Guttmann, aux dernières éditions des Jeux paralympiques, cette exposition tentait de retracer les grandes lignes d’un mouvement sportif d’émancipation et de reconnaissance de l’altérité, visant à faire de la diversité humaine un motif de fierté partagée.
Appendices
Note
-
[1]
Notamment en raison de la participation de sportives et sportifs déficients auditifs aux Jeux olympiques. Ils étaient par exemple huit à participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024.