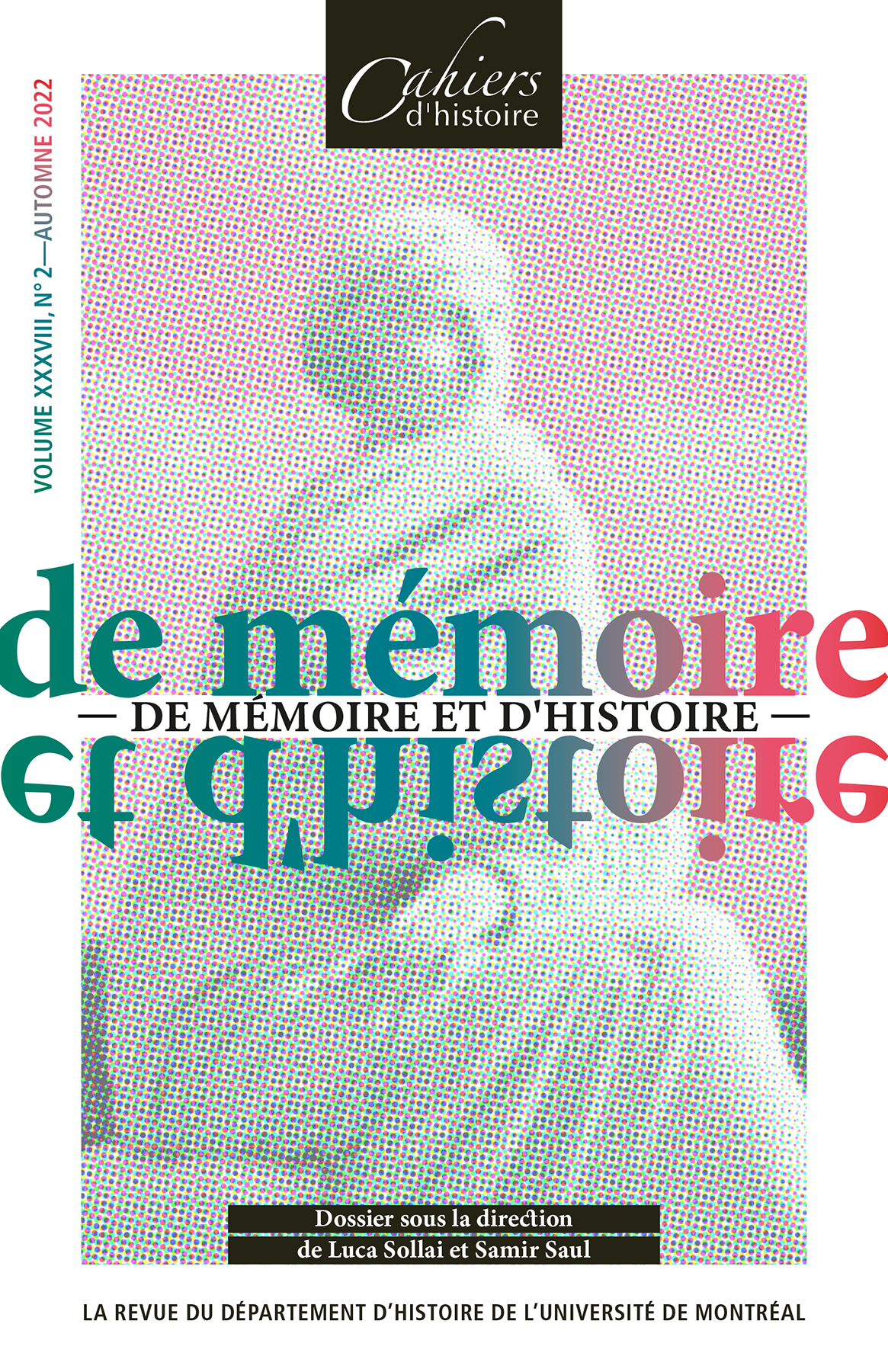Corps de l’article
Professeure adjointe au Département d’histoire de l’Université de la Colombie-Britannique depuis 2012, Laura Ishiguro est spécialiste de l’histoire du colonialisme de l’empire britannique dans l’Ouest canadien. Son ouvrage Nothing to Write Home About repose sur l’étude de milliers de lettres échangées entre 1858 et 1914 par des membres de familles dispersées entre la Colombie-Britannique et la métropole britannique, ce qu’elle nomme des « familles trans-impériales ».
Cette étude se situe à la croisée de l’histoire transnationale, de l’impérialisme et du colonialisme britanniques. Dans cette recherche portant sur les débuts de la colonisation du territoire britannico-colombien par la Grande-Bretagne, Laura Ishiguro s’attarde tant au contenu de cette correspondance familiale trans-impériale, c’est-à-dire « what needed to be said[1] », que ce qu’elle passe sous silence, soit « what could not be said and what could go without saying[2] ». Il s’agit d’ailleurs là d’une perspective intéressante, tant d’un point de vue historiographique que méthodologique, alors que les omissions et les non-dits sont non seulement relevés, mais font partie intégrante de l’analyse proposée par Ishiguro. Comme elle arrive à le démontrer brillamment, ces silences, si correctement interrogés, parlent tout autant que le récit en lui-même. Pour arriver à les faire parler, Ishiguro emploie non seulement une méthode de lecture à contre-courant—« reading silences against the grain[3] »—, mais aussi une vision périphérique—« a peripheral vision[4] ». Si ces silences d’origine épistolaire contribuent tantôt à taire la violence coloniale à l’égard des Autochtones dépossédés de leurs terres (chapitre 3), tantôt à mettre en lumière des conflits, tensions et désengagements familiaux (chapitre 5), ils étaient aussi à l’occasion sciemment employés par les correspondants en tant que stratégie afin de garder contact avec la famille tout en dissimulant certains éléments de leur intimité que ceux restés dans la métropole ne sauraient ni comprendre ni approuver (chapitre 6).
L’ouvrage est composé de trois parties comportant chacune deux chapitres. La première partie introduit les éléments clés ayant permis aux familles trans-impériales de transcender la distance et de maintenir le lien entre elles. Le premier chapitre met en lumière l’importance des changements qu’ont connus les services postaux dans l’empire britannique au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, ce qui a favorisé l’émergence d’une culture de la correspondance familiale trans-impériale. Le deuxième chapitre, quant à lui, s’attarde au contenu et aux usages de ces échanges épistolaires trans-impériaux. Non seulement ces correspondances personnelles envoyées outremer contribuaient à maintenir une intimité relative avec le reste de la famille restée en métropole, mais elles participaient en outre au projet de colonisation de la Colombie-Britannique.
La deuxième partie se penche sur la mise en représentation du quotidien colonial dans les échanges épistolaires. Comme le souligne le troisième chapitre, une fois passée la fascination initiale face au nouvel environnement colonial, les épistoliers colonisateurs axaient régulièrement leur discours sur la banalité de la vie coloniale à l’égard de laquelle il n’y avait « nothing to say[5] ». Cela concourait à présenter la Colombie-Britannique comme normale, malgré la violence du colonialisme à l’encontre des Autochtones. Dans le quatrième chapitre, Ishiguro porte son regard sur un sujet souvent abordé dans les correspondances trans-impériales : la nourriture. À la fois objet de familiarité et de curiosité, l’alimentation offrait un sujet de discussion connu et commun aux gens en métropole, tout en permettant de mettre en valeur certaines des spécificités propres à la jeune colonie. Ces discussions favorisaient ainsi une mise en représentation de la Colombie-Britannique comme étant un foyer distinct, mais propice aux pratiques britanniques.
La dernière partie s’intéresse aux moments de crises et de ruptures familiales, soulignant que ceux-ci configurent également les relations familiales trans-impériales. Le cinquième chapitre montre que ces familles, lorsqu’éprouvées par le décès d’un des leurs, devaient s’en remettre aux correspondances mortuaires afin de créer et de prendre part à une communauté de deuil malgré la distance. Les lettres étaient aussi l’occasion de reconfigurer la famille en réglant les questions d’héritage et de succession, exposant au passage certaines tensions familiales. Dans le dernier chapitre, Ishiguro démontre que les échanges épistolaires trans-impériaux ne signifiaient pas toujours une intimité partagée en mettant en évidence un silence épistolaire intentionnel : celui d’un colon britannique quant à son mariage, pourtant publiquement reconnu dans la colonie, avec une femme Ktunaxa (Autochtone).
Ce choix d’objet de recherche rejoint l’histoire personnelle et familiale de Laura Ishiguro. Descendante d’ancêtres migrants britanniques et japonais, elle a grandi dans le territoire occupé W̱SÁNEĆ, au sud-est de l’île de Vancouver. Sa fine analyse dans Nothing to Write Home About laisse croire que son héritage familial n’est pas complètement étranger à sa grande sensibilité à l’égard de la discrimination raciale sous diverses formes, notamment de silences.